


ACTUALITÉ
Les défenseurs syndicaux ne seront plus automatiquement issus des syndicats représentatifs
Par une décision du 14 septembre 2021 (Décision n° 2021-928 QPC ), sur requête de la Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière ( CNT-SO ), le Conseil Constitutionnel vient de juger que la restriction de la désignation des défenseurs syndicaux aux syndicats représentatifs n'est pas motivée : " le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d'une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction ".
Aujourd'hui, les défenseurs syndicaux, demain, les conseillers prud'hommes
et les conseillers du salarié ?
Espérons que certaines officines travesties en syndicat n'en profitent
pour monter des bizness juteux avec la défense syndicale.
14/09/2021
*
Le dépassement de la société de capitaux par l'entreprise
Jacques Barthélémy, avocat au service du patronat,
vient de publier une
tribune.
Il veut veut que le CSE ait plus de facultés de signer des accords. Ce
faisant, il ne dit pas qui perdrait cette faculté : les syndicats, étrangement
absents de l'analyse.
Il préconise de sortir l'employeur de l'institution de représentation
du personnel du fait de sa double casquette de membre de l'institution qui représente
le personnel face à l'employeur et … d'employeur. C'est une bonne
chose.
Il prône des stratégies visant à privilégier la pérennité
de l'entreprise, notamment grâce à l'acceptation de réductions
temporaires d'avantages attribués au personnel lors de difficultés
économiques. Par contre, il ne demande pas de réductions temporaires
des avantages consentis aux actionnaires, ni aux dirigeants de l'entreprise.
Un deux poids-deux mesures qui démontre l'aveuglement idéologique
de l'avocat Jacques Barth
12 septembre 2021
*
LinkedIn, naturopathie et formation professionnelle
Un salarié qui voudrait se former aux « soft skills » via
le site moncompteformation peut choisir l'entreprise F2I. Celle-ci sous-traite
son contenu à « LinkedIn-teachning », la filiale de formation
du leader du réseau social professionnel. La formation aux « soft
skills » de LinkedIn promeut la naturopathie, le tout, arrosé de
physique quantique.
Le site moncompteformation est administré par la Caisse des dépôts et consignations et le financement est abondé par les entreprises, au titre de la formation professionnelle.
La vidéo
de présentation complète est sur le site DailyMotion.
2 juin 2021
*
LE BAREME D'INDEMNISATION DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ENCORE REMIS EN QUESTION
Le barème des indemnités pour les licenciements abusifs date du 23 septembre 2017. Décrié par les syndicats de salariés, il est combattu par un certain nombre de juridictions et donne lieu à de multiples jugements et arrêts écartant ce barème et indemnisant plus les salariés. La Cour de cassation a rendu son avis et considère que le barème est applicable.
La cour d’appel de Reims a rendu deux décisions le 9 décembre 2020 (n° RG 19/01136 et 19/01137), dans la droit ligne de celle déjà rendue le 25 septembre 2019 : effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne reconnu contre l’avis de la Cour de cassation ;
Distinction entre deux types de contrôle de conventionnalité, « in abstracto » et « in concreto » ; pas besoin pour le salarié de justifier au préalable que son préjudice dépasse le barème ; en revanche, le salarié doit absolument solliciter expressément l’appréciation » in concreto » de la part des juges, sans quoi la cour d’appel considère qu’ils n’ont pas à se prononcer dessus.
17 mars 2021
*
LES CONSÉQUENCES DU COVID SUR LES SALARIÉS D'ENTREPRISES EN PROCÉDURE COLLECTIVE.
Claude Lévy, syndicaliste CGT et défenseur syndical, a publié sur le site Chronique Ouvrière un article sur les conséquences des salariés d'entreprises frappées par une procédure collective.
" Il faut modifier la couverture de l'assurance de garantie
des salaires.
Chaque année de très nombreux salariés se retrouvent piégés
et sans garantie compte tenu des dispositions de l'article L3253-8 du code du
travail 1° et 5°. En effet sont couvertes par l'assurance de garantie
des salaires les sommes dues :
" 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement
d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de
sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail
intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite
d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les
sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ; "
Compte tenu des durées excessives des périodes d'observation qui
suivent la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement
judiciaire il n'est pas rare de constater que des salariés qui ont travaillé
durant la dite période se retrouvent privés de garantie de l'AGS
pour le paiement partiel ou total de leurs rémunérations.
En cas de plan de continuation aucun salaire ou rappel de salaires n'est dû
selon la Cour de cassation (par exemple 31/1/2018 n° 16-19861 en annexe).
En cas de liquidation judiciaire le 5° de l'article L3253-8 du code du travail
ne garantit les salaires que durant les 45 premiers jours de la période
d'observation.
A l'heure où en raison de la pandémie de nombreuses entreprises
sont ou risquent d'être en redressement ou en liquidation judiciaire avec
des périodes d'observations très certainement importantes, il
est urgent de réformer les dispositions de l'article L3253-8 du code
du travail ;
Le syndicat CGT-HPE lance une pétition dans ce sens et propose la nouvelle
rédaction suivante de l'article L3253-8 du code du travail.
" 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de l'exécution et de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire,dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
b) Au cours de la période d'observation ; "
Pour cela il faudrait légèrement relever le taux scandaleusement
bas de la cotisation AGS des entreprises passé de 0.4% des salaires bruts
au 1/10/2009 à ………….0.15% depuis le 1/7/2017. "
Cet article a porté ses fruits puisque le député Fabien Roussel a écrit le courrier suivant à la ministre du travail :
" Bruay-sur-l'Escaut, le 5 novembre 2020
Madame la Ministre,
L'ampleur de la crise économique que nous vivons demeure à ce
jour inconnue. Toutefois, il est à craindre que, durant les mois à
venir, de nombreuses entreprises ne soient placées en redressement, voire
en liquidation judiciaire.
Si toutes les dispositions doivent être engagées pour éviter
de telles issues, pour autant, il importe dès à présent
de prévoir les mesures permettant aux salariés, dont l'emploi
serait supprimé, de percevoir les rémunérations correspondant
à leur travail effectif.
En ce sens, il serait pertinent de revoir le périmètre de couverture
de l'assurance de garantie des salaires, défini par l'article L3253-8
du Code du Travail. Les alinéas 1 et 5 de cet article apparaissent ainsi
inadaptés à la réalité vécue par les salariés,
dont l'entreprise se trouve en grande difficulté.
Ainsi, compte tenu des durées excessives des périodes d'observation
qui suivent la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement
judiciaire, il n'est pas rare de constater que des salariés qui ont travaillé
durant ladite période se retrouvent privés de garantie de l'AGS
pour le paiement partiel ou total de leurs rémunérations.
En cas de plan de continuation, aucun salaire ou rappel de salaires n'est dû,
selon la Cour de cassation. En cas de liquidation judiciaire, l'alinéa
5 de l'article L3253-8 du code du travail limite la garantie des salaires aux
seuls 45 premiers jours de la période d'observation.
Alors qu'en raison de la pandémie, de nombreuses entreprises sont ou
risquent d'être placées en redressement ou en liquidation judiciaire
avec des périodes d'observations très certainement importantes,
il apparaît urgent de réformer les dispositions de l'article L3253-8
du code du travail. Aussi une rédaction de l'article, comme suit, serait-elle
pertinente :
alinéa 2 : Les créances résultant de l'exécution
et de (ajout) la rupture des contrats de travail intervenant
alinéa 5 : Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans
la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
(suppression) les sommes dues :
Un tel amendement devrait s'accompagner d'un relèvement du taux de la
cotisation AGS qui n'a cessé de diminuer au fil des années pour
ne plus atteindre que 0,15% depuis le 1er juillet 2017. C'est ce sens
que je sollicite votre bienveillante attention.
Vous remerciant pour les prolongements que vous réserverez à la
présente, je vous prie d'agréer,
Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.
"
Les salariés dont l'entreprise est en difficulté auront tout intérêt à un changement législatif en la matière.
25 novembre 2020
Les
Institutions Représentatives du Personnel et les risques psychosociaux
Au
même moment, les instances de représentations professionnelles
traditionnelles : délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT,
disparaissent en laissant la place à une instance unique : le comité
social et économique. Bien que toute entreprise de plus de 10 salariés soit
dans l’obligation d’organiser des élections professionnelles, près d’une sur
trois est dépourvue de toute représentation. Il semble donc y avoir un hiatus
entre la théorie et la réalité. Si déjà même la mise en place d’une
représentation est impossible dans beaucoup d’entreprises, comment celles qui
sont en place font face aux risques psychosociaux ?
L’enjeu est de savoir quelles sont les faiblesses des IRP et les clefs de la réussite dans leurs missions face aux risques psychosociaux.
19 octobre 2020
*
RUPTURE CONVENTIONNELLE : QUAND LA NON REMISE DU DOUBLE DE LA CONVENTION RIME AVEC NULLITÉ
Lorsque vous signez une rupture conventionnelle, l'employeur est-il tenu de vous remettre un exemplaire de cette convention ? Oui, rappelle la Cour de cassation, et en cas de contestation, il lui appartient de prouver qu'il vous a bien remis cet exemplaire. Cette remise est une formalité essentielle pour garantir votre libre consentement et vous rétracter en connaissance de cause. A défaut, la convention de rupture est nulle. Voici les rappels et précisions opérés par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre dernier.
" Les faits
Les faits sont simples : alors qu'il travaillait depuis une quinzaine d'années
au service d'une entreprise de travaux en tant que couvreur, le salarié
et cette entreprise signent une rupture conventionnelle.
Seulement voilà, le salarié va contester cette convention de rupture
: en effet, une fois celle-ci signée, le salarié est reparti les
mains vides. L'employeur ne lui a pas remis un exemplaire de la convention ce
qui, selon lui, la rend nulle.
Et la cour d'appel confirme : elle annule la convention de rupture et condamne
l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'une rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat
s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec toutes les conséquences indemnitaires que cela entraîne (indemnités
de licenciement injustifié, indemnités compensatrices de préavis,
etc). Attention quand même, car dans ce cas, le salarié doit, de
son côté, restituer à l'employeur les sommes que celui-ci
lui aurait versées en exécution de la convention de rupture.
Au tour de l'employeur de contester et ce, en avançant 3 arguments :
- le Code du travail n'impose pas que chaque partie à une rupture conventionnelle
dispose de son propre exemplaire sous peine d'être déclarée
nulle;
- à supposer que l'absence de remise au salarié de son exemplaire
entraîne la nullité de la rupture, c'est bien à celui qui
invoque la nullité de prouver qu'il existe une cause de nullité
! En l'occurrence, la charge de la preuve incomberait donc au salarié.
Or, la cour d'appel a au contraire reproché à l'employeur de ne
pas avoir apporté la preuve qu'il avait bien donné un exemplaire
au salarié;
- la demande de rupture conventionnelle a bien été faite auprès
de la Direccte qui, de plus, l'a homologuée ! Pour l'employeur, la cour
d'appel aurait dû rechercher si l'absence de remise du document au salarié
avait été de nature à affecter son libre consentement et
son droit de se rétracter en connaissance de cause. Ce qu'elle n'a pas
fait…
L'employeur saisit la Cour de cassation : Le fait de ne pas remettre le double
de la convention de rupture au salarié entraîne-t-il la nullité
de cette convention ? En cas de contestation, qui doit prouver la remise (ou
non) du document ?
La réponse de la Cour de cassation est claire :
" L'absence de remise d'un double de la convention de rupture au salarié
la rend nulle
Il faut bien comprendre l'intérêt et l'importance pour le salarié
de disposer d'un exemplaire de la convention rupture du contrat qu'il vient
de signer. La Cour de cassation le rappelle : cela est nécessaire à
la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention,
mais aussi (et surtout) pour garantir le libre consentement du salarié,
en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance
de cause. Dans notre affaire par exemple, le salarié met fin à
15 années passées au sein de son entreprise, ce qui n'est pas
négligeable. Il doit au moins être en mesure d'étudier pendant
le délai qui lui est imparti et à tête reposée, le
contenu de cette convention afin de l'analyser et d'apprécier les avantages
et inconvénients d'une telle rupture.
Pour rappel, une fois la convention de rupture signée, le salarié
et l'employeur disposent d'un délai de rétractation de 15 jours
calendaires qui, pour être tout à fait précis, débute
le lendemain de la date de signature(1).
Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation confirme que l'absence de remise
d'un exemplaire de la convention au salarié entraîne la nullité
de celle-ci.
Pourtant, sur le fond, l'employeur a raison : aucun article du Code du travail
n'oblige à établir la convention de rupture conventionnelle en
double exemplaire(2). C'est la Cour de cassation qui l'a en quelque sorte rendue
obligatoire dans un arrêt du 6 février 2013(3), tout en réaffirmant
ce principe de manière très régulière(4), jusqu'à
cet arrêt du 23 septembre 2020.
" C'est à l'employeur de prouver qu'il a remis cet exemplaire au
salarié
Oui ! En cas de contestation, c'est bien à celui qui invoque avoir remis
le document d'en rapporter la preuve. C'est ce que vient de préciser
la Cour de cassation.
Or, dans cette affaire, l'employeur n'avait justement apporté aucun élément
de preuve tendant à démontrer qu'il avait bien remis l'exemplaire
de la convention de rupture au salarié.
La convention de rupture est donc bien nulle. Inutile de rechercher, en plus,
en quoi cette absence avait pu affecter le libre consentement du salarié
et son droit de se rétracter en toute connaissance de cause. Le simple
fait que le salarié ne dispose pas d'un exemplaire de sa convention et
que l'employeur ne soit pas en mesure de prouver qu'il lui a remis, suffit à
rendre la convention de rupture ainsi signée nulle.
Il faut préciser que la Cour de cassation a retenu la solution inverse
concernant l'absence d'entretien préalable à la rupture conventionnelle
(5). Cette absence rend également la convention nulle, en revanche, si
c'est le salarié qui invoque la nullité, c'est à lui de
prouver qu'aucun entretien n'a effectivement eu lieu. Cela dit, cet aménagement
de la charge de la preuve s'explique aussi par le fait que le formulaire de
rupture conventionnelle mentionne obligatoirement la tenue d'un entretien et
que le fait que le salarié le signe et conserve un exemplaire laisse
présumer que cet entretien a eu lieu. A l'inverse, ce formulaire ne prévoit
pas d'y préciser qu'un exemplaire a bien été remis au salarié.
La décision rendue par la Cour de cassation n'est pas nouvelle, mais
elle est la bienvenue. Bienvenue d'abord au regard des conséquences pour
le salarié de l'absence de remise du double de la convention. Cette convention
renferme des informations essentielles (existence et durée du délai
de rétractation, sommes à verser, possibilité de contacter
Pôle emploi, etc) et indispensables à un consentement libre et
éclairé du salarié dans la décision de rompre ou
non son contrat de travail. La remise de ce document au salarié demeure
une formalité substantielle à la validité de la rupture
conventionnelle.
Bienvenue, cette décision l'est également en ce qu'elle fait reposer
sur l'employeur (et non sur salarié) la charge de démontrer que
le salarié a bien reçu sa convention. Ce qui simplifie grandement
les démarches du salarié en cas de contestation.
Finalement, cette formalité ne va-t-elle pas de soi ? Aujourd'hui, ce
n'est pas 2 mais 3 exemplaires de convention de rupture qu'il est souvent conseillé
d'établir.
Cass.soc.23.09.20, n°17-25770.
(1) Art L.1237-13 C.trav.
(2) Art L.1237-14 C.trav.
(3) Cass.soc.6.02.13, n°11-27000.
(4) Cass.soc.3.07.19, n°17-14232 et n°18-14414.
(5) Cass.soc. 1er.12.16, n°15-21609.
10 octobre 2020, Source
*
UN LICENCIEMENT EST-IL
VRAIMENT UNE CATASTROPHE POUR UNE PETITE ENTREPRISE ?
par Patrick Le ROLLAND, ancien conseiller prud'homme
La
plupart du temps, le créateur d’entreprise se lance seul. Parfois en
association avec des collaborateurs mais sans lien de subordination
(contrat de travail). Et vogue ainsi. Avantage : pas ou moins de
soucis à propos de la législation sociale. Et puis quand les affaires marchent
bien, que l’entreprise s’engage dans une voie de développement (c’est
tout le bien qu’on lui souhaite, les pouvoirs publics les premiers)
vient certainement le temps de la création d’emplois salariés. Et là,
que n’entend t’on pas dire parfois ? Embaucher mais encore faut-il
pouvoir se séparer d’un salarié en cas difficultés économiques ou si
finalement cette embauche n’est pas à la hauteur des espérances et
promesses quant au profil de l’intéressé(e). Et vient donc la crainte
que survienne un litige devant une juridiction un peu spéciale –
le Conseil de Prud’hommes – avec le risque d’y laisser des plumes
jusqu’à menacer la poursuite de l’activité. Créateurs, entrepreneurs,
micro-entrepreneurs, habitués souvent à apprendre sur le tas, sont tous
un peu nuls quand ils évoquent la juridiction prud’homale et c’est pour
ça qu’ils la craignent. Avec raison ? Avec notre invité qui
connait bien son sujet, nous allons tenter de faire la part des choses.
Patrick Le Rolland, vous êtes l’auteur de « Les Prud’hommes pour les nuls » dans la célèbre collection des éditions First.
ISBN 9782412020392 – 11€95 | Ce n’est pas votre premier ouvrage de vulgarisation juridique sur le sujet chez différents éditeurs. Trois
réformes de la procédure prud’homale de deux gouvernements successifs
en 2015, 2016 et 2018 ont rendu fort à propos ce tout nouveau « Les Prud’hommes pour les nuls ». Vous
êtes un ancien conseiller prud’homme élu dans le collège des salariés.
C’est alors un guide pratique écrit pour les salariés, non ? |
PLR – Quand on évoque la procédure prud’homale, il est vrai qu’on pense d’abord aux salariés ou ex-salariés puisque en général ils viennent devant la juridiction après avoir été licenciés. Ce sont eux les demandeurs, les initiateurs du procès dans la quasi-totalité des cas. Autrement dit, à la barre du tribunal ce sont eux qui attaquent. Qui portent plainte comme ils disent parfois par abus de langage bien qu’il s’agisse d’un litige civil : un contentieux né d’un contrat, de sa rupture plus que de son exécution le plus souvent. C’est donc à ces salariés qu’il importe d’abord de maîtriser suffisamment la procédure, de savoir mette en forme leurs demandes, d’être en mesure de les justifier en droit et en fait. L’employeur, lui, se défend de ce sur quoi on lui cherche querelle… à tort (parfois) ou, plus ou moins, à raison (souvent) ! De son côté, il n’est pas interdit à cet employeur de faire l’effort lui-aussi de savoir ce dont il en retourne et de s’approprier les bases de la procédure. Pour, comme le salarié lambda, être moins nul selon la formule consacrée.
|
Le Conseil de prud’hommes Une
juridiction paritaire, composée de magistrats non professionnels, issus
des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de
salariés. |
Justement,
mais les salariés gagnent souvent leur procès aux prud’hommes. Pour
tout employeur, il y a donc de quoi être inquiet jusqu’à même renoncer
à créer un emploi salarié pour être sûr de ne pas avoir d’ennuis.
PLR - C’est
vrai. Les statistiques révèlent que les salariés sortent vainqueur de
leur procédure à environ 67 %. Mais ce n’est pas forcément pour
toutes leurs demandes. Ça peut n’être qu’en partie seulement.
Comprendre par là que sur une série de demandes distinctes ou plus ou
moins interdépendantes entre-elles, le salarié n’obtient pas forcément
satisfaction sur chacune d’elles, ni surtout à hauteur des montants
qu’il espère. Mais il suffit qu’une seule de ces demandes soit, même
partiellement, satisfaite pour que sur le plan de la statistique
judiciaire, le salarié soit considéré comme gagnant de sa procédure.
Autrement dit, qu’il avait bien des droits à faire valoir contre son
(ex) employeur.
Cette
« victoire » ne portera parfois que sur la remise ou la
rectification d’un document quelconque ou quelques euros ou dizaines
d’euros manquant ici ou là lors de la reddition des comptes. Quelque
chose que le salarié ne serait pas forcément venu chercher devant la
juridiction prud’homale s’il n’y avait pas eu un autre litige plus
conséquent. Ce « principal » sur lequel il perdra parfois
tout en alimentant pourtant la statistique de la partie gagnante. Le
taux de succès qui ressort de la statistique officielle se doit donc
d’être interprété et largement nuancé.
Cela dit, il est assez logique que le demandeur s’en sorte majoritairement gagnant. Nul ne vient faire un procès à quiconque s’il n’a pas quelques arguments juridiques à faire valoir : le non respect d’un contrat, d’obligations, un préjudice causé, une tromperie, un abus de droit… Devant les autres tribunaux aussi, les demandeurs gagnent le plus souvent leur procès, sinon ils y auraient renoncé avant.
|
Quelques chiffres 210 Conseils de prud’hommes sur la carte judiciaire. Découpés
en cinq sections compétentes pour examiner le litige selon
l’identifiant de convention collective dont relève l’activité (agriculture, industrie, commerce, activités diverses) ou le statut du salarié (encadrement). 120 000 saisines en 2018, 119 669 en 2019 contre 150 000 en rythme de croisière auparavant. 7 à 8 procédures pour 1 000 salariés, contre 11 en moyenne européenne selon le Centre d’Etudes de l’Emploi (2014). |
Des jugements prud’homaux qui ne semblent pas être des vérités absolues si on regarde le taux d’appel. Qu’en dites-vous ?
PLR – 67 %
de recours en appel, c’est énorme en effet ! C’est trois ou quatre
fois plus que devant n’importe quelle autre juridiction se prononçant
en première instance. Comme ce sont les salariés qui gagnent
majoritairement, ce sont les entreprises qui en grand nombre font appel
les premières. Cela témoigne de la réelle défiance, des
employeurs surtout, envers les jugements prud’homaux rendus. Et ça
alimente la rumeur que ces décisions seraient assez peu juridiques sur
la forme et le fond. Et pourtant, deux-tiers des jugements contestés
par la partie perdante sont purement et simplement confirmés par la
Cour d’appel.
Et
parmi les décisions de Cour d’appel qui ne confirment pas mais
infirment, il y a des condamnations auxquelles le Conseil de
Prud’hommes s’était refusé ou que la juridiction d’appel revalorise
dans le montant pour en faire une application du droit plus rigoureuse
que la première juridiction paritaire n’avait voulu en faire.
Paradoxalement,
alors que les organisations socioprofessionnelles représentant les
entreprises et les employeurs ne cessent dans leur expression publique
de souligner leur attachement à la prud’homie, leurs mandants font
appel quand ils sont concernés.
A vous entendre, les entreprises ne s’en sortent pas si mal ?
PLR – Oui.
Ne nous leurrons pas. Le Conseil de prud’hommes a un petit air de lutte
des classes. Si les entreprises ne s’y retrouvaient pas globalement il
y a longtemps que, au gré des majorités gouvernementales sensibles à
leur cause, les litiges du travail auraient été confiés à une
juridiction ordinaire composée de magistrat(e)s professionnel(le)s.
Desquels le patronat a sans doute plus à craindre que des conseillers
prud’hommes salariés avec lesquels il cohabite au sein de la
juridiction du travail. On peut en effet facilement imaginer une
application du droit trop livresque par des juges n’ayant souvent
jamais mis les pieds dans une entreprise. Un remède qui de ce point de
vue serait pire que le mal tout relatif prêté aux Prud’hommes.
Après
cet état des lieux général, ce qui va intéresser (inquiéter le cas
échéant) nos lecteurs, c’est comment assurer la pérennité de son
expérience entrepreneuriale si d’aventure un salarié attaque ? En
gagnant, puisque a priori il va sans doute gagner, il va mettre à genoux l’entreprise ?
PLR – Oui
et non. Plutôt non d’ailleurs ! C’est assez simple. Il ne faut pas
commette d’erreur même si ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut
surtout pas pratiquer l’abus de droit dans sa relation avec un salarié.
En voyant poindre un litige, il faut veiller à bien le cerner, à en
mesurer la portée, et se modérer, concilier ou transiger.
La
plupart des litiges venant devant la juridiction prud’homale reposent
sur une rupture du contrat de travail, un licenciement quoi !
Contrairement à ce qu’on croit, à ce qu’on dit, à ce qu’on répète à
l’envie, le droit de licenciement est relativement libre. Il y a même
un article spécifique du Code du travail pour ça (L.1231-1) : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur (…) ».
Mais
il y a des règles, des interdits parfois, une procédure à suivre. Et
surtout, il faut un motif réel et sérieux. La décision d’un
licenciement ne peut pas, ne doit pas, reposer sur la seule bonne ou
mauvaise humeur de l’employeur ! C’est ce motif que les
conseillers prud’homaux examineront en fonction des éléments qui leurs
seront apportés par chaque partie (et d’abord par le salarié licencié)
pour qu’ils en fassent à leur tour une appréciation souveraine comme le
leur demande le Code du travail.
C’est vite dit, ça ! Quid de
la situation économique de l’entreprise qui ne va pas bien, qui ne se
développe pas comme prévu, qui fait face à l’adversité, à la
concurrence… Quand on ne peut plus payer un salarié, il faut bien s’en
séparer.
PLR – Oui.
Je ne vais pas dire que c’est bien. Mais c’est comme ça effectivement.
Il y a d’ailleurs très peu de motifs économiques de licenciement
débattus devant la juridiction prud’homale. Bon an, mal an, pas plus de
2 % des saisines ! Ce qui prouve bien que, lorsque ça va mal,
les salariés en sont bien conscients aussi et font le deuil de la perte
de leur emploi.
Aujourd’hui,
les licenciements pour motif économique sont bien cernés par la
législation. L’employeur qui s’inscrit dans cette définition, dans les
circonstances factuelles ainsi énumérées (L.1233-3 du Code du travail)
n’a guère à craindre que sa décision soit retoquée et financièrement
sanctionnée au profit de son ex-salarié.
Vous nous dites donc qu’un entrepreneur ne doit pas (ne devrait pas) craindre d’embaucher à durée indéterminée ?
PLR – Oui,
bien sûr. Il prend toujours le risque de ne pas pouvoir assurer la
pérennité de l’emploi créé si les résultats ne sont pas là mais il ne
doit pas pour autant craindre de ne pas pouvoir se séparer du salarié
si nécessaire (proprement et dans le respect de ses droits !). Le
salarié licencié pour motif économique aura d’ailleurs une priorité
légale de réembauchage dans l’année si les affaires reprennent, ce
qu’il ne faudra pas oublier.
Pourtant, par prudence, l’entrepreneur préfère souvent recourir à un contrat à durée déterminée, le temps de bien voir venir.
PLR – Oui
et il expose ainsi son entreprise à de sacrés revers économiques si les
affaires ne marchent pas. Car embaucher un salarié pour 3 mois, pour 6
mois, pour 12 mois voire plus (attention aux motifs légaux de recours à
ces C.D.D. et à leur durée cumulée), c’est s’obliger à honorer le
contrat de travail jusqu’au dernier jour, tout au moins verser la
rémunération correspondante même s’il n’y a plus ou pas suffisamment
d’activité, de chiffre d’affaires et de recettes. Ledit contrat ne
pouvant être rompu par l’employeur qu’en cas de faute grave, de force
majeure ou d’inaptitude du salarié, exit le motif économique aussi
réel et sérieux soit-il. Vraiment pas une bonne affaire !
Mais
si, au-delà de difficultés économiques, ça ne va pas / plus bien avec
le salarié embauché à durée indéterminée, que faire ?
PLR – On entre là dans un
motif dit personnel de licenciement. Faute, inaptitude, absences
répétées désorganisant l’activité, refus d’une modification
substantielle du contrat de travail au travers de laquelle l’employeur
exerce son pouvoir d’organisation, insuffisance professionnelle,
incompatibilité d’humeur, objectifs (raisonnables) non atteints… C’est
le quotidien des contentieux portés devant la juridiction prud’homale.
Ces motifs liés à la personne du salarié et totalement extérieurs au
contexte économique, c’est 98 % des litiges.
On
peut assimiler ça à un divorce. Le salarié, celui qui a été embauché en
concurrence certainement avec d’autres candidat(e)s c’était le
meilleur, le plus compétent, le plus qualifié… Et puis, cabane sur le
chien, du point de vue de l’employeur il s’avère à un certain moment
que ça ne serait pas vraiment ça !
Quel conseil donnez-vous alors ?
PLR – Surtout,
pas de précipitation ! Pas de décision à l’emporte-pièce reposant
comme évoqué plus haut sur la mauvaise humeur du jour. Mis à part
l’inaptitude qui relève de quelque chose de très factuel, puisque
décision du Médecin du travail, avec obligation toutefois pour
l’employeur de rechercher un reclassement ou un aménagement de poste
(ce qui ne sera pas toujours objectivement possible), les autres motifs
personnels s’accommodent tous de donner du temps au temps.
Le
salarié a commis une faute ? Le lui signifier, entendre ses
explications. Cette faute n’est le plus souvent pas volontaire. Et de
bonne foi, le salarié fera amende honorable et veillera certainement à
ne pas la commettre de nouveau.
Il
n’atteint pas les objectifs attendus ? Il est d’humeur exécrable
dans les relations de travail, avec son employeur, ses collègues, les
clients ? Faire les mises au point. Essayer de comprendre ce qui
se passe. Exiger une amélioration et attendre au moins un peu.
Et
si ce problème personnel perdure il sera suffisamment temps pour
l’employeur de prendre la mesure de licenciement qui lui semblera
s’imposer (dans un délai suffisant pour mesurer des effets).
Devant
la formation de jugement d’un Conseil de prud’hommes ordinaire, ce
temps donné au temps, cette chance laissée mais pas saisie, viendront
étayer et consolider la cause réelle et sérieuse que l’employeur
plaidera alors aisément. Alors qu’une décision trop rapide, trop
irréfléchie, se révèlera souvent assez périlleuse (d’où les 70 %
de salariés demandeurs qui gagnent leur procès !).
Vous nous faites rêver avec ce monde des Bisounours…
Mais si quand même l’entreprise est condamnée pour un licenciement jugé
sans cause réelle et sérieuse. Adieu, veau, vache, cochon… Les
indemnités à payer vont la mettre à genoux.
PLR – Eh
bien non ! Enfin, probablement non. La grande affaire des réformes
récentes du Code du travail et de la procédure prud’homale a d’ailleurs
été de donner de la sécurité juridique aux employeurs (y compris ceux
qui ne respecteraient pas les règles) en limitant et encadrant les
indemnités.
Ah oui ! Le barème Macron. De quoi s’agit-il exactement ?
PLR – L’encadrement
de l’indemnisation d’un licenciement jugé abusif ou sans cause réelle
et sérieuse. Il s’agit de ce qu’on nomme en effet le barème Macron dans
sa version de 2018, bien que les premières esquisses remontent à la
précédente législature. Ce n’est pas que du Macron, en tant que
Président de la République !
Pour
faire simple, deux paramètres : la taille de l’entreprise et
l’ancienneté du salarié. Il en sortira une indemnisation minimale (qui
peut vraiment être pingre) et surtout maximale à retrouver dans
l’article L.1235-3 du Code du travail.
Notre
propos étant surtout ici celui de la petite ou même micro-entreprise,
c’est dans la pratique un risque qui ne dépasse pas 2 ou 3 mois de
salaire. Et cela s’entend pour des licenciements sans réel motif ou
sans motif suffisamment sérieux. Il y n’a que des ruptures du contrat
de travail contraires à l’ordre public social (discrimination,
harcèlement, atteinte à une liberté fondamentale, ...) avec lesquelles
il convient bien entendu de ne pas essayer de jouer qui peuvent
conduire aux foudres de la juridiction avec sanctions en rapport en
monnaie sonnante et trébuchante et d’un autre niveau.
Le
mieux pour l’entrepreneur sera donc de ne pas rompre un contrat de
travail sans avoir assuré ses arrières et être sûr des éléments
factuels qu’il retient pour prendre et étayer sa décision. Mais
quoiqu’on en dise, il dispose d’une large liberté de prendre la
décision qu’il croit devoir prendre. Et ceci, en l’état de la
législation, avec un risque limité, connu même à l’avance !
Imaginons
l’automobiliste qui franchirait délibérément un carrefour au feu rouge
au risque de renverser un piéton et qui, connaissant d’avance la
réparation due à la victime fauchée, se dirait qu’elle est dans ses
moyens. Dans l’esprit, le barème c’est ça avec pour objectif d’assurer
de la sécurité juridique à l’employeur même quand il est imprudent ou
commet des infractions. On comprend que ça fasse débat.
Il n’y a pourtant pas de licenciement gratuit ?
PLR – Si !
Le licenciement pour faute grave et de surcroit pour faute lourde. L’un
et l’autre sont privatifs de préavis et de toutes indemnités de rupture.
Quelle différence ? Et qu’est ce qu’une faute grave ?
PLR – Sur
la privation des indemnités de rupture, aucune. La faute grave est
celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y
compris pendant le temps limité du préavis. La faute lourde implique en
outre la volonté délibérée de nuire du salarié. Il fut un temps où
cette faute lourde le privait aussi du paiement de ses congés payés qui
restaient encore à prendre mais c’est aujourd’hui caduc.
C’est vague comme définition. Il n’y en a pas de plus précise ?
PLR – Non.
Tout est affaire de circonstances, de contexte, d’appréciation de
l’employeur. C’est d’ailleurs lui qui décide que telle ou telle faute
est grave. Ceci sous le contrôle et la propre appréciation souveraine
du Conseil de Prud’hommes si d’aventure la juridiction du travail est
saisie par le salarié qui conteste ce caractère de gravité (le
sérieux), si ce n’est la faute elle-même (le réel).
En fait, l’employeur choisit son terrain juridique.
PLR – Exactement
et à ses risques et périls juridiques, encadrés comme on l’a évoqué
précédemment. Licenciement pour motif économique bien circonstancié ou
encore pour une cause quelconque qui lui apparaitra réelle et sérieuse
avec les indemnités légales que de droit ou sans indemnité aucune. Ce
sont surtout ces ruptures brutales du contrat de travail avec pertes et
fracas, sans préavis, sans indemnité, qui viennent devant le Conseil de
Prud’hommes à l’initiative du salarié qui s’estime lésé.
Et ça se passe comment alors ?
PLR – Le
salarié prendra l’initiative du procès prud’homal. Ce sera le demandeur
de réparations indemnitaires Dans son esprit, le salarié entame la
procédure pour se défendre de la décision prise à son encontre mais en
fait, dans la logique juridique, c’est lui qui attaque. C’est
l’employeur qui va se défendre.
Pour lequel des deux ce sera a priori le plus difficile ?
PLR – Partons du principe, puisque c’est notre propos, que les deux sont nuls sans rien de péjoratif envers l’un ni envers l’autre.
Le
premier à devoir constituer et structurer son dossier, étayer par des
faits ses demandes, les justifier en droit, ce sera le salarié. Le
greffe du Conseil de Prud’hommes lui fournira sans explications un
formulaire de six pages avec pas moins d’une centaine de
rubriques ! Seul devant ce formulaire de saisine, un salarié
commet déjà souvent à ce stade beaucoup d’erreurs. Il demande parfois
ce à quoi il ne pourra probablement pas avoir droit. Il omet ce à quoi
il pourrait avoir droit. Il en demande trop ou pas assez en ignorant
les limites du barème. Il est déjà confronté à ce stade à toutes sortes
de traquenards et chausses trappes juridiques. S’il en demande trop, le
Conseil de Prud’hommes ne manquera pas de repasser derrière pour
réduire. Mais s’il omet ou sous-estime quelque chose eh bien ça sera
tant pis pour lui. Dure est la loi, mais c’est la loi…
Le
salarié fera souvent appel à un défenseur syndical (s’il est adhérent
d’une organisation, moins facilement s’il ne l’est pas et la plupart ne
le sont pas). Ou à un avocat. Les assurances en protection juridique
facilitent grandement le recours à cette assistance d’un homme ou d’une
femme de loi. Toujours est-il que ça reste a priori suffisamment
difficile pour qu’on constate que
depuis les réformes qui ont ajouté beaucoup de formalisme à la
procédure prud’homale, il y a en rythme de croisière 40 % de
saisines en moins. Cela ne veut pas dire qu’il y a moins de
licenciements, qu’ils sont moins litigieux. Cela veut dire que c’est un
peu trop difficile pour le salarié lambda ou que le jeu n’en vaut pas
la chandelle et qu’il renonce.
Quand
le salarié sera allé au bout de sa saisine, ce sera au tour de
l’employeur de préparer sa défense. Ce sera évidement d’autant plus
facile pour ce dernier que la décision contestée devant le tribunal
aura été prise en parfaite connaissance de cause, dans le respect des
règles. Lui-aussi pourra faire appel à un conseil juridique. Avec
l’écueil parfois que les frais dépassent les enjeux du procès. Il
pourra alors être opportun pour l’employeur de rechercher un possible
accord avec la partie adverse. La phase première de la procédure
prud’homale, c’est d’ailleurs la recherche d’une conciliation même si
elle n’a pas beaucoup de succès dans la pratique. Les parties parfois
mal renseignées, mal avisées, restent en effet souvent, envers et
contre tout, droites dans leurs bottes. Et ça les conduit à devoir
payer ensuite le prix de leur ignorance. C’est comme un divorce. On ne
connait pas beaucoup de couples non plus qui se réconcilient.
D’où l’intérêt, comme vous l’avez déjà souligné, d’un licenciement propre.
PLR – Oui,
un licenciement réfléchi. Qui ne privera pas le salarié de son emploi
pour le moindre écart ponctuel. L’employeur lui-même ne commet-il pas
des erreurs ? On apprend de ses erreurs.
Et
s’il s’agit d’un problème économique, ne pas essayer de le camoufler
derrière des motifs personnels inhérents à la personne du salarié, avec
des circonstances montées de toutes pièces afin de ne pas lui verser
les indemnités légales que de droit et en s’obligeant à la priorité de
réembauche si les affaires venaient à reprendre.
Créer
un emploi, c’est s’assurer que le salarié pourra être rémunéré chaque
mois de son travail. C’est aussi assurer ses arrières en matière de
trésorerie pour pouvoir rompre le contrat de travail dans les règles.
Et
pour pouvoir licencier proprement en indemnisant immédiatement un
salarié de ce que de droit s’il y a lieu, il faut bien entendu veiller
à toujours avoir dans sa trésorerie les sommes nécessaires pour
financer cette rupture. Ne pas attendre que l’entreprise soit exsangue,
incitant à monter de toutes pièces un motif de licenciement inhérent au
salarié le privant de ces indemnités (faute grave ou lourde) et qui
risque d’être bien difficile à soutenir à la barre puisque, par nature,
sans cause réelle et sérieuse. Entrainant donc par la suite des
indemnisations plus conséquentes qui là, pour le coup, risquent
réellement d’ajouter des difficultés à la petite ou micro-entreprise.
Merci Patrick Le Rolland pour vos explications et cet ouvrage de vulgarisation : « Les prud’hommes pour les nuls »
qui répond à toutes les questions que salariés et employeurs peuvent se
poser. Y compris les questions auxquelles ils n’ont même pas
pensé !
Des délais pour agir
Conclusion et exécution du contrat de travail : 2 ans.
Rupture du contrat de travail, licenciement : 1 an.
Paiement du salaire : 3 ans.
Discrimination, harcèlement : 5 ans.
Dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte : 6 mois (forclusion).
Les étapes de la procédure
Saisine : requête listant et chiffrant les demandes avec un exposé sommaire.
Tentative de conciliation (sauf cas expressément prévus par la loi tel redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise).
Eventuelle ordonnance pour l’exécution immédiate de mesures non sérieusement contestables.
Communication et échanges de pièces entre
les parties en litige (preuves, justificatifs, arguments et
raisonnements juridiques) sous le contrôle de la juridiction (mise en
l’état).
Orientation de l’affaire en absence de conciliation vers :
- un
bureau de jugement (formation paritaire normale à 4 conseillers soit 2
du collège des employeurs et 2 du collège des salariés) ;
- exceptionnellement,
un bureau de jugement en composition restreinte (2 conseillers, un de
chaque collège sous réserve d’accord des parties) ;
- exceptionnellement
encore, un bureau de jugement à 4 conseillers, présidé par un magistrat
professionnel rompant le paritarisme (à la demande des parties ou si la
nature du litige le justifie) ;
- débats à la barre (réputés oraux même si les écrits préalablement échangés restent…) ;
- jugement (en premier ou dernier ressort selon le montant des demandes et leur nature) ;
- éventuel
jugement en départage (sous présidence magistrat professionnel) si
absence de majorité au sein du bureau de jugement.
En
alternative, une procédure rapide en référé – devant 2 conseillers –
pour une décision provisoire en cas d’urgence, d’évidence et d’absence
de contestation sérieuse.
Des demandes fréquentes
- Indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement ;
- Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- Indemnité (dommages et intérêts) pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis ;
- Arriérés et rappels de salaire (taux horaire, heures supplémentaires, assiette des congés payés…) ;
- Primes diverses, commissions…
- Remise de documents conformes : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi…
Texte issu d'un article initialement paru sur le site des éditions juridiques.
*
Bloqué au Maroc à cause du confinement, il découvre son licenciement à son retour en France. Analyse de Patrick Le Rolland.
Le magazine Capital vient de publier cette info :« Un employé de la société Etanco à Aubergenville (Yvelines) a été licencié pour faute grave après être resté coincé pendant cinq mois au Maroc.
Après 30 ans de bons et loyaux services, Brahim Kiou, 50 ans, a appris, le 27 août dernier, qu'il était licencié pour faute grave. Son employeur, la société Etanco à Aubergenville (Yvelines), spécialisée dans la fabrication de fixations pour le bâtiment, lui reproche d'avoir abandonné son poste, rapporte 78actu. Le 8 mars dernier, Brahim Kiou est parti en vacances au Maroc pour 10 jours, mais la crise du Covid-19 est passée par là. L'employé, par ailleurs chef d'équipe, s'est alors retrouvé bloqué sur place pendant cinq mois. À son retour en France, fin août, il découvre dans sa boîte aux lettres, un courrier de licenciement. "Je n'étais absolument pas au courant. Cela a été un choc. Tout m'est tombé sur la tête d'un coup", confie-t-il.
Outre l'abandon de poste, Etanco lui reproche de ne jamais avoir répondu à ses courriers. "À la date du 11 août 2020, il nous était impossible de comprendre son comportement. En effet, il disposait d’un téléphone d’entreprise en parfait état de fonctionnement, il nous a fait parvenir des arrêts maladie couvrant les premiers mois passés au Maroc - donc la Poste fonctionnait -, il n’y avait aucune raison valable à son absence totale de communication. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et plus de trois mois après le dernier contact, nous avons pris la décision de le licencier", précise la société.
Brahim Kiou affirme pour sa part être parti sans son téléphone professionnel et avoir rencontré de grosses difficultés à trouver une place sur un vol retour. "Les seuls courriers que j'ai pu envoyer, ce sont les arrêts maladie par l'intermédiaire de mon médecin. Ensuite, mon téléphone personnel a été coupé. Mon fils est allé voir mon directeur pour lui demander de me mettre en chômage partiel, il a refusé", affirme le quinquagénaire. Une défense que son employeur peine à croire.
Malgré un rendez-vous avec sa direction, Brahim Kiou n'a pas réussi à obtenir gain de cause et va devoir également quitter son logement de fonction le 12 octobre prochain. "Je n’ai plus d’argent et je n’ai nulle part où aller avec ma compagne et mon fils de six ans. J’ai beaucoup donné pour cette entreprise et voilà ma récompense. Je suis tombé en dépression nerveuse, je n’arrive plus à dormir", insiste-t-il.
Dans sa bataille, Brahim Kiou peut compter sur le soutien du délégué syndical CGT, Philippe Gommard. "La priorité pour nous aujourd'hui, c'est qu'il reste dans son logement de fonction. On va tout faire pour qu'il reste dans son logement, car il n'a pas de revenu, pas encore de pôle emploi, il est complètement bloqué. On sera là pour la venue de l'huissier. C'est vraiment un licenciement abusif", estime-t-il dans les colonnes du Figaro. L'ex-chef d'équipe a saisi les Prud'hommes le 24 septembre. Le jugement devrait être rendu le 2 novembre prochain ».
*
Mort d'un sous-traitant : La Poste condamnée en appel pour prêt de main-d’œuvre illicite
Un sous-traitant de Coliposte avait chuté dans
la Seine en tentant de récupérer un colis livré sur une péniche. La
Poste va se pourvoie en cassation
*
Hausse du taux de compétence d'appel : de 4000 € à 5 000 €
À partir du 1er septembre 2020, pour toute saisine prud'homale, il ne
sera possible de faire appel que pour de affaires dont le montant est au moins
égal à 5000 €. En deçà, l'affaire n'ira pas
en appel, mais directement en Cour de cassation.
Décret 2020-1066 du 17 août 2020.
*
Évaluation des ordonnances du 22 septembre
2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail
Rapport intermédiaire du comité d'évaluation
Rédigé par France-Stratégie
en juillet 2020.
Page 87 du rapport :
Le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle
et sérieuse
L'ordonnance n°2017-1387 prévoit plusieurs dispositions relatives
aux règles de licenciement.
La loi Travail du 8 août 2016 avait précisé la définition
du motif économique du licenciement, à partir de la jurisprudence
établie (cessation d'activité de l'entreprise et réorganisation
de
l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité). Elle
avait également défini les difficultés susceptibles de
justifier un licenciement économique (baisse des commandes ou du
chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ; importante dégradation
de la trésorerie ou tout élément de nature à justifier
de ces difficultés).
L'ordonnance de 2017 définit quant à elle le périmètre
d'appréciation de la cause économique.
Il est ainsi prévu que les difficultés économiques, les
mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité
de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle
n'appartient pas à un groupe. Dans le cas contraire, ces causes s'apprécient
au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et à
celui des entreprises du groupe auquel elle
appartient, établies sur le territoire national. Enfin l'ordonnance introduit
également des simplifications sur les règles de procédures
du licenciement individuel et de sa motivation, la
création d'un modèle-type de lettre de licenciement et surtout
la mise en place d'un barème applicable par les juges en cas de licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions font l'objet d'un suivi de leur mise en œuvre (en particulier
pour le barème) et des travaux d'évaluation de leurs effets, commandés
par le comité, sont en cours de réalisation.
Le contexte : la mise en œuvre du barème et le débat
juridique
L'ordonnance n°2017-1387 créé un barème applicable
pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse qui encadre
les indemnités fixées par le juge en définissant des montants
minimaux et maximaux (déterminés en mois de salaires). Il remplace
le référentiel indicatif d'indemnisation créé par
le décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016, en application de la loi
du 6 août 2015.
Ce barème obligatoire, codifié à l'article L. 1235-3 du
code du travail, fixe des montants qui varient en fonction du nombre de salariés
dans l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.
Suite à sa mise en œuvre le 24 septembre 2017, il a fait l'objet
de contestations juridiques portées devant les conseils des prudhommes
(CPH). Plusieurs conseils ont rendu des
décisions en fixant des montants qui s'écartaient de ce barème.
Le débat juridique soulevé est celui de la conformité de
ces dispositions à plusieurs textes internationaux et en particulier
aux
dispositions suivantes :
- l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui
prévoit " le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée " en cas de licenciement injustifié ;
- l'article 24 de la Charte sociale européenne qui impose " le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée " ;
- l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
La question posée est double : ces textes sont-ils applicables directement
aux cas de litiges traités par les CPH et si oui les nouvelles dispositions
sont-elles conformes à ces textes
internationaux ratifiés par la France ?
Saisi d'une requête en référé-suspension contre l'ordonnance,
le Conseil d'État a jugé dans une décision du 7 décembre
2017 la conformité de ces dispositions. Dans une décision du
Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, celui-ci a également jugé
ces dispositions conformes à la constitution.
Postérieurement, la Cour de Cassation a été saisie par
deux tribunaux (Conseil de prud'hommes [CPH] de Louviers et de Toulouse) pour
avis. La Cour de Cassation réunie en
formation plénière (avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019)
a reconnu recevables ces demandes d'avis formulées sur les compatibilités
entre les nouvelles dispositions législatives
et les normes européennes et internationales visées, pour assurer
" une unification rapide des réponses apportées " (note
explicative, Demande d'avis n° R 1970010 et S 1970011). La Haute
juridiction a considéré que les nouvelles dispositions relatives
au barème n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6
§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 24
de la Charte sociale européenne révisée étaient
dépourvues d'effet direct horizontal en droit interne pour les affaires
jugées entre particuliers ; et que les nouvelles dispositions étaient
compatibles avec l'article 10 de la convention n°158 sur le licenciement
de l'OIT, qui est lui d'application directe en droit d'appréciation.
Suite à cet avis, certains CPH considérant qu'il s'agissait d'un
simple avis donné in abstracto et non d'une décision au fond,
ont décidé d'écarter le barème en raison des circonstances
du
licenciement et de critères liés à la personne licenciée
(CPH de Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267). La Cour d'appel de Reims
a retenu le principe de la conformité du barème avec
les textes internationaux, tout en admettant la possibilité pour le salarié
d'établir in concreto que l'application du barème porte une "
atteinte disproportionnée à ses droits ". Selon la Cour
d'appel de Paris qui retient la conformité du barème, le juge
garde une marge de manœuvre et peut, au regard des spécificités
de l'affaire qui lui est soumise, vérifier si l'indemnisation
plafonnée par ce barème est conforme à l'exigence d'une
indemnité "adéquate" ou d'une réparation "appropriée"
prévue par ces textes internationaux. (Cour d'appel de Paris, 18
septembre 2019, n°17/06676).
À ce stade, le juge peut donc s'extraire du barème dans deux cas
:
- selon la loi (art. L.1253-3-1 du code du travail), en cas de nullité
du licenciement pour cause de violation d'une liberté fondamentale, de
harcèlement, de discrimination, et pour les
salariés protégés ;
- selon ces arrêts de cours d'appel, en fonction du cas d'espèce,
si l'indemnité fixée par le barème n'apparaît pas
adéquate et appropriée.
Deux décisions concernant l'interprétation de ces normes sont
encore attendues : celle du Comité européen des droit sociaux
saisi le 7 septembre 2018 par la CGT sur la conformité du
barème à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée,
et surtout le premier arrêt de la Cour de Cassation qui sera rendu sur
le fond d'une affaire.
Si le débat juridique est toujours en suspens, le barème a néanmoins
été mis en œuvre dans d'autres décisions de CPH depuis
2017 et la question de ses effets peut se poser dès à présent,
y compris pour s'interroger sur la motivation à contester une décision
de licenciement.
Les questions soumises à l'évaluation.
Les questions soulevées par le barème dans le cadre de l'évaluation
sont diverses et de différents ordres :
Observe-t-on des évolutions dans l'appréciation du préjudice,
dans les motifs de contestation du licenciement (tendance à invoquer
plus souvent des motifs de nullité tel que discrimination, harcèlement)
ou dans le nombre de demandes venant compléter une requête (multiplication
des chefs de préjudice invoqués au-delà de la seule contestation
de la cause réelle et sérieuse du licenciement) ? In fine observe-t-on
un effet sur l'évolution de la part du CDI dans les embauches, sur la
part des licenciements dans les ruptures, et plus généralement
sur le dualisme du marché du travail, l'emploi et la performance des
entreprises ?
Différents travaux de suivi et d'évaluation sont menés
sur ces sujets par le comité.
Évolution du nombre de recours et du taux de recours
Les bases de données (RGC) du ministère de la Justice permettent
de suivre régulièrement l'évolution du nombre de contentieux
devant les CPH. L'ordonnance n°2017-1387 du 22
septembre 2017 est entrée en vigueur dans un contexte déjà
avéré de baisse du nombre de recours devant les CPH (note1).
Un rapport (note2 )publié en juillet 2019 par le ministère de
la Justice retrace et étudie les évolutions de ce contentieux
de 2004 à 2018. Ces données ont été complétées
et actualisées pour le
comité d'évaluation.
En dix ans, le nombre de recours formé devant les CPH a été
divisé par près de deux. Ce mouvement de baisse s'est accentué
en 2016, année de l'entrée en vigueur (1er août 2016) du
décret du 20 mai 2016 réformant la procédure prud'homale.
Le nombre de saisine a diminué de 18 % entre 2015 et 2016 puis de 16
% de 2016 à 2017. Entre temps, le barème indicatif
prévu par la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques est entré en
vigueur en novembre 2016 (note 3), sans que l'on puisse lui associer un
effet propre sur l'évolution des recours. À partir de 2018, le
mouvement de baisse s'est poursuivi de manière moins soutenue : le nombre
de recours a reculé de 5% en 2018 par
rapport à l'année précédente et de 1 % en 2019,
par rapport à 2018.
Le pic observé en 2013 est lié à l'entrée en vigueur
de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, faisant
passer le délai des actions personnelles de trente à cinq ans,
et à ses
conséquences sur le contentieux spécifique relatif à l'anxiété
des salariés exposés à l'amiante (note 4).
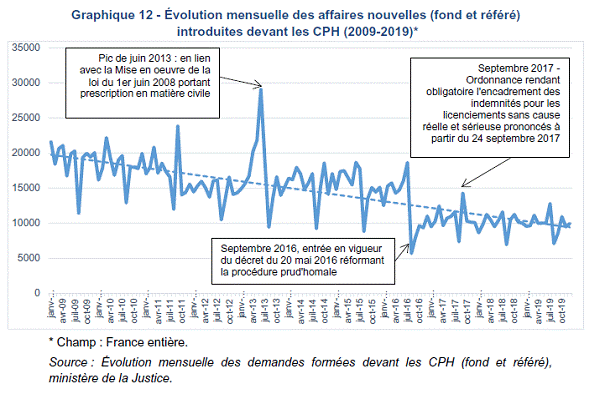
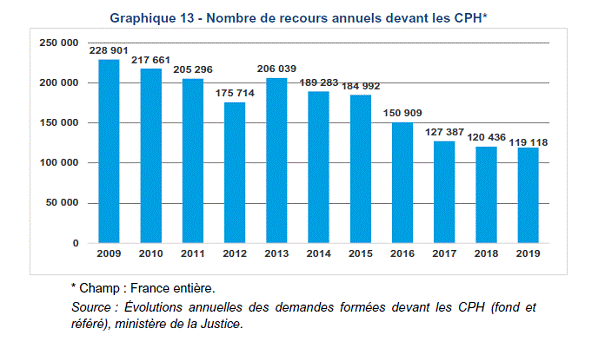
Cette baisse moyenne des actions masque de fortes disparités selon les
CPH. Elle est également inégale selon les sections. Dans la section
encadrement, le nombre d'actions a
augmenté. L'ampleur de la baisse du nombre de recours varie selon les
territoires, les conseils les plus importants étant les moins impactés,
notamment en raison du poids croissant de la
section encadrement, ce qui conduit à accélérer la concentration
géographique des affaires.
En 2017, les trois-quarts des affaires sont traitées par un tiers des
juridictions prud'homales.
On notera que cette baisse du nombre de recours s'inscrit plus largement dans
un contexte judicaire de baisse du contentieux civil, mais avec des tendances
spécifiques.
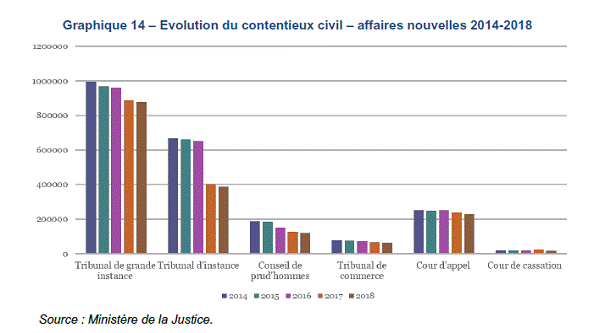
Les nouvelles affaires portées devant les CPH sont de
plus en plus de nature contentieuse.
Les conditions de traitement des affaires nouvelles qui se terminent aux prud'hommes
attestent d'une judiciarisation croissante à partir de 2010 : hausse
de la représentation par un avocat (note 5)
et de la part des décisions qui tranchent le litige. Néanmoins,
parmi les affaires terminées sans décision statuant sur la demande
(note 6), on constate ces deux dernières années une augmentation
de la part de celles impliquant un accord des parties. Cette part qui était
de 48,9 % en 2017 passe à 55,1 % en 2018 et 57,6 % en 2019.
On note aussi, pour les décisions statuant sur la demande, une baisse
de la part des jugements favorables aux demandeurs depuis 2014 (71,9 % en 2014
et 64,3 % en 2019).
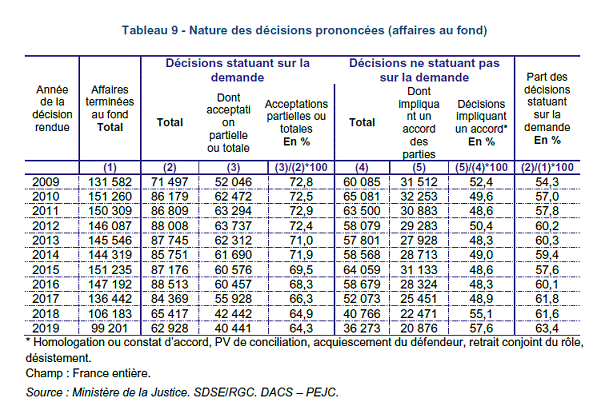
La période 2009-2017 est marquée aussi par une hausse moyenne
des délais moyens de traitement, indicateur qui pourrait indiquer une
conflictualité croissante des affaires soumises.
Néanmoins à partir de 2018, on note un infléchissement
de cette tendance.
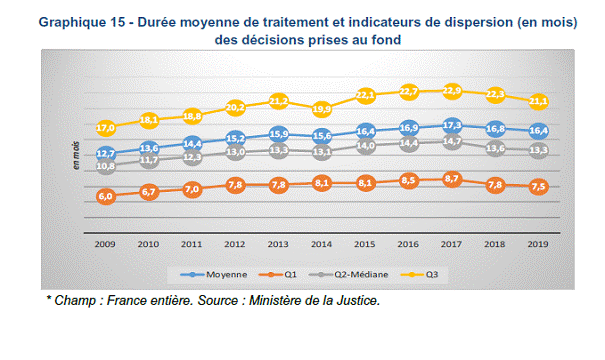
Enfin, on constate une baisse des taux d'appel en 2017 sur les décisions
prud'homales rendues au fond comme en référé. Elle est
concomitante à la modification de l'article R 1461-2 du code
du travail (décret n°2016-660 du 20 mai 2016) qui prévoit
que désormais l'appel est " formé, instruit et jugé
suivant la procédure avec représentation obligatoire " et
s'est poursuivie en
2018 (leur part recule de 62,2 % en 2016 à 56,2 % en 2018).
Au-delà d'une variation du nombre de recours en lien avec les évolutions
de procédures, d'autres évolutions législatives et économiques
ont pu jouer de façon plus structurelle,
notamment la création de la rupture conventionnelle en 2008. C'est ce
que l'on cherche à estimer en calculant des taux de recours des personnes
licenciées.
On peut par exemple calculer ce taux de recours devant les prud'hommes, en
rapportant le nombre contentieux au nombre des salariés inscrits à
Pôle emploi après un licenciement. Ce
taux varie au cours de la période : il augmente à partir de 2009,
paradoxalement année de mise en œuvre de la rupture conventionnelle,
passant de 25 % à plus de 30 %. L'augmentation
du taux de recours des salariés licenciés pourrait s'expliquer
par le fait que les séparations qui n'ont pu être négociées
dans le cadre d'une rupture conventionnelle recelaient un potentiel
contentieux plus élevé. Cette hausse a compensé la baisse
qui aurait pu résulter de licenciements moins nombreux et de la très
faible conflictualité propre à la rupture conventionnelle.
Épousant également les fluctuations conjoncturelles du marché
du travail jusqu'en 2015 (taux de recours autour de 30 %), le mouvement s'inverse
nettement à partir de 2016 avec une
tendance à la baisse continue du taux de recours jusqu'à 20 %
en 2018. L'explication de cette baisse ? moins 5 points entre 2015 et 2016 et
moins 4 points entre 2016 et 2017 ? pourrait se
trouver dans les évolutions législatives et règlementaires
en particulier le décret du 20 mai 2016 qui modifie la procédure
prud'homale (note 7). À partir de 2017, la baisse se poursuit mais à
un
moindre rythme. " Ainsi, la baisse de la propension à agir s'est
ajoutée à la baisse continue des licenciements, pour réduire
mécaniquement le nombre de contestations du motif de la
rupture "(note 8).
Notes :
1/ Si les évolutions quantitatives de recours devant les CPH présentent
des spécificités, il convient de noter que cette baisse s'inscrit
dans un contexte généralisé de baisse des affaires nouvelles
devant l'ensemble des juridictions (à l'exception du contentieux devant
le juge des enfants).
2/Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de 2004 à
2018. Baisse des demandes, concentration des litiges, juridictionnalisation
de leur traitement. Rapport établi en collaboration avec Evelyne Serverin,
Directeur de recherche émérite au CNRS, ministère de la
Justice, direction des Affaires civiles et du sceau, juillet 2019.
3/ Décret 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel
indicatif d'indemnisation.
4/ " Ce droit à indemnité a été reconnu par
la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt de principe du
11 mai 2010, au bénéfice des travailleurs dont l'entreprise a
été inscrite par arrêté sur la liste des établissements
permettant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante (article 41 de la loi n°
98-1194 du 23 décembre 1998). Or avec l'entrée en vigueur de la
loi du 17 juin 2008 (…), les salariés dont les entreprises avaient
fait l'objet d'un arrêté d'inscription antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi de 2008 ne pouvaient former un recours
que jusqu'au 19 juin 2013 ". Les affaires prud'homales dans la chaîne
judiciaire, op. cit.
5/ Cf. " Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire ",
op. cit., p. 35.
6/ Cette catégorie regroupe les conciliations, homologations ou constats
d'accord, acquiescements des défendeurs, retraits conjoints du rôle,
désistements des demandeurs ; elle est un indicateur de la " propension
à négocier ".
7/ Ce décret prévoit notamment de nouvelles obligations sur la
façon de formuler une requête et sur les pièces qui doivent
l'accompagner dès le dépôt de la demande.
8/ Voir " Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de
2004 à 2018 ". Baisse des demandes, concentration des litiges, juridictionnalisation
de leur traitement. Rapport établi en collaboration avec Evelyne Serverin,
Directeur de recherche émérite au CNRS, ministère de la
Justice, direction des Affaires civiles et du sceau, juillet 2019, p. 24.
Source
Juillet 2020
*
COVID-19 : DEUX ORDONNANCES POUR AIDER LES PRUD'HOMMES À PASSER LE CAP DE L'ÉPIDÉMIE
Depuis que le " semi-confinement " lié à la propagation
du covid-19 est entré en vigueur, les conseils de prud'hommes de notre
pays connaissent, à l'instar des autres juridictions, de très
importantes difficultés de fonctionnement. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs
encore fermés.
Les salariés sont les premières victimes de cette situation puisqu'ils
se trouvent clairement atteints dans leur capacité à faire valoir
leurs droits. Dans le cadre de la loi d'urgence n°2020-290 du 23.03.20 pour
faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a
réagi face à ces difficultés de fonctionnement en prenant
deux ordonnances, qui ont très rapidement été publiées
au Journal officiel. C'était le 26 mars dernier.
État d'urgence sanitaire
Voilà le nouveau régime d'exception dans lequel notre pays est
entré le 24 mars. Et comme tout régime d'exception, il s'accompagne
d'une cohorte de mesures dérogatoires au droit commun ayant vocation
à s'appliquer tout au long de son existence provisoire.
Le fonctionnement de notre système judiciaire n'a pas échappé
à l'application de telles mesures dérogatoires. Ce qui n'est guère
étonnant puisque, depuis que le " semi-confinement " a été
imposé aux populations, les juridictions de notre pays sont pour ainsi
dire à l'arrêt.
La justice est en effet en tout premier lieu une activité humaine. Les
audiences qu'elle tient sont ouvertes au public et les juges sont, dans leur
activité quotidienne, au contact direct des justiciables et des personnes
chargées de les assister et de les représenter.
Cet aspect des choses prend d'ailleurs un relief tout particulier s'agissant
des conseils prud'hommes, puisque ces juridictions connaissent d'une "
procédure orale ". En période normale, cette oralité,
qui peut être vue comme une garantie d'accès au juge devient, en
période de contamination virale, un véritable ennemi de la santé
publique !
Il fallait donc trouver des solutions pour qu'en ces temps de contamination
par le covid-19, la justice en général, dont celle du travail,
ne soit pas, elle aussi, mise en quarantaine. C'est ce à quoi s'est appliqué
le Gouvernement en publiant ces ordonnances.
A noter ! Nous verrons cependant qu'en ce qui concerne les délais
(et, notamment, le délai de prescription), l'ordonnance n° 2020-306
a rétroactivement fait courir la période dérogatoire au
12 mars 2020.
Permettre au justiciable de ne pas être rattrapé
par une prescription à agir pendant la période d'état d'urgence
sanitaire
L'ordonnance n° 2020-306 précise que toute action en justice prescrite
par la loi ou par le règlement à peine de prescription et qui
aurait dû être accomplie pendant une période courant du 12
mars 2020 au 24 juin 2020 sera réputée avoir été
faite à temps si elle a été effectuée dans un délai
qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période,
le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Ainsi, les salariés pour lesquels la prescription à agir arrive
à échéance pendant cette période verront leur délai
pour agir " réactivé " au terme de cette période.
Faciliter le fonctionnement des conseils de prud'hommes pendant
la période d'état d'urgence sanitaire (+ 1 mois), soit du 24 mars
2020 au 24 juin 2020
L'ordonnance assouplit nombre des exigences formelles inhérentes à
la procédure. Ce, afin de faciliter la poursuite de l'activité
juridictionnelle des juridictions judiciaires non-pénales, au rang desquelles
figurent les conseils de prud'hommes.
C'est ainsi qu'elle rend possible :
- un échange entre les parties de leurs écritures et de leurs
pièces " par tout moyen ", dès lors que le juge a pu
s'assurer du respect du contradictoire ;
- avant l'audience et par ordonnance non contradictoire, un rejet des référés
introduits et ce, notamment, pour irrecevabilité de la demande ;
- sur décision du président de la juridiction, un déroulement
des débats " en publicité restreinte " et, en cas d'impossibilité
de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé
des personnes présentes à l'audience, un déroulement des
débats en chambre du conseil, à huis clos ;
- sur " décision du juge ou du président de la formation
de jugement ", une organisation de l'audience via " un moyen de télécommunication
audiovisuelle ", ou à défaut, via " tout moyen de communication
électronique, y compris téléphonique ", à la
condition toutefois que l'identité des parties puisse être vérifiée
et que la qualité de la transmission et de la confidentialité
des échanges puisse être assurée.
- sur " décision du juge ou du président de la formation
de jugement ", et dès lors que chacune des parties est assistée
ou représentée par avocat, un recours à une " procédure
sans audience ", c'est-à-dire exclusivement régie par l'écrit.
C'est ainsi qu'elle impose :
- pour les audiences (clôture d'instruction ou décision de statuer
selon la procédure sans audience) qui tombent pendant la période
d'état d'urgence sanitaire, un recours DE DROIT à une formation
restreinte du bureau de jugement (un juge employeur et un juge salarié).
Parer aux difficultés de fonctionnement d'un conseil
de prud'hommes
Et si malgré toutes ces facilités de fonctionnement, un conseil
de prud'hommes devait être dans l'incapacité de fonctionner en
tout ou partie, le Premier président de la cour d'appel concernée
désignerait une autre juridiction de même nature et du même
ressort pour connaître (en tout ou partie) de l'activité du conseil
de prud'hommes empêché.
La mise en œuvre de ces mesures doit cependant appeler toute notre vigilance,
car certaines d'entre-elles sont susceptibles de générer des abus.
Ainsi, par exemple, du tri rendu possible des dossiers préalablement
aux audiences de référé, qui pourrait rapidement devenir
un obstacle à l'accès au juge.
Pendant la période d'état d'urgence sanitaire
+ 1 mois, neutraliser le cours des astreintes et l'application des clauses pénales
ayant pris effet avant le 12 mars 2020
Ainsi, une clause pénale, ou une astreinte, qui serait en cours avant
le 12 mars 2020 se trouverait-elle figée pendant la période d'urgence
sanitaire + 1 mois.
Neutraliser les astreintes et les clauses pénales /
résolutoires qui auraient dû prendre cours ou produire effet pendant
la période d'état d'urgence sanitaire + 1 mois
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires
ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles
ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un
délai déterminé, sont réputées n'avoir pas
pris cours ni produit effet, si ce délai a expiré pendant la période
d'état d'urgence sanitaire + 1 mois.
On peut donc penser que ces astreintes prendront cours et que ces clauses ne
produiront leurs effets qu'à compter du 25 juin 2020.
Pour la CFDT, ces deux derniers points sont difficilement compréhensibles.
En effet :
- sur l'aspect " clause pénale ", cette disposition interroge
par rapport à la cohérence de sa mise en œuvre. Prenons en
effet l'exemple d'un contrat de travail qui s'est cassé il y a 10 mois
et dont la clause de non-concurrence (assortie d'une clause pénale) est
encore en application. La période d'état d'urgence sanitaire ne
dispensant pas le salarié de rechercher un nouvel emploi, faut-il en
déduire que durant cette même période le recrutement d'un
salarié - pourtant tenu par une clause de non-concurrence - par une entreprise
concurrente n'est pas sanctionnable ?
- sur l'aspect " astreinte ", elle interroge par sa potentielle dangerosité.
Un employeur qui se serait vu, par exemple, ordonner la délivrance sous
astreinte d'un document indispensable au déclenchement de l'indemnisation
chômage de son ex-salarié se trouverait mis à l'abri (en
terme de liquidation de l'astreinte) pendant toute la période d'état
d'urgence sanitaire plus 1 mois ? Les conséquences pour le salarié
pourraient alors être délétères…
=> Devra-t-il attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire pour faire
valoir un droit dont dépend le déclenchement de son indemnisation
chômage ?
Par le Service juridique - CFDT
2 avril 2020
*
Droit de retrait : puis-je l'utiliser à cause du Coronas-virus ?
QUE DIT LA LOI ?
Le droit de retrait est régi par l'article Article L4131-1 du code du
travail.
" Le travailleur alerte immédiatement l'employeur
de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi
que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes
de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut
demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre
son activité dans une situation de travail où persiste un danger
grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité
du système de protection. "
QUE DIT LA JURISPRUDENCE ?
Rappels de salaire en cas d'exercice du droit de retrait : la formation de référé
des prud'hommes peut statuer sur la légitimité du droit de retrait
même si un recours a par ailleurs été initié par
l'employeur.
Plusieurs salariés qui avaient constaté une situation potentiellement
dangereuse au sein de leur établissement avaient exercé leur droit
de retrait. Ils avaient constaté que la " peinture amiantée
" des rames de métro sur lesquelles ils effectuaient des opérations
de maintenance s'écaillait et que toutes leurs interventions sur cette
question auprès de leur employeur avaient été vaines.
Dans ce cas, l'employeur ne peut pratiquer de retenue sur salaire, sauf s'il
considère, sous le contrôle éventuel du juge, qu'il n'y
avait pas de motif raisonnable de cesser le travail (c. trav. art. L.4131-3;
cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806 ; cass. crim. 25 novembre 2008, n°
07-87650).
En parallèle, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement avait également
exercé son droit d'alerte en cas de danger grave et imminent (c. trav.
art. L.4132-2) et préconisait de faire cesser toute activité de
maintenance dans l'attente de la mise en œuvre des travaux ou protections
recommandées.
L'employeur, qui contestait le motif raisonnable de l'utilisation du droit de
retrait, avait effectué une retenue de salaire pour absence injustifiée
et saisi un tribunal de grande instance (TGI) contre la décision du CHSCT.
Mais, de leur côté, les salariés, sans attendre que le TGI
apporte une réponse quant à la validité ou non de la procédure
initiée par le CHSCT, avaient saisi la formation de référé
du conseil de prud'hommes (c. trav. art. R.1455-7) pour lui demander de constater
l'existence d'un motif raisonnable d'exercice du droit de retrait et, en conséquence,
de condamner leur employeur à leur verser une provision au titre des
rappels de salaire.
Devant la formation de référé, l'employeur contestait la
compétence de la formation de référé et affirmait
que seul le conseil de prud'homme saisi au fond était compétent.
Mais pour la Cour de cassation, la formation de référé
du conseil de prud'hommes ne pouvait se voir interdire de statuer, car, dans
les circonstances de l'affaire, aucune disposition n'excluait l'exercice de
ses pouvoirs (c. trav. art. R.1455-5 à R. 1455-8).
Ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes
qui relève que le CHSCT de l'établissement a constaté un
danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et
que le recours de l'employeur devant le TGI sur la validité de la procédure
initiée par ce comité n'a toujours pas abouti, peut allouer aux
salariés une provision sur le salaire qui leur a été retenu.
Enfin, en pratique, bien que les rappels de salaire prévus par une ordonnance
devenue définitive dans le cadre d'une procédure de référé
aient le caractère de provision, s'il entend les contester, l'employeur
devra prendre l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes au fond.
Cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-25237
DANS LE CAS DU CORONAVIRUS
Tout employeur doit assurer la santé et la sécurité des
travailleurs sous sa responsabilité.
Article L4121-1 du code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris
ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
L'employeur doit pouvoir mettre à disposition de quoi vous laver les
mains ( eau + savon ), ce qui est déjà le cas en temps normal.
Les travailleurs doivent appliquer les 'gestes- barrières' ( tousser
dans le coude, ne pas se serrer la main, ne pas se faire la bise, ne pas se
toucher, s'espacer d'au moins un mètre ).
Il peut aussi tenir à disposition, le cas échéant, du gel
hydroalcoolique, des lingettes, des gants, voire des masques, surtout si les
travailleurs sont en contact avec du public.
Si l'employeur respecte ces points, il faudra prouver qu'il existe un danger
grave et imminent pour que le droit de retrait soit valable. Les travailleurs
doivent prendre contact avec institutions représentatives du personnel
(CSE) en cas de doute. Avoir peur du virus n'est pas un risque grave ni imminent.
Le salarié n'a pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d'accident ou de maladie. Le risque peut être immédiat ou survenir dans un délai rapproché. Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes.
Le salarié informe alors son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n'est pas obligatoire, un écrit (e-mail, courrier en main propre contre signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception) est cependant préférable.
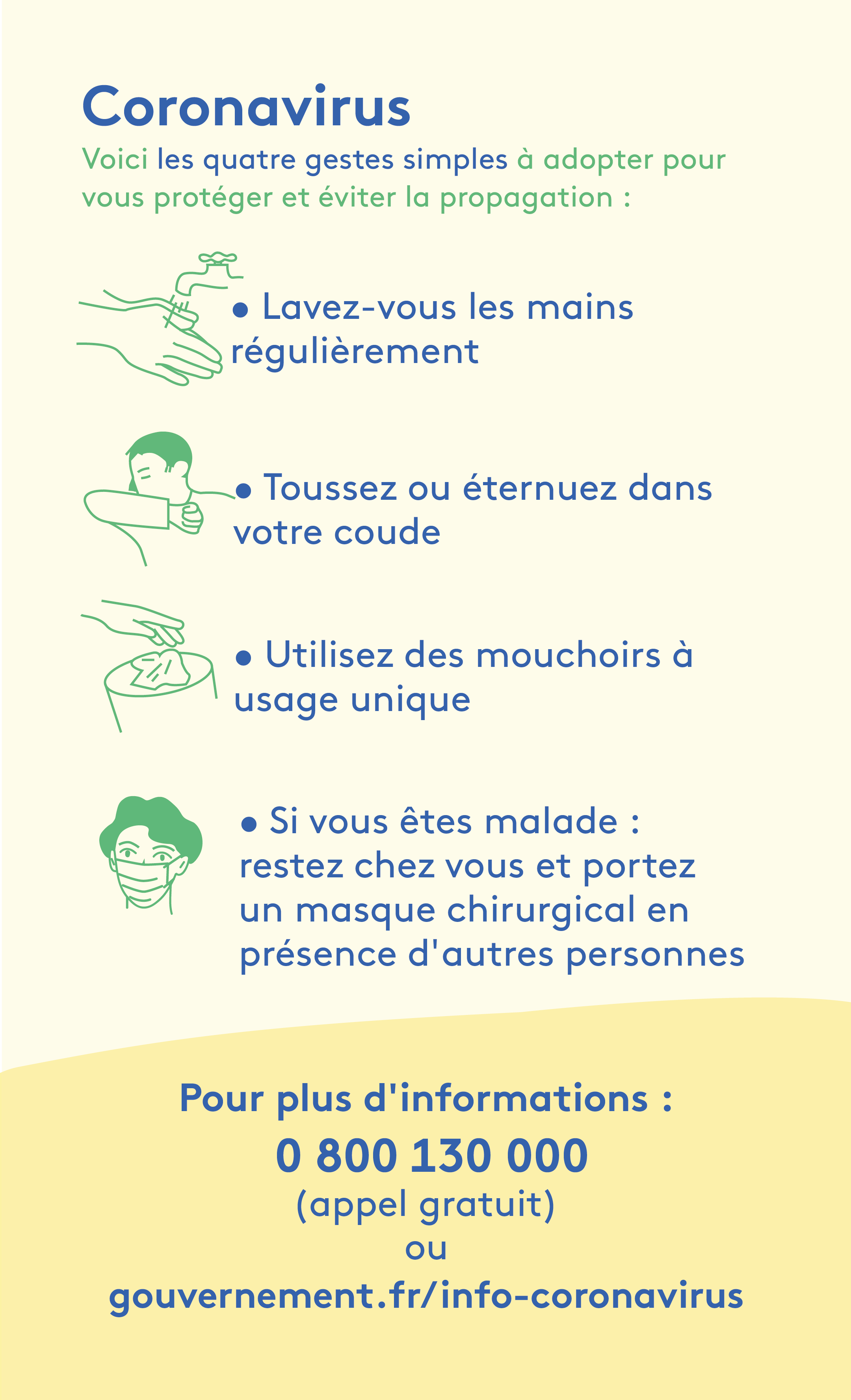
Pour agrandir l'image, ouvrir dans une nouvelle fenêtre
*
Barème des prud'hommes : le Comité européen des droits sociaux s'invite dans le dossier
Décidément, l'Italie est souvent au menu des débats sociaux
hexagonaux du moment. Il y a quelques jours, faisant le point sur la réforme
des retraites , le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le
calcul des droits acquis sera calqué sur celui que la péninsule
avait adopté. Celle-ci s'est aussi invitée plus discrètement
sur un autre sujet sensible : celui du barème de dommages et intérêts
en cas de licenciement abusif, mesure phare de la réforme du Code du
travail d'Emmanuel Macron en 2017.
Une forme d'avertissement
La contribution est cette fois-ci indirecte, mais elle constitue une forme d'avertissement
à l'exécutif. Il s'agit d'une décision prise par le Comité
européen des droits sociaux le 11 septembre, qu'il vient de mettre en
ligne sur son site. Deux ans et demi avant la France, en mars 2015, l'Italie
a voté l'instauration d'un tel barème dans le cadre de son "
job act ". Le CEDS a été saisi en octobre 2017 par l'un des
principaux syndicats italiens d'une réclamation sur cette disposition,
qui a d'ailleurs fait l'objet de l'autre côté des Alpes d'une censure
de la Cour constitutionnelle en septembre 2018 . Appuyée par la Confédération
européenne des syndicats, la CGIL estimait que la mesure violait la nouvelle
loi de la Charte sociale européenne, plus particulièrement son
article 24 qui affirme " le droit des travailleurs licenciés sans
motif valable à une indemnité adéquate ".
Le comité lui a donné raison. Dans sa décision, le CEDS
considère que le plafonnement italien, globalement plus élevé
que le français sauf pour les très petites entreprises, ne permet
pas " d'obtenir une réparation adéquate, proportionnelle
au préjudice subi ", y compris du fait de la durée des procédures,
mais aussi qu'il n'est pas " de nature à dissuader le recours aux
licenciements illégaux ".
Pas de risque juridique immédiat
Deux réclamations, fondées sur une argumentation similaire à
celle de la CGIL, ont été adressées au Comité européen
des droits sociaux, par FO et par la CGT. Elles sont encore en cours d'instruction,
mais la décision qui vient d'être publiée après,
déjà, une condamnation de la Finlande sur son barème, n'est
pas de bon augure pour le gouvernement français. " Il s'agit non
seulement d'une victoire pour les travailleurs italiens mais également
pour les travailleurs français ", a salué Force ouvrière
vendredi.
Cette décision ne fait pas courir de risque juridique immédiat
à la barémisation inscrite dans le Code du travail par la réforme
de 2017. Les décisions du comité n'ont pas de force exécutoire
et dans l' avis que la Cour de cassation a prononcé en juillet 2019 (en
assemblée plénière, ce qui lui donne une valeur renforcée),
celle-ci a notamment affirmé que l'article 24 de la Charte européenne
n'est pas d'application directe. Cela veut dire qu'il ne peut pas être
invoqué dans un contentieux entre particuliers, en l'occurrence entre
un employeur et un salarié. " Même si la Cour de cassation
venait à confirmer à nouveau que la Charte n'est pas applicable
directement dans les litiges entre particuliers, un salarié pourrait
engager une action en responsabilité contre l'Etat du fait du préjudice
créé en raison du non-respect de ses engagements internationaux
", note la chercheuse Tania Sachs, maître de conférences en
droit à l'Université Paris-Nanterre. Le feuilleton n'est pas près
de s'arrêter.
Leïla de Comarmond, 21 février 2020
source
:
*
Conseiller du salarié : un engagement de terrain, entre militantisme syndical et mission de service public
Enquête quantitative et approche qualitative des conseillers du salarié franciliens, 2019
La DIRECCTE Ile de France vient de publier une étude sur les conseillers du salarié.
Elle est
très instructive car le nombre de répondants est largement suffisant, avec un
millier de cas. Outre les questions
quantitatives assez classiques, l’étude s’enrichit des réponses obtenues par
des questions ouvertes.
Il ressort
de cette étude que si la fonction de conseiller du salarié reste à ce jour
largement le fait d’hommes, la part
plus importante de femmes parmi les conseillers les plus récents augure de
possibles évolutions dans les années à venir : ainsi, les femmes
représentent 39% des effectifs de conseillers du salarié entrés en fonction
depuis moins de 2 ans.
Cette large surreprésentation des hommes est
à mettre en lien avec les secteurs d’activité dont sont issus les conseillers
du salarié. En effet, si l’on compare leur répartition à celle de l’emploi
total en Ile-de-France, il apparaît que le
secteur tertiaire marchand (commerce, transports, etc.) est particulièrement représenté, ainsi
que l’industrie, même si son poids global est bien moindre. Or il s’agit de
secteurs se caractérisant par un faible taux de féminisation de la main d’œuvre,
comparativement à d’autres types d’activités ici sous-représentés (comme le secteur
tertiaire non marchand).
La part des
conseillers du salarié retraités est aussi dominée par les hommes à 78%.
7 octobre 2019
*
Annulation de la décision de répartition des conseillers prud'homaux collège employeurs par le Conseil d'Etat, suite à la saisine des syndicaux des petits patrons et professions libérales.
scénario 1 :
Le conseil de la prud'homie redonne son avis ( consultatif ) et la répartition
reste la même. Pas d'effet rétroactif.
scénario 2 :
Le conseil de la prud'homie redonne son avis ( consultatif ) et la répartition
rebat les cartes, et les changements sont justes à la marge. Quelques
conseillers MEDEF disparaissent et arrivent quelques autres conseillers d'autres
formations ( CPME, UNAPL, …). Mais les jugements effectués par ces
juges restent valides. Pas d'effet rétroactif.
scénario 3 :
La répartition annule les désignations avec effet rétroactif,
tous les jugements sont invalides. Soit les cours d'appels ( pour les jugements
frappés d'appel ) rejugent et font disparaitre l'incident de procédure,
soit ce n'est pas le cas et tous les jugements sont nuls.
A notre avis, seuls les scénarios 1 & 2 sont envisageables. Le 3
polluerait politiquement le quinquennat. Personne n'a envie d'en arriver là.
24/04/2019
*
Évolution quantitative et qualitative des demandes formées aux prud'hommes
Le commissariat général à la Stratégie
et à la Prospective vient de publier une Évaluation
des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail.
Concernant la prud'hommie, cette étude montre la baisse importante du
nombre de saisines prud"hommales.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié les dispositions
relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou
sans cause réelle et sérieuse, en rendant obligatoire le recours
à un barème, fixant des minima et des maxima, sauf lorsque le
licenciement est entaché d'une des nullités énumérées
à l'article L. 1235-3-1.
Cette ordonnance est entrée en vigueur dans un contexte de baisse des
recours devant les juridictions prud'homales.
En vingt ans, les recours devant les conseils de prud'hommes ont été
divisés par deux, passant de 240 000 demandes en 1998 à moins
de 120 000 saisines en 2018. Cette baisse n'a pas été régulière.
Entre 1998 et 2009, le nombre oscillait annuellement autour des 210 000 demandes.
C'est surtout à partir de 2009 qu'il enregistre une baisse régulière
- interrompue conjoncturellement en 2013 - pour tomber à 120 000 à
peine en 2018.
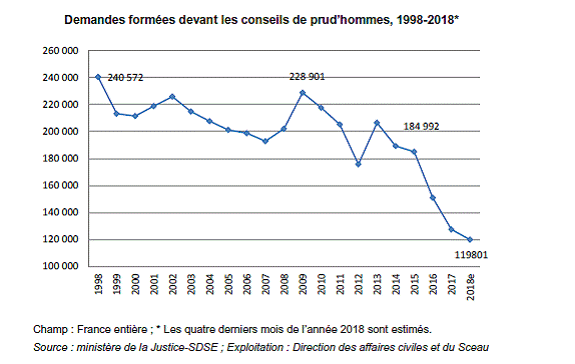
La baisse observée en 2009, qui s'explique pour partie par l'entrée en vigueur de la rupture conventionnelle, s'est poursuivie par la suite, et s'est accentuée à partir du mois d'août 2016, à la faveur de différents textes.
Le net recul du nombre de saisines sur les dernières années a pour particularité d'être intervenu immédiatement après l'entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale. Ce décret précise que la requête doit dorénavant contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Elle doit également être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, et qui sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. L'entrée en vigueur du décret a été accompagnée de la diffusion d'un modèle de requête Cerfa n° 15 586, comportant un listing détaillé des informations et pièces requises pour l'introduction de la demande. Il est possible que la diminution des saisines résulte de l'obligation de fournir les pièces nécessaires à l'instruction du dossier dès le dépôt de la demande.
C'est dans ce contexte baissier qu'est entrée en vigueur, à compter du 24 septembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Depuis novembre 2017, le nombre de demandes introduites devant les prud'hommes se situe globalement à des niveaux similaires à ceux qui ont été constatés l'année précédente. En l'état actuel, et compte tenu du recul temporel limité dont on dispose sur ces données, on ne peut donc à ce jour déceler de lien entre l'instauration du barème et l'activité de ces juridictions.
En 2018, près de 9 demandes sur 10 contestent le motif de la rupture
du contrat de travail, contre 7 demandes sur 10 en 2009, et moins de 5 sur 10
en 1998. D'une manière générale, alors que le nombre de
demandes formées devant les conseils de prud'hommes a été
divisé par deux, les contestations du motif de la rupture ont enregistré
un faible recul (- 1 %) tandis que les autres demandes ont connu une
diminution de plus de 80 %. Ainsi, le Conseil de prud'hommes, chargé
de régler l'ensemble des litiges individuels entre employeurs et salariés
nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture de contrat
de travail de droit privé, a à connaître majoritairement
des demandes visant à contester le motif du licenciement par les salariés.
De manière constante, plus de 95 % des recours sont formés par
des salariés " salariés non protégés et apprentis",
en contrat à durée indéterminée dans neuf cas sur
dix.
Ce sont majoritairement des hommes (62 % en 2009, 61 % en 2017), âgés
de plus de 40 ans (53 % en 2009 et 60 % en 2017). Dans près de deux recours
sur dix, le requérant saisit la section encadrement.
Afin de disposer d'un taux de recours aux prud'hommes selon leur profil, nous
avons rapporté les salariés qui ont saisi la justice aux fins
de contester la rupture de leur contrat, aux flux de personnes inscrites à
Pôle emploi après licenciement, et réalisé une régression
logistique.
Toutes choses égales par ailleurs, l'âge et la catégorie socioprofessionnelle sont les facteurs qui ont le plus d'effet sur le risque de saisir la justice après un licenciement : les licenciés âgés de 60 à 65 ans ont une probabilité 2,6 fois plus élevée que les licenciés de moins de 30 ans de saisir les prud'hommes. De même, les cadres ont une probabilité 3,1 fois plus importante de saisir les prud'hommes que les autres catégories socioprofessionnelles.
Ainsi en 2017, les salariés qui ont saisi la justice présentent
des caractéristiques démographiques et professionnelles spécifiques
à des salariés qui peuvent espérer les indemnités
les plus élevées et sont donc susceptibles d'être pénalisés
par l'application des plafonds fixés par le barème.
Face à ce constat, on peut se demander si le plafonnement résultant
de l'application du barème a pu inciter les salariés à
soulever les causes de nullité énoncées dans l'article
L. 1235-3-1 du code du travail (harcèlement, discrimination ou violation
d'une liberté fondamentale), qui impliquent - si elles sont retenues
par le juge - que le barème ne s'applique pas.
Le dispositif permanent du ministère de la Justice ne permet pas de répondre à la question. En effet, il repose sur la collecte de la demande principale introductive d'instance et n'enregistre pas les moyens soulevés par les parties. En l'état des données disponibles, il n'est pas possible de tester cette hypothèse, qui requiert des études complémentaires.
28/02/2019
*
Dix ans après leur création, le nombre de ruptures conventionnelles toujours en hausse
Dix ans après leur création, les ruptures conventionnelles individuelles
continuent d'augmenter. En 2018, plus de 430.000 ruptures ont été
enregistrées, une hausse de 3,9% par rapport à l'année
précédente, selon des statistiques publiées lundi par le
ministère du Travail.
Cette possibilité de rompre son contrat de travail, parfois considérée comme une démission déguisée, a été mise en place en 2008 et doit recueillir l'accord de l'employeur et du salarié. Le salarié a droit à une indemnité de rupture et peut toucher, le cas échéant, les allocations chômage.
En 2018, 437.700 ruptures conventionnelles ont été homologuées, soit une hausse de 3,9% qui fait suite à une hausse de 8% en 2017.
La hausse atteint 10% dans le secteur de l'information et de la communication et 7,2% dans le secteur des activités financières et d'assurance, selon la Dares, le service statistique du ministère du Travail.
Les salariés qui signent des ruptures conventionnelles sont plus jeunes et plus souvent employés que l'ensemble des salariés du secteur privé.
Ainsi, 26% des signataires d'une rupture conventionnelle ont moins de trente ans alors qu'ils sont 16% des salariés en CDI. Et ce sont en majorité (53%) des employés qui signent une rupture alors qu'ils représentent 34% des salariés en CDI.
Les cadres et les ouvriers sont 18% parmi les signataires de telles ruptures et sont respectivement 24 et 30% de la population salariée en CDI.
Les cadres obtiennent de meilleures indemnités de rupture que les ouvriers: 0,31 mois de salaire par année d'ancienneté, contre 0,25 pour les ouvriers et les employés (ce qui correspond à l'indemnité légale).
L'indemnité médiane s'élève à 5.900 euros environ pour les cadres et à un peu moins de 1.000 euros pour les employés.
Par région, l'Île-de-France concentre un quart de l'ensemble des ruptures conventionnelles (+3,8% en 2018). La Bourgogne-Franche-Comté a enregistré une hausse de 7,4%, la Corse 6,4%, et la Normandie une baisse de 2,5% en 2018.
Agence France Presse, 11 février 2019
*
Le barème des Prud’hommes à nouveau jugé illégal
Six jours après la décision du Conseil des Prud’hommes
(CPH) de Troyes du 13 décembre 2018, c’était au tour du
CPH d’Amiens d’invoquer, le 19 décembre 2018, le droit international
pour invalider le plafonnement des dommages et intérêts en cas
de licenciement sans causes réelles et sérieuses. Et ce n’est
pas fini, le 21 décembre 2018, le CPH de Lyon est entré dans
la danse.
C’est une épidémie ! On va bientôt pouvoir faire une carte comme pour la grippe, s’est exclamé un twittos en apprenant la décision du Conseil des Prud’hommes de Lyon de ne pas respecter le plafonnement prud’homal des dommages et intérêts introduit par les ordonnances Macron. La décision a été rendue le 21 décembre 2018. Le jugement s’est appuyé sur l’article 24 de la Charte sociale européenne qui pose le principe suivant : en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Et de trois donc ! Car la décision lyonnaise arrive après celle du Conseil des Prud’hommes (CPH) de Troyes, puis celle du CPH d’Amiens qui ont considéré que le barème pour les licenciements abusifs ou sans cause réelles et sérieuse, est contraire au droit international. À Amiens, les juges prud’homaux ont invoqué l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que deux arrêts de la cour de Cassation.
Un demi mois, ce n’est pas suffisant
Les dispositions exposées par la Convention 158 de l’OIT et de
la jurisprudence en matière d’application de ladite Convention
permettent aux juges nationaux de déterminer si les dommages attribués
par la législation nationale sont appropriés en matière
de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ont argumenté les juges. Du coup, le Conseil amiénois a considéré
que la somme d’un demi mois de salaire prévue dans le barème
n’était pas suffisante et que, de ce fait, il y avait lieu de
rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée
et réparatrice. Le salarié touchera donc 2 000 euros au lieu
des 726 euros prévus par le barème spécifique aux entreprises
de moins de onze salariés.
Une des mesures phares des ordonnances
Si les sommes en jeu ne sont pas astronomiques, ces jugements mettent en difficulté
l’une des mesures phares des ordonnances Macron. Celle qui consistait
à instaurer un barème de dommages et intérêts compris,
selon l’ancienneté, entre un 0,5 et 2,5 mois de salaire brut pour
les entreprises de moins de 11 salariés ; et, entre un et vingt mois
de salaire brut, pour les entreprises de plus de onze salariés. Un
dispositif qui redonnera confiance aux employeurs et aux investisseurs, notamment
dans les TPE et PME, avait justifié le gouvernement. La crainte de
l’embauche dans celles-ci est réelle, alors même que le
potentiel de création d’emplois y est considérable.
Des juges ignorants ?
La décision de Troyes du 13 décembre a ouvert le ban et a ainsi
entraîné de nombreux commentaires dans les médias. Notamment
la réaction du ministère du Travail qui avait déclaré
au Monde que la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux
se posait. Des propos jugés extrêmement choquants et insultants
par le Conseil des Prud’hommes de Troyes. Mettre en cause notre autorité,
notre compétence, et le principe de séparation des pouvoirs,
qui constitue pourtant l’un des fondements de notre démocratie,
est scandaleux et porte atteinte à l’autorité de la justice
et à son indépendance, avait déploré de concert
le président et le vice-président du CPH de Troyes. Écarter
une loi votée parce qu’elle est non conforme aux traités
signés par la France ne relève pas de l’ignorance mais
de l’exercice juridictionnel des juges, ont-ils rappelé avec force.
Cela ne fait que commencer
Pour autant, ces deux décisions n’invalident pas la loi actuelle
sur la barémisation des dommages et intérêts. Pour cela,
il faudra attendre les décisions des cours d’Appel et la décision
définitive de la Cour de Cassation. Autant dire que cela prendra un
peu de temps. Ces jugements vont toutefois donner des arguments aux salariés,
à leurs défenseurs et à leurs avocats. L’affaire
est donc loin d’être terminée.
MARDI 8 JANVIER 2019
Auteur : Nadia Djabali
Source
*
La CFDT lance une pétition contre la suppression des greffes des conseils de prud'hommes.
Voici le texte de la pétition :
Pétition contre l'amendement n°1427 à la loi de programmation 2019-2022
et de réforme pour la justice initiée par les fonctionnaires des conseils de
prud'hommes
Les soussigné.e.s ont pris connaissance de l'amendement ci-dessous qui tend à
la suppression de la quasi totalité des greffes des conseils de prud'hommes.
* Amendement n° 1427 à l'article 53 de la loi de programmation :
“ 4° L'article L.123.1 est ainsi modifié :
...
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège
dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses
chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions du
greffe du conseil de prud'hommes.”
L'exposé sommaire d'explication de cet amendement indique notamment :
“Cette fusion favorise une allocation optimale des moyens sur un même
territoire en donnant la possibilité de répondre de manière satisfaisante aux
exigences de bon fonctionnement des juridictions, aussi bien à la faveur (sic
!) du conseil de prud'hommes qui pourra mobiliser des effectifs du tribunal
judiciaire, que du tribunal judiciaire qui pourra mobiliser des effectifs de
greffe initialement affectés au conseil de prud'hommes. Il permettra
d'améliorer l'accueil des justiciables, et en particulier le fonctionnement du
service d'accueil unique du justiciable."
Cet amendement démontre une totale méconnaissance du fonctionnement des greffes
des juridictions en général, et de ceux des conseils de prud'hommes en
particulier.
En effet, les possibilités de délégation de personnels des greffes entre
juridictions existent déjà depuis longtemps (Cf. article R.1423-50 du code du
travail et article R.123-17 du code de l'organisation judiciaire).
Depuis la réforme des conseils de prud'hommes de 1979/1980, nous avons
régulièrement pu constater que les délégations se faisaient quasiment à sens
unique :
·
de très nombreuses délégations de
fonctionnaires des conseils de prud'hommes vers les tribunaux de grande
instance ou les cours d'appel, parfois pour des durées de plusieurs années, et
mettant même en difficultés des juridictions prud'homales obligées de fermer
certains services, notamment l'accueil ;
·
des cas beaucoup plus rares de
délégations de fonctionnaires des cours et tribunaux vers les conseils de
prud'hommes...
Sans oublier le fait que depuis 1980, c'est environ la moitié des
effectifs des conseils de prud'hommes qui ont été supprimés, essentiellement au
bénéfice des tribunaux de grande instance, mettant de nombreux conseils en
difficulté de fonctionnement.
Dans ce cadre, justifiant l'amendement en osant écrire que le conseil de
prud'hommes “pourra mobiliser des effectifs du tribunal judiciaire” (comment ?
qui ? Le président du conseil ? Pas le chef de greffe puisqu'il n'y en aura
plus !) relève soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi, soit des deux à la
fois.
Par ailleurs, et bien avant la mise en place des SAUJ (services d'accueil
unique du justiciable), les GUG (guichets uniques de greffe) avaient mobilisé
les compétences des fonctionnaires des différentes juridictions présentes sur
un même site.
Une enquête réalisée il y a quelques années, dans le cadre de la justice du
XXIè siècle, avait démontré que le conseil de prud'hommes était, de très loin,
la juridiction la mieux identifiée par les citoyen.ne.s.
Noyer le greffe du conseil de prud'hommes dans une autre entité judiciaire ne
faciliterait pas l'accès à la justice prud'homale, bien au contraire, sans
oublier la dizaine de greffes de conseils de prud'hommes qui resteraient
autonomes...
Les fonctionnaires des greffes des conseils de prud'hommes, du fait qu'ils
travaillent avec des magistrats non professionnels, sont particulièrement
formés au droit du travail, aux nombreuses réformes qui le modifient.
L'article R.1423-41 du code du travail précise notamment que “le directeur de
greffe... met en forme les décisions”. Bien sûr, ce sont les greffiers et les
adjoints administratifs assermentés comme greffiers qui assurent
essentiellement cette fonction, bien spécifique à la juridiction
prud'homale.
Concernant les conseillers prud'hommes, le président du conseil se retrouverait
de fait sous l'autorité des chefs du tribunal de grande
instance, puisque le conseil n'aurait plus de moyens identifiés pour
fonctionner.
Enfin, et c'est important, il existe depuis plusieurs dizaines d'années des
fonctionnaires placés auprès des chefs de cour, de catégorie A, B et C, dont la
fonction est bien de pallier les vacances d'emploi. Ces fonctionnaires sont,
selon les besoins, affectés dans toutes les juridictions dont les CPH (même si
c'est rarement la priorité) du ressort de la cour d'appel.
Les soussigné.e.s demandent donc le retrait de cet amendement, qui va
totalement à l'encontre de l'amélioration du service public de la justice. »
La pétition est en ligne à cette adresse : https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Garde_des_Sceaux_Ministre_de_la_Justice_Contre_la_suppression_des_greffes_des_conseils_de_prudhommes/?launch
18/12/2018
*
Le barème d'indemnisation du licenciement est déclaré contraire avec la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l’OIT
Le Conseil de Prud’hommes de Troyes
reconnait l’inconventionnalité des barèmes MACRON, dans un jugement en
date du 13 décembre 2018 ( RG :F18 /00036).
Le Conseil de Prud’hommes juge que « les barèmes prévus à l’article
1235-3 du Code du Travail sont en contrariété avec la Charte sociale
européenne et la convention n° 158 de l’OIT ».
L’Avocat en charge du dossier avait soutenu l’argumentaire développé par le SAF (syndicat des avocats de France ).
*
SFR: les vendeurs qui aident les clients à résilier risqueraient le licenciement [source]
Plusieurs vendeurs des boutiques SFR sont en procédure
de licenciement pour avoir aidé des clients à résilier
leur contrat soit de téléphonie et/ou de ligne fixe ADSL.
Aider les clients, c'est par exemple leur fournir leur R.I.O. qui leur servira
à la portabilité du numéro de leur ligne téléphonique.
C'est aussi leur fournir le numéro d'appel du service clientèle
qui s'en occupe : le 1023.
Présenté comme ça, du point de vue du droit du travail,
cela donne l'image d'une entreprise qui licencie ses salariés qui ne
faisaient que leur travail d'aider les clients à rompre le contrat commercial
qui les liait à SFR. Quoi de plus normal pour un employé du service
commercial que de traiter une demande d'ordre commerciale. Quoi de plus anormal
qu'une entreprise commerciale qui demanderait à ses équipes commerciales
de ne pas fournir les renseignements demandés par les clients désirant
rompre le contrat dans le but de les obliger à rester clients contre
leur volonté ?
Commençons par le commencement, par le contrat de travail.
Le contrat de travail est un contrat de soumission, de subordination, d'une
des deux parties, le salarié, à une autre partie, l'employeur.
La subordination signifie l'obéissance aux ordres, règles, directives,
données par l'employeur. Le contrat de travail en possède quelques-unes,
parfois annexées dans une fiche de poste. Le règlement intérieur,
les circulaires, notes de service le sont également, tout comme les ordres
oraux. En échange de ce lien de subordination, le salarié touche
une rémunération. L'employeur a le droit de contrôler la
quantité, la qualité et les modalités du travail effectué.
Dans le cas présent, SFR reconnait que des règles internes interdisent
aux conseillers en boutique d'aiguiller les clients pour les résiliations
et indique que les conseillers doivent orienter les clients vers un service
dédié, en inscrivant la demande de résiliation du client
dans un logiciel. Le client est ensuite, du moins en théorie, rappelé
par le service commercial pour réceptionner la demande de résiliation.
Nul ne doute que ce service commercial en profitera pour tenter d'empêcher
le départ du client en présentant des offres avantageuses. Refuser
d'appliquer ces consignes volontairement serait interférer dans les pratiques
commerciales de l'entreprise, ce qui est rigoureusement interdit.
Un certain nombre de conseillers en boutique n'ont, semble-t-il, pas respecté
ces consignes. SFR aurait procédé à des entretiens destinés
à recadrer ces salariés pour les enjoindre d'appliquer les règles.
Même si les salariés ont la possibilité de fournir l'information
aux clients en très peu de temps, il leur est désormais interdit,
depuis septembre 2017, de le faire, alors que cela relevait de leur mission
auparavant. Si certains vendeurs n'ont eu droit qu'à des remontrances
verbales, d'autres ont été convoqués à un entretien
préalable au licenciement.
L'intersyndicale a dit que cette interdiction de fournir les informations demandées
mettait le salarié 'en posture d'infraction'.
Pour savoir que les vendeurs en boutique donnaient les informations, SFR les
a testés, en envoyant des visiteurs mystère. C'est un moyen de
contrôle, qui n'est valable que si les IRP (institutions représentatives
du personnel ) ont été informées de cette mesure. Le fait
qu'ils aient été des salariés de SFR plutôt que des
employés d'une entreprise de sous-traitance spécialisée
dans ce genre de réalisations ne change rien à l'affaire. C'est
tout aussi valable. Encore faut-il que les agissements de visite mystère
soit pratiquées dans le respect de la loi. Le Canard enchaîné
vient de publier un article sur les pratiques douteuses d'une entreprise envoyant
des visiteurs mystère enregistrer des salariés de points de vente
avec un dictaphone. En l'occurrence, dans l'article du canard, ce ne sont pas
des salariés de SFR qui étaient enregistrés, mais des vendeurs
de voiture.
SFR indique que le processus commercial mis en place par SFR permet aux vendeurs
en boutique d'être focalisés sur le conseil et l'accompagnement
des clients dans le choix de leur offre. Il ne leur est plus autorisé
de fournir des informations sur la rupture du contrat, la procédure les
obligeant à noter cette demande qu'un autre service instruira. Un vendeur
qui passerait outre cette interdiction et orienterait même un client vers
la concurrence pourrait même être poursuivi pour faute lourde.
Une vendeuse a ainsi été contrôlée par un visiteur
mystère, et reçu une lettre pour un entretien préalable
au licenciement ainsi qu'une mise à pied trois mois après les
faits. La date de convocation fait tiquer, car il n'est possible, pour un employeur,
de lancer une procédure disciplinaire que dans un délai de deux
mois après la connaissance des faits.
SFR annonce que les licenciements n'auront pas lieu, dans un souci d'apaisement.
Il est possible que toutes les procédures n'aient pas été
respectées, que le principe des visiteurs mystère n'ait pas été
présenté aux IRP, ou que le nombre de procédures soit tellement
important que les salariés se braquent devant l'action de leur employeur.
La médiatisation de cette affaire n'aide pas non plus SFR, conférant
une mauvaise image de marque vis-à-vis de ses clients et du grand public.
D'autant que les IRP et les salariés disent que les clients dont la demande
de départ est notée par le service commercial ne sont pas rappelés
systématiquement. Selon l'intersyndicale, seul un sur trois serait rappelé.
Cela fait autant de clients mécontents qui reviennent en boutique pour
se plaindre. Si certains clients se montrent menaçants, il est compréhensible
que les vendeurs boutique donnent les informations de résiliation, pour
éviter des scènes de violence, tant verbales que physiques. Ce
serait alors, de la part du vendeur une action par défaut, et pas un
choix délibéré du salarié de s'affranchir des règles.
Or l'employeur a pour obligation de préserver tant la santé mentale
que physique des salariés qu'elle emploie.
SFR indique que les clients peuvent résilier quand ils veulent, que toutes
les informations sont inscrites sur leur contrat d'adhésion et en ligne,
sur le site de SFR.
Du point de vue du droit du travail, SFR est-il dans son droit de lancer des
procédures de licenciement pour motif disciplinaire ? Les salariés
ont-ils commis une faute ?
Les salariés qui ont clairement et volontairement donné aux clients
les informations destinées à rompre le contrat sont en faute.
Même si cette mission entrait dans leur compétences jusqu'en septembre
2017, ils ont désormais l'obligation de passer la main au service commercial
qui se chargera de joindre les clients par téléphone. Refuser
systématiquement de le faire pour cause d'empathie pour les clients et
refus des procédures commerciales de l'entreprise est une faute. Le salarié
doit rester loyal envers son employeur. En revanche, donner l'information, ponctuellement,
dans le cas où le vendeur perçoit un risque de violence chez le
client est certes une non-application des consignes, mais dictée par
le fait de ne pas se mettre soi (et/ou ses collègues) en danger, ce qui
ne devrait pas être reproché par l'employeur.
Le fait d'avoir commis une faute ne signifie pas forcément qu'il y ait
un licenciement. L'échelle disciplinaire est large, elle va du simple
rappel oral au licenciement pour faute lourde en passant par l'avertissement
écrit, le licenciement pour faute et le licenciement pour faute grave.
SFR peut-il se baser sur des informations issues de visites mystère
?
Oui, le principe de visite mystère est valable. Mais il faut que les
salariés et leurs représentants aient été informés
de l'existence de ces méthodes. S'il y a eu enregistrement du vendeur,
celui-ci devait être informé de ce moyen.
SFR ne doit pas piéger ses vendeurs en faisant intervenir un visiteur
mystère agressif, car le salarié pourrait réagir différemment,
en donnant les informations demandées.
Si le mécanisme d'information et d'orientation du client désirant
rompre le contrat est déficient, est-ce loyal ?
Le mécanisme peut être déficient par effet, c'est-à-dire
de manière involontaire. Le service chargé de rappeler le client
tente de le joindre plusieurs fois, sans y parvenir, laisse des messages pour
pouvoir être rappelé.
Le mécanisme peut être déficient par objet, c'est à
dire de manière volontaire. Le service chargé de rappeler le client
n'appelle qu'une seule fois, ne laisse aucun message, avec un numéro
ne pouvant réceptionner d'appels. C'est un mécanisme qui peut
être utilisé lorsqu'on ne veut pas laisser partir les clients.
Ce n'est pas loyal, et c'est difficile, tant pour les clients que pour les vendeurs
boutiques, de prouver cette déloyauté. Si ce mécanisme
est mis en œuvre, cela met les vendeurs boutique en porte à faux
vis-à-vis des clients, ces derniers pouvant réagir de manière
violente. Mettre ses salariés en danger, compromettre leur santé
physique ou mentale n'est pas loyal, ce serait une faute de l'employeur.
Est-ce que les salariés sont en droit de réagir ?
Face à un client agressif ou violent, un vendeur peut fournir les informations.
Mais le faire de manière systématique n'est pas un bon choix.
Interférer volontairement dans la politique commerciale est une faute
lourde. Les salariés ont été bien avisés de tenir
informés leurs représentants.
Est-ce que les IRP sont en droit de réagir ?
Les IRP n'en ont pas le droit mais le devoir. L'intersyndicale a réagi
au travers d'un communiqué de presse récemment. L'instance représentative
le plus à même d'étudier la question est le CHSCT. Encore
faut-il l'avertir. Et on apprend que les visites mystères auraient été
organisées sans que les IRP en soient averties. Or les dispositifs de
contrôle doivent être portés à la connaissance des
salariés et de leurs représentants. Le processus commercial mis
en place en septembre 2017 a dégradé leurs conditions de travail.
La mise en danger n'est pas avérée, mais le jour où un
client excédé en viendra à de la violence, il sera trop
tard. Les IRP sont en mesure d'apporter une réponse collective bien plus
efficace que les actions individuelles des vendeurs boutique. La palette des
actions de prévention et de modification des procédures commerciales
est large. Cela va de la formation des vendeurs par l'employeur au respect des
clients. En terme de revendication ou de réaction, les organisations
syndicales peuvent appeler au droit de retrait ainsi qu'à la grève.
Alerter les médias et les réseaux sociaux est aussi une très
bonne chose.
Les vendeurs se mettent-ils en infraction vis-à-vis de la loi en ne
fournissant pas les informations demandées par les clients ?
Non, car la loi n'impose pas que ce soit au vendeur de le faire, mais à
la structure commerciale dans son ensemble. Transmettre la demande de résiliation
du client au service dédié est suffisant, du moins pour garantir
au salarié qu'il a respecté les consignes internes. En revanche,
s'il est avéré que le service commercial n'appelle qu'un client
sur trois, c'est une faute commerciale de SFR et non de ses salariés.
La loyauté du contrat s'applique aussi (et surtout ) au fournisseur de
services.
Retrouvez cet article sur Youtube
RP 6/11/2018
*
La procédure prud'homale de Maitena Biraben, le prononcé du jugement
Le 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a rendu le prononcé du jugement de l'affaire opposant Maitena Biraben à son ancien employeur Canal+
Que peut-on en dire ?
Le conseil de prud'homme donne juste ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire
la décision d'accorder ou pas, et combien. Mais la motivation, c'est-à-dire
ce qui a conduit les juges à prendre cette décision, n'est pas
encore écrite. Une fois le jugement mis en forme, il sera notifié,
ce qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois,
selon les cas. Ce n'est qu'une fois la notification effectuée que les
parties pourront faire appel ou pas.
Je n'ai ni le jugement en main, ni les conclusions des avocats ni les pièces,
je développerai donc en fonction des éléments disponibles
sur le net, à savoir, deux vidéos ( 1
et 2
) et un article.
Sur les demandes des parties
L'article de l'Entreprise.lexpress.fr nous apprend que l'avocate de la salariée
demande de prime abord la nullité du licenciement, et subsidiairement,
la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Demander un licenciement nul est assez surprenant, car la nullité n'est
accordée que lorsqu'il y a discrimination ( article L1132-1
du Code du travail ) ou lorsqu'un droit fondamental est bafoué. Est-ce
vraiment le cas ici ? A priori, non. Mais si ça avait été
les cas, la décision des juges n'aurait pas été la même.
Ils auraient pu accorder l'intégralité des salaires depuis le
licenciement, et ordonner la réintégration.
La demande de 500000 euros est peut-être basée sur le fait d'avoir
appris le départ de l'émission et son éviction de la chaîne
via le communiqué de presse du 2 juin. Le montant est très élevé.
Une autre demande porte sur l'affichage/publication du jugement. C'est peu accordé
par les juges.
L'avocate de Maitena Biraben demande 10000 euros d'article 700. C'est vraiment
beaucoup, pour un dossier qui n'apparait pas très compliqué. Les
juges vont évidemment donner moins. Ce qui serait acceptable, serait
1500/2000 euros. Les juges n'oublient pas que l'avocate a fait signer une convention
d'honoraires, et que celle-ci implique le versement d'une part des gains obtenus
en cas de victoire, en général 10%. Vu les sommes, le pourcentage
est sans doute moins élevé.
L'avocat de l'employeur demande lui un article 700 de 5000 euros. C'est beaucoup,
mais plus compréhensible. Il sait qu'il ne gagnera pas une part des sommes
en jeu. Même s'il gagnait, il est d'usage que l'article 700 ne soit pas
versé aux employeurs, les juges jugeant en droit, mais aussi en équité.
Il réagit sur la demande de 500000 euros de préjudice moral, qu'il
qualifie de blague. Et il a raison, le préjudice moral se plaide, avec
des arguments factuels. Le fait d'être connu ne crée pas à
lui-seul un préjudice particulier. Quant à apprendre son éviction
par communiqué, ce n'est pas si offensant pour quelqu'un dont le métier
est public.
Il réagit sur la demande de publication du jugement : " La publicité
d'un jugement est compréhensible pour un jugement collectif. Là
on a une volonté de jubiler au niveau de l'ego ! "
D'autant que le jugement peut être demandé par n'importe qui au
greffe, et que la solution du conflit sera forcément connue de tous.
Sur les demandes basées sur le salaire et l'ancienneté.
Il y a un différend entre l'employeur et la salariée sur le montant
du salaire. Cela n'a rien d'extraordinaire, cela arrive parfois.
Dans le cas présent, le salaire a été négocié
en position de force par la salariée. Le salaire annuel est de 650 000
euros, 50 000 euros sur 13 mois. S'y ajoute une prime de présence de
360 000 euros brut, ce qui fait une moyenne mensuelle de 84 167 euros brut.
La salariée a un désaccord sur le salaire de référence.
Elle dit que les 360 000 € prévus sur trois ans sont à ajouter
sur une seule année. D'où la demande basée sur ce salaire
pour l'indemnité de licenciement.
Du côté de Canal +, on avance cependant un salaire mensuel s'élevant
à " 56 944 euros brut ". La somme de 360 000 euros de prime
de présence est à considérer, selon l'employeur, sur une
assiette de trois ans, pour récompenser les 36 mois de salaire.
Le Conseil de prud'hommes a tranché, et s'est basé sur le salaire
contractuel de 50 000 mensuel pour calculer l'indemnité de licenciement.
Sur l' Ancienneté
La encore, les différentes informations ne permettent pas de connaitre
la date exacte reconnue pour l'ancienneté. Il est parfois question de
reprise d'ancienneté. Sur le contrat de travail est indiqué le
1er août 2008. L'avocate de Maïtena Biraben aurait pourtant dit à
l'audience que le 1er août 2004, la salariée rejoignait Canal+.
S'agit-il de l'entreprise Canal +, ou du groupe ? Pas facile, en l'absence de
pièces, d'y voir clair.
Or tant le salaire que l'ancienneté déterminent le montant de
l'indemnité de licenciement, ainsi que le montant de l'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le résultat
Maïtena Biraben aurait obtenu :
- 38.456 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
et 3.845 euros de congés payés afférents, ce qui correspondrait
à 13 jours ouvrés ;
- 162.500 euros d'indemnités de préavis et 16.250 euros de congés
payés afférents, ( ce qui ferait pour 3 mois : 54166,66 mensuels
) donc bien 650 000 € de salaire annuel en X 12 ;
- 138.356 euros d'indemnités de licenciement ;
- 2.550.000 euros d'indemnités contractuelles de rupture. Ce qui est
une clause pénale différente de l'indemnité de licenciement
;
et 510.000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
A ceux qui s'étonneraient que Maitena Biraben puisse toucher à
la fois l'indemnité légale de licenciement et une indemnité
de rupture, il faut savoir que ces deux indemnités diffèrent dans
leur nature. Car sinon, le cumul est impossible, en application de l'article
R. 1234-5 du Code du travail. La clause contractuelle d'indemnité de
rupture doit être considérée comme une clause pénale,
car son montant est forfaitaire et ne dépend pas de l'ancienneté
au moment du départ ( Cass. soc., 17 oct. 1995, no 94-41.152, Cass. soc.,
22 juill. 1986, no 83-45.859 ).
Sur la mise à pied
L'article de L'entreprise.Lexpress fait état d'une demande de 34 456,22
euros pour mise à pied. Mais le résultat est de 38456,22€.
Il s'agit sans doute de 38456€, somme qui correspond au résultat
obtenu.
La mise à pied aurait duré du 28 juin 2016 au 18 juillet 2016,
date de l'envoi de la lettre de notification du licenciement. Ce qui fait 20
jours calendaires ou 13 jours ouvrés.
Sur la 'démission' de Maiténa Biraben
Le 2 juin 2016, Canal plus publie un communiqué de presse : " Maïtena
Biraben a souhaité quitter la présentation du Grand Journal à
la fin de la saison. Son énergie et sa passion ont nourri les émissions
qu'elle a animées sur les antennes de Canal+ ". Il n'est pas précisé
qu'elle quittait aussi Canal+ mais la chaîne lui souhaite un " plein
succès dans ses projets ". Un employeur ne souhaite jamais un succès
dans ses projets à quelqu'un qui reste dans l'entreprise. Cela ressemble
fort à un communiqué de départ de l'entreprise.
La salariée dit qu'elle a demandé la publication d'un contre-communiqué
et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Si elle a les preuves des
mails qu'elle a envoyés, Canal Plus est mal.
L'employeur tente de déminer la situation, en disant que Canal Plus dit
juste que Maïtena Biraben a souhaité quitter la présentation
du Grand Journal à la fin de la saison, et n'a jamais parlé de
licenciement.
Un peu facile, puisque l'employeur lui souhaite un plein succès dans
ses projets futurs, et ne souhaite pas modifier ou amender son communiqué
de presse. On peut donc acter qu'il existe une divergence de point de vue sur
l'exécution du contrat de travail entre les deux parties, et ce, un mois
avant la mise à pied. Ce communiqué est équivoque, écrit
que la salariée a décidé de partir, de la présentation
de l'émission, c'est sur, voire même de Canal+. On peut le comprendre
comme ça.
La salariée dit qu'elle n'a jamais donné sa démission.
Elle dément par écrit auprès de sa direction, envoie trois
mails successifs. Il ne se passe rien. On ne lui répond pas.
L'employeur a donc communiqué publiquement sur le contenu du contrat
de travail de la présentatrice, et on peut comprendre du communiqué
qu'elle quitte la chaîne. L'ambigüité du communiqué
et le refus de Canal + de publier un contre-communiqué met en défaut
la loyauté de l'employeur. Cela peut même être perçu
comme une fin de contrat à l'initiative de l'employeur.
Sur la faute grave et la loyauté du contrat.
L'employeur reproche à Maitena Biraben d'avoir refusé de passer
Michel Denisot dans son émission, pendant le festival de Cannes. Canal
+ avait décidé de ne pas y aller sauf Michel Denisot. La présentatrice
dit : " Je refuse de passer Denisot dans mon émission. " Selon
l'employeur, les mots employés par Maitena Biraben sont : " Je m'y
refuse. " La seule condition qu'elle le passe est qu'elle aussi descende
à Cannes " . L'employeur parle d'une décision d'ordre économique
qui impacte tout le monde. L'employeur évoque une prise d'otages, que
la presse s'en est fait le relais et que même Pierre Lescure dit que cela
n'a plus de sens que tout Canal descende à Cannes !
Le refus d'obéissance est caractérisé, c'est de l'insubordination.
L'employeur peut sanctionner la salariée fautive, il a deux mois pour
agir. Mais pourquoi attend-il 5 semaines pour la convoquer à un entretien
préalable puisqu'il s'agit, selon lui, d'une faute grave ? Voilà
donc un argument qui est inopérant devant les juges. On a juste l'impression
que l'employeur cherche tout et n'importe quoi dans les placards pour se défendre.
Pas bon…
Après cet épisode, l'employeur reçoit un mail de cinq pages
de Maïtena Biraben. " Moi, la production de cette émission
ne me convient pas "... " L'émission est là pour me
servir... "
L'avocat de l'employeur a raison de réagir : " Non, on ne s'est
pas compris, c'est vous qui devez servir l'émission ! "
L'employeur est dans son droit. La raison d'être du contrat de travail
d'un salarié est de remplir une mission, pas de se servir de ce contrat
pour son intérêt personnel. Le contrat de travail a pour but de
servir un intérêt collectif, celui défini par la direction.
Mauvais point pour Maitena Biraben. Mais comme l'employeur n'a pas sanctionné
immédiatement un tel comportement, il lui est difficile ensuite de le
qualifier de faute grave.
Sur la procédure de licenciement
Le 28 juin Maitena Biraben reçoit une convocation avec mise à
pied qu'elle considère comme incompréhensible puisque l'émission
est terminée depuis le 24 juin et qu'elle ne va pas au studio. Selon
elle, il n'y a pas de mise en danger de l'entreprise par sa présence.
Maitena Biraben marque un point. Il revient à l'employeur de prouver
la faute grave, qui n'est pas la mise en danger de l'entreprise, mais juste
l'impossible maintien de la salariée. MAIS si une insoumission / insubordination
n'a jamais mis en danger qui que ce soit, cela reste pourtant un motif valable
de faute grave, et de mise à pied conservatoire.
L'employeur s'emmêle ensuite les pinceaux. Il dit que si la salariée
a été limogée, elle ne peut se présenter à
l'entretien préalable au licenciement. L'avocat de Canal + a tout faux
!
Etre limogée, cela n'existe pas en droit du travail, on l'a vu dans la
précédente vidéo. Et la salariée s'est déclarée
comme étant licenciée, puisqu'en préavis. Or, pendant un
préavis, tout salarié doit obtempérer à son employeur.
Rien n'interdit à un employeur de convoquer un salarié, pourquoi
pas, à deux entretiens préalable, même si le deuxième
entretien a lieu pendant le préavis
L'employeur dit que la présentatrice aurait pu demander une résiliation
judiciaire ou faire une prise d'acte de rupture.
Cependant, si Maitena Biraben estimait avoir été licenciée
( en se basant sur le communiqué de presse, sans doute) sans avoir de
faute grave à reprocher à son employeur, elle ne pouvait prendre
acte de la rupture, celle-ci ayant déjà eu lieu. Rupture sur rupture
ne vaut.
L'employeur dit qu'il a parlé de nouvelle saison avec Maitena Biraben,
elle répond qu'elle a été limogée. Et que lorsqu'il
la convoque à une réunion sur l'avenir le 21 juin, elle demande
si c'est une réunion indispensable puisqu'elle est en préavis.
Il dit qu' " Elle a la main ".
Avoir la main ? Quelle main ? Si elle est en préavis, elle doit venir
à toute convocation de l'employeur. Ne pas aller à cette réunion
est une faute. La salariée se prétend licenciée en s'appuyant,
entre autres, sur le communiqué maladroit de son employeur du 2 juin.
Ce communiqué pourrait avoir été interprété
par les juges comme étant une lettre de licenciement, ou une modification
du contrat de travail, suffisant pour entrainer la rupture de ce dernier.
17/10/2018
*
Dans les 8 800 premiers CSE installés, un tiers d’élus en moins
Selon les premiers chiffres distillés par le ministère du Travail,
la France compterait déjà 8 814 comités sociaux et économiques
(CSE), dont plus de la moitié dans des entreprises de moins de 50 salariés.
Le nombre d’élus de ces CSE est en baisse d’un tiers rapport
aux instances séparées antérieures.
Et ce n’est pas fini, près d’un tiers des entreprises ont reporté
la mise en place leur CSE puisqu’elles ont encore jusqu’au 31 décembre
2019 pour fusionner les DP, CE et CHSCT dans cette instance. FO dénonce
la disparition à terme de 200 000 mandats d’élus. "Sous
prétexte de moderniser ou de renforcer le dialogue social, le paysage
des institutions représentatives du personnel (IRP) est devenu à
géométrie variable", déplorait la résolution
générale issue du congrès de Lille d’avril 2018. Pour
Pascal Pavageau, "On est en train d’éloigner les salariés
des syndicats, ce qui est mauvais pour la défense de leurs droits et
leur représentation".
Source
8/10/2018
*
CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Certains salariés vont renoncer à faire valoir leurs droits
Le contentieux prud'homal chute. Le point avec Rachel Saada, avocate, membre
du syndicat des avocats de France.
Entretien avec Rachel Saada, Avocat associé, l'Atelier des Droits
Semaine sociale Lamy : Le ministère estime à 15 % la baisse du contentieux prud'homal entre 2016 et 2017. Disposez-vous de chiffres plus précis ?
Rachel Saada : Non, nous n'arrivons pas à en obtenir, nous ne disposons que des données communiquées par chaque président de conseil de prud'hommes (CPH). Nous savons avec certitude que, globalement, le nombre de saisines en matière prud'homale s'est effondré. Les raisons de la baisse de 15 % évoquée par le ministère du Travail sont multiples puisque le barème de septembre 2017 n'est pas la seule réforme qui pourrait l'impacter. Il faut également tenir compte de la réforme de la procédure prud'homale d'août 2016. À la suite de cette refonte procédurale, plusieurs présidents de CPH ont d'ailleurs constaté une chute variant de 30 à 40 % du nombre d'affaires enregistrées par leur juridiction sur les quatre derniers mois de l'année 2016 et les premiers de l'année 2017. Et pas seulement des affaires jugées au fond, mais aussi en matière de référé (on a pu évoquer 50 % de moins à Paris). Certes, l'instauration de la rupture conventionnelle en 2008 avait déjà progressivement produit devant tous les CPH une chute du nombre de nouveaux dossiers. Mais l'effondrement auquel on assiste depuis 2016 ne s'inscrit pas dans cette baisse régulière.
Ce n'est donc pas le barème qui a entraîné la chute du
nombre de saisines prud'homales ?
R. S. : C'est encore trop tôt pour affirmer que la baisse du contentieux
a pour origine les ordonnances Travail. Je ne vois pas comment le barème
pourrait avoir eu un tel impact. D'abord, il n'est entré en vigueur que
le 23 septembre 2017. Ensuite, il ne s'applique qu'aux licenciements postérieurs
à cette date. Je pense qu'il s'agit davantage d'un renoncement causé
par la complexification de la procédure prud'homale associée à
la mise en place du barème. Celui-ci va évidemment produire des
effets dans les années à venir puisque pour obtenir une condamnation,
il faut qu'au moins un conseiller prud'hommes côté patronal se
désolidarise de son camp. S'il le fait… c'est souvent la condamnation
plancher qui est prononcée.
Selon le ministère du Travail, le barème a incité employeurs
et salariés à négocier davantage.
R. S. : Nous n'avons pas attendu un texte pour le faire ! On a toujours
négocié. Mais on observe dans toutes les matières l'obligation
de rechercher une issue amiable. Mais sans procédure engagée,
elle n'encourage pas nécessairement les employeurs à négocier
davantage. Avant la réforme de 2016, il me fallait entre 20 minutes et
une heure pour saisir le CPH. Aujourd'hui, c'est une demi-journée au
minimum et la procédure de mise en état est parfois plus lourde
qu'au TGI sans les avantages du RPVA.
Tout ceci entraîne un surcoût d'honoraires dans un environnement
où l'aide juridictionnelle n'est pas à la hauteur. Donc ce que
produisent les réformes, ce n'est pas de l'emploi mais l'abandon de leurs
droits par un nombre grandissant de justiciables. Je ne suis pas non plus convaincue
que cela va augmenter le nombre d'accords. J'insiste, on a toujours négocié
en matière prud'homale. Les deux parties peuvent d'ailleurs comparaître
volontairement devant les prud'hommes en se présentant conjointement
afin de faire homologuer leur accord. Dans cette situation, le traitement fiscal
et social est bien meilleur. Hormis ces comparutions volontaires qui ont pris
un certain essor, il est vrai qu'avant 2016, les procès-verbaux de conciliation
devant le bureau de conciliation n'étaient pas très nombreux (entre
5 et 10 %). Mais ce n'est pas un indicateur pertinent pour témoigner
du niveau de négociation car celle-ci peut se conclure favorablement
à n'importe quel moment de la procédure après l'audience
de conciliation. C'est ce qui explique d'ailleurs que près de la moitié
des dossiers entrés ne donnent pas lieu à jugement à la
sortie.
En pratique, comment vivez-vous la réforme ;de la procédure
prud'homale ?
R. S. : Malgré les différents régimes probatoires, la réforme
ne distingue pas selon la nature de l'affaire. L'obligation de motivation de
la saisine pèse toujours sur le demandeur. Or, 98 % des affaires portent
sur la contestation d'un licenciement. Il incombe pourtant à l'entreprise
d'apporter les éléments permettant de justifier sa décision
et la charge de la preuve pèse sur l'employeur en matière de licenciement
pour faute grave. La nouvelle procédure impose malgré cela au
salarié de prouver que sa contestation est valable en fournissant des
pièces à l'appui de sa demande. L'employeur est quant à
lui seulement invité à produire ses pièces devant le bureau
de conciliation. La réforme, en procédant de manière indistincte
sans tenir compte du régime de l'administration de la preuve pénalise
donc les salariés. Qui a les éléments de preuve en matière
de licenciement économique, de licenciement pour faute grave ou encore
d'insuffisance professionnelle ? C'est l'employeur. Et malgré les efforts
réels faits par les demandeurs, on constate que les délais ne
se réduisent pas. Encore un aspect qui pénalise le salarié
car le temps joue toujours contre lui !
Et en appel ?
R. S : La réforme de la procédure a supprimé le principe
de l'unicité de l'instance mais a dans le même temps interdit les
demandes nouvelles et réduit la prescription. Selon moi, le contrat de
travail constitue malgré tout un lien suffisant pour introduire une nouvelle
demande. Reste à savoir ce que dira la jurisprudence et comment elle
déterminera " le lien suffisant ". Entre-temps, nous sommes
dans l'incertitude et obligés de sécuriser notre action en formant
toutes sortes de demandes au départ, quitte à y renoncer ensuite.
On aboutit ainsi à l'effet inverse de celui escompté, notamment
en raison de l'absence de concertation préalable des acteurs du contentieux.
Qui plus est, on peut désormais difficilement prendre un dossier au seul
stade de l'appel. Le délai de trois mois pour conclure est insuffisant
pour monter le dossier. On oblige les parties à conclure à toute
vitesse pour ensuite laisser le dossier en souffrance pendant plus d'un an,
parfois deux ans. Aucune contrepartie à ces contraintes n'a été
offerte. Et quand on regarde l'effet du Magendie sur les juridictions civiles,
on sait que les délais n'ont pas été réduits, au
contraire.
Quant aux chausse-trappes qui sèment le parcours de l'appelant, ils sont
faits pour diminuer artificiellement et arbitrairement le nombre de dossiers
sans compter qu'ils provoquent des comportements déloyaux entre avocats,
menaçant ainsi notre déontologie…
Propos
recueillis par Françoise Champeaux et Marjorie Caro
8/10/2018
*

La procédure prud'homale de Maitena Biraben
Nous avons appris par différents médias que la présentatrice
Maiténa Biraben a demandé 4 millions d'euros à son ancien
employeur Canal Plus, suite à son licenciement en juillet 2016.
2 questions se posent :
- Un salarié peut il sérieusement demander des sommes aussi extravagantes devant les prud'hommes ?
- Si oui, peut-il les obtenir ?
Pour répondre à ces questions, il va falloir d'abord établir
un récapitulatif des faits et des demandes.
Maiténa Biraben, une salariée presque comme les autres.
Maiténa Biraben était salariée de Canal Plus depuis 2004.
Elle a accepté de changer ses fonctions en 2015, pour présenter
l'émission Le Grand Journal. Elle aurait très bien pu refuser
cette proposition. On peut présumer que la salariée était
en position de force pour négocier ce changement de fonction, car l'avenant
à son contrat de travail spécifiait le versement d'importantes
indemnités en cas de licenciement, sauf faute grave.
La salariée a été mise à pied, juste avant son licenciement.
La mise à pied conservatoire est une procédure légale.
C'est une suspension du contrat de travail, le temps de convoquer la salariée
à son entretien préalable au licenciement et c'est souvent lié
à la procédure de licenciement pour faute grave. On ne peut donc
pas dire qu'elle a été mise à pied de manière définitive
comme on a pu le voir. De même on ne peut pas dire que l'on apprend son
licenciement avant même d'être convoqué à l'entretien
préalable, ni même pendant celui-ci, car l'employeur ne commet
pas une telle faute qui vicierai la procédure.
Pour la mise à pied conservatoire, celle-ci n'est généralement
pas payée lorsque le licenciement a lieu, mais ce n'est pas une obligation.
Si la faute grave n'est pas avérée, alors la période de
mise à pied devra être payée.
Le limogeage.
Certains médias parlent de limogeage pour Maiténa Biraben. Ce
terme est impropre au droit du travail. A l'origine, c'était un terme
militaire pour désigner une mise à l'écart de généraux
incompétents, envoyés à Limoges.
La saisine des prud'hommes…
Maiténa Biraben a ensuite été licenciée pour faute
grave fin juillet 2016. Selon l'avocate de la salariée, le licenciement
est abusif, et sa cliente demande une somme de 4 millions et 60000 euros, se
décomposant en :
-2,55 millions d'euros d'indemnité contractuelle de licenciement,
-1 million et dix mille euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 mille euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Cela fait donc trois demandes différentes qui devront être examinées
une par une par les juges.
En ce qui concerne les deux millions 550 mille euros prévus dans une
clause d'un avenant du contrat de travail de la salariée, cette somme
ne sera pas automatiquement appliquée même si elle est inscrite
dans le contrat. En effet, tout juge, y compris un juge du travail, peut baisser
le montant d'une clause s'il l'estime excessive.
Pour les un million et dix mille euros, au titre de l'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme est légalement
calculée sur le salaire en fonction de l'ancienneté. Maiténa
Biraben est entrée en 2004 à Canal Plus, elle en part en juillet
2016, elle a environ entre 11 et 12 ans d'ancienneté, ce qui donne entre
10,5 et 11 mois de salaire d'indemnité, prévue par la loi. De
ces calculs, on peut en déduire qu'elle gagnerait aux alentours de 90000
euros mensuel. Un tel salaire est-il envisageable ? Aux spécialistes
des médias de répondre à cette question.
Pour les 500000 euros de dommages et intérêts, un salarié
peut toujours le demander au juge du travail. Mais encore faut-il prouver qu'il
existe un préjudice supplémentaire au licenciement. On trouve
généralement le versement de dommages et intérêts
lors de licenciement ayant eu lieu dans des conditions vexatoires. Cet argument
sera-t-il soulevé ici ?
9 mois avant d'agir…
9 mois après son licenciement, la salariée a annoncé avoir
saisi le conseil de prud'homme. Elle est dans les temps, la prescription pour
agir sur une rupture de contrat de travail est de 12 mois désormais,
mais 24 mois au moment des faits.
Sur le licenciement en lui-même :
Selon la salariée, la direction de Canal Plus a décidé
de se séparer d'elle quand elle s'est aperçue que le nouveau format
du Grand Journal ne faisait pas remonter les audiences. L'employeur aurait alors
invoqué la démission de la salariée, puis aurait ensuite
changé d'avis en accusant la salariée d'avoir commis une faute
grave, le tout dans le but, non avoué, d'échapper au paiement
de l'indemnité de rupture du contrat.
Selon l'employeur, en revanche, le licenciement de Maiténa Biraben est
du à la déloyauté de la salariée. La déloyauté
est une faute grave, voire lourde. Selon Canal Plus, la salariée 'se
serait inscrite totalement en marge de son contrat de travail'. 'S'inscrire
en marge de son contrat' est une formule vague, soit on respecte son contrat,
de manière loyale, soit on ne le respecte pas. La déloyauté
suffit à rompre le contrat, aux torts de celui ou celle qui ne le respecte
pas. Mais faut-il encore le prouver. Dans le cas présent, la charge de
la preuve repose intégralement sur l'employeur, car c'est lui qui rompt
le contrat de travail, qui prive la salariée de son préavis et
de l'indemnité de licenciement. Si l'avocate de la salariée a
bien fait son travail, elle a du demander dès l'audience de conciliation
le dépôt de la faute grave au greffe, bien avant l'audience de
jugement.
Toujours selon Canal Plus, la chaine aurait effectivement mis fin aux fonctions
de Maiténa Biraben en tant que présentatrice du Grand Journal,
et lui aurait ensuite fait plusieurs propositions de reclassement. Donc pas
de licenciement en vue. On ne connait pas la nature ni le nombre de ces offres
de reclassement, ni si la salariée les a refusées ou pas.
Si une proposition de reclassement modifie le contrat de travail, c'est-à-dire
porte atteinte au moins à l'un des 4 éléments essentiels
du contrat ( qui sont : la rémunération, le lieu de travail, le
temps de travail, la fonction/coefficient hiérarchique) alors la salariée
peut refuser cette proposition sans commettre de faute.
En conclusion :
Maiténa Biraben a-t-elle le droit de demander de telles sommes aussi
importantes devant le juge du travail ? La réponse est oui, si cela a
un rapport avec sa rémunération au sens large (salaire, primes,
avantages…)
Est-ce qu'elle va les obtenir ?
Si Canal Plus arrive à convaincre les juges du bien fondé de sa
décision, alors Maiténa Biraben n'aura droit à rien.
Si Canal Plus n'arrive pas à convaincre les juges, alors Maiténa
Biraben aura droit à quelque chose.
Ce 'quelque chose' est basé :
1. sur le contrat de travail, dont la salariée indique qu'il contient une clause sur l'indemnité de licenciement, qui se monte à 2,55 millions d'euros. Mais un juge peut très bien réduire cette indemnité s'il l'estime disproportionnée.
2. L'indemnité demandée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (un million et dix mille euros), basée sur le Code du travail, semble disproportionnée sauf à ce que la salariée ait une rémunération d'environ 90000 € par mois.
3. Les dommages et intérêts, quand ils sont attribués au demandeur, sont fixés librement et arbitrairement par le juge. Le Code du travail ne prévoit rien. Il est peu probable que Maiténa Biraben obtienne 500000 euros. Les juges sont en général assez frileux sur ce genre de demande. Ils se baseront aussi sur les sommes obtenues au titre de l'indemnisation du licenciement.
De toutes façons, cette affaire ira jusqu'en Cour d'appel ( à
Versailles). D'ici là, il est possible que les parties se soient entendues
et aient accepter de transiger.
R. P. , 11/09/2018
*
Ordonnances travail : le nombre de litiges aux prud’hommes en chute libre en 2017
Le 23 septembre 2017, les ordonnances réformant le Code du Travail, premier acte politique d'Emmanuel Macron, étaient publiées au Journal officiel. Le premier bilan de la réforme concernant les recours devant les Conseils des prud'hommes est de 127.000 contentieux enregistrés l'an dernier, selon le ministère du Travail. En 2016, ce chiffre était de 150.000, soit une baisse de 15%.
Désormais, un barème fixe le montant des dommages et intérêts aux prud'hommes en cas de licenciement abusif (sauf discrimination, harcèlement, ou atteinte aux libertés fondamentales). Les planchers et plafonds se basent sur l'ancienneté du salarié.
En à peine plus de trois mois d'application l'an dernier, ce barème a eu un "effet massif", explique-t-on au ministère du Travail. Les sommes minimales qui peuvent être récupérées aux prud'hommes ont été divisées par deux. Par exemple pas plus de trois mois et demi de salaires, après deux ans passés dans la même entreprise.
Forte incitation à négocier dans l’entreprise
Dans le même temps, les dommages et intérêts ont été
plafonnés à 20 mois de salaires, après 30 ans d'ancienneté.
C’est la fin des pactoles espérés jusqu’alors. Avec
les ordonnances, certains salariés trop gourmands ont été
découragés d'attaquer leur ancien employeur. Pour autant, cette
baisse de 15% des litiges aux prud'hommes favorise la discussion, avec une forte
incitation à négocier dans l'entreprise, d'après les remontées
de terrain.
Avant la réforme, les victimes d'un licenciement abusif saisissaient directement les juges du travail sans parler à leur DRH. Désormais, les salariés passent d'abord voir leur direction, pour tenter d'obtenir un chèque. Cela peut conduire à une transaction, si l'employeur a commis une faute, tout en évitant une procédure longue, et coûteuse.
Ce premier bilan des ordonnances est donc un "signal très positif. Les chiffres semblent prouver que le barème marche", estime le cabinet de Muriel Pénicaud, confiant dans une nouvelle baisse du contentieux aux prud’hommes cette année encore. De son côté, l'évaluation qualitative du dispositif ne devrait pas intervenir avant l'année prochaine.
10/09/2018
Christophe
Ponzio, RTL
*
Un salarié qui disparaît du jour au lendemain? La pratique est de plus en plus courante.
Les professionnels sont toujours plus nombreux à arrêter de
venir au travail, sans aucune explication. C'est ce qu'ont expliqué des
recruteurs et managers à la rédaction de LinkedIn.
Ce soir-là, la comptable quitte le bureau comme si de rien n'était.
Elle glisse ordinateur et badge dans son sac, puis lance un "à demain"
à la cantonade. Mais le matin suivant, sa chaise reste vide. 10h, 11h...
Ses collègues tentent de l'appeler sur son portable, sans succès.
"On a tout de suite pensé au pire: accident, AVC, enlèvement…",
explique Catherine*, directrice financière du groupe de services informatiques
qui employait la disparue.
En réalité, la salariée manquante se porte comme un charme.
Cette trentenaire a simplement réalisé, dix jours après
son arrivée dans l'entreprise, que le poste ne lui plaisait pas. A force
d'insistance, le service des ressources humaines a fini par avoir le fin mot
de l'histoire. Mais Catherine, 42 ans, en est encore toute abasourdie: "Je
n'aurais jamais osé faire ça: il y a un devoir moral à
respecter envers son employeur."
Souriez Catherine, vous avez été "ghostée". Le
"ghosting" (de "fantôme", en anglais), c'est quand
un salarié ou un candidat disparaît du jour au lendemain, sans
donner de nouvelles. La pratique est en plein boom aux Etats-Unis, comme l'a
démontré cette enquête de mon collègue américain
Chip Cutter. On y apprend par exemple que, dans une grande chaîne de restauration,
un candidat sur 2 ne se présente pas aux entretiens.
L'explication? Aux Etats-Unis, la courbe du chômage est à son plus
bas niveau depuis 18 ans (à 3,9%) ; il y a davantage de postes disponibles
que de travailleurs ; la part des salariés quittant leur emploi bat des
records. Conséquence: les professionnels, qui voient de nombreuses portes
s'ouvrir, peuvent se permettre d'en refermer d'autres. Quitte à les claquer
un peu trop violemment au nez de certains employeurs.
A la rédaction française de LinkedIn, nous nous sommes demandés
si la pratique avait traversé l'Atlantique. En effet, la moitié
des entreprises de l'industrie, des services et du bâtiment déclarent
rencontrer des barrières qui les empêchent d'embaucher davantage.
Mais, d'un autre côté, les chômeurs représentent encore
plus de 9% de la population active. Nous avons donc lancé un appel à
témoignages sur LinkedIn à destination des recruteurs et managers.
Entre les commentaires et les messages privés, nous avons reçu
une centaine de réponses.
Bilan: les salariés des directions RH de grands groupes (Engie, Total,
Crédit Agricole, ADP, Orange) ou de marques prestigieuses (Chanel et
Swarovski) n'ont jamais vu de salariés-fantômes. C'est logique:
les places dans ces entreprises sont chères. "Très peu de
salariés quittent Total", a résumé un responsable
RH de la compagnie pétrolière. Mais, en dehors de ces grands noms,
les professionnels français du recrutement sont bien familiers du phénomène.
Catherine, directrice financière citée au début de l'article,
a mentionné cinq exemples de salariés disparus. De plus, elle
ne compte plus le nombre de candidats qui s'évaporent. Jointe par téléphone,
elle raconte: "Il y a une pénurie de comptables, notamment avec
5 ou 6 ans d'expérience. Les candidats sont souvent engagés dans
plusieurs processus de recrutement, et continuent de faire monter les enchères
jusqu'au bout." Voire après. Comme cet autre comptable recruté
par Catherine et parti rejoindre une entreprise concurrente seulement 7 jours
après le début de son contrat.
Même constat dans le bâtiment, secteur qui souffre d'une pénurie
de main d'oeuvre. Sébastien Palerme, manager RH dans un groupe de construction,
revit sans cesse le même scénario: une nouvelle recrue sur 5 ne
se présentera jamais le premier jour de travail. "Les trois quarts
de ces salariés ne préviennent pas, et moins de la moitié
répond à nos messages suite à cette absence", explique-t-il
dans un message privé.
Une constante dans les témoignages: les disparus ont moins de 35 ans.
"J'ai rencontré cette situation à plusieurs reprises, raconte
Jimmy Bernard, responsable RH chez McDonald's, dans un message privé.
Cette jeune génération, que l'on nomme Y ou Z, cherche de plus
en plus un sens. S'ils ne le trouvent pas dans leur domaine professionnel, beaucoup
d'entre eux sont enclins à tout plaquer, y compris leur travail. Et pour
certains, du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle."
Analyse confirmée par Sébastien Palerme, du groupe de construction:
"Je ne connais ce phénomène que depuis un peu plus de 5 ans.
Elle est liée à l'état d'esprit des nouvelles générations
qui change: moins d'engagement dans le milieu professionnel, plus d'individualisme."
Parfois, une disparition subite de salarié révèle un malaise
au travail. Exemple, avec cette consultante anglaise, évoquée
dans un commentaire par Mathieu Flaig, cofondateur d'un cabinet de conseil:
"Elle était très jeune, et je pense qu'elle n'a pas réussi
à socialiser en interne, du fait que tout le monde parlait principalement
français et qu'elle était assez introvertie. Elle est partie en
vacances chez ses parents et, a priori, a décidé d'y rester."
"C'est très fréquent dans les professions paramédicales,
analyse sur LinkedIn Isabelle Lesieur, cadre de la santé qui a travaillé
en EHPAD et dans des services de psychiatrie. Le plus souvent, cela traduit
une maladie, un accident ou un burn-out. Je me souviens par exemple d'une infirmière.
Elle travaille 3 heures, puis explose en larmes en me disant qu'elle ne peut
pas travailler comme ça. Elle part en courant… et je n'ai jamais
plus eu de nouvelles !"
Isabelle Wroclawski est directrice d'une maison d'accueil spécialisée
pour personnes handicapées, qui emploie une centaine de salariés.
Elle affirme que 12 aides-soignants et aides médico-psychologiques se
sont volatilisés depuis début 2017. "C'est devenu tellement
courant dans notre établissement que plus personne ne s'inquiète
quand quelqu'un disparaît", explique-t-elle par téléphone.
Si la pratique semble presque ordinaire dans certaines entreprises, c'est qu'elle
peut être le seul moyen pour un professionnel de percevoir une allocation
chômage. En effet, la démission ne donne pas droit à une
indemnisation (même si la loi Avenir professionnel, votée le 1er
août, doit changer la donne). Mais attention, cette spécificité
française est loin d'expliquer tous les cas de "ghosting".
D'abord, un salarié peut abandonner son poste tout en avertissant (même
officieusement) son employeur. Ensuite, beaucoup de nos "fantômes"
sont partis pour un nouvel emploi.
Reste que les disparitions trop fréquentes de salariés peuvent
coûter cher à l'employeur. "Cette situation est très
inconfortable puisque non seulement elle désorganise l'entreprise, mais
en plus elle crée un climat malsain, analyse Anne Grappin, responsable
RH dans un groupe de conseil. Cela peut même mettre en péril les
très petites entreprises." D'autant que les employeurs "ghostés"
n'ont pas vraiment de recours.
"Les dommages et intérêts pour non-respect du préavis
et préjudice subi sont rarement octroyés aux entreprises",
poursuit la cadre lyonnaise. Seule option pour les employeurs: déclencher
une procédure de licenciement pour abandon de poste, avec mise en demeure
de régulariser la situation, convocation à un entretien préalable
au licenciement, puis licenciement.
Pour retenir candidats et salariés, les professionnels des RH n'ont donc
d'autre choix que de garantir de bonnes conditions de travail, et de peaufiner
leur marque employeur. Et si cela commençait par arrêter de "ghoster"
les candidats? "Le ghosting s'applique davantage aux recruteurs, fait remarquer
Vanessa Villares, directrice de clientèle en recherche d'emploi, dans
un commentaire. Je reçois des appels, je passe des entretiens téléphoniques,
je passe des entretiens physiques. Et 98% des recruteurs ne donnent plus signe
de vie."
* Catherine a souhaité témoigner de manière anonyme
Auteur : Tiffany Blandin, Journaliste chez LinkedIn
Source
28/08/2018
*
Affaire de la crèche Babyloup
Après la CESDH et la CJUE, voici le niveau suprême du droit externe
du travail : le Comité des droits de l'Homme de l'ONU.
Baby-Loup : l'ONU condamne le licenciement d'une salariée
voilée
Le Comité des droits de l'Homme de l'ONU a condamné le licenciement
d'une salariée voilée de la crèche française Baby-Loup,
estimant qu'il s'agit d'une «atteinte à la liberté de religion»,
et a demandé à la France de l'indemniser. Licenciée en
2008, Fatima Afif avait été déboutée à deux
reprises par les tribunaux.
Mais dans un arrêt de mars 2013, vivement critiqué, la chambre sociale de la Cour de cassation lui avait donné raison, estimant que «s'agissant d'une crèche privée», le licenciement constituait «une discrimination en raison des convictions religieuses». Son licenciement avait toutefois été confirmé par la suite par la Cour de Cassation en 2014.
Liberté de manifester sa religion
Dans ses conclusions, publiées le 10 août et que l'AFP a pu
consulter, le Comité de l'ONU a noté que «l'interdiction
qui lui a été faite de porter son foulard sur lieu de travail
constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté
de manifester sa religion». Le Comité, qui surveille l'application
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a observé
par ailleurs que la France «n'explique pas en quelles mesures le port
du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l'accueil
promus au sein de la crèche».
Il a considéré aussi que la France «n'a pas apporté de justification suffisante qui permette de conclure que le port d'un foulard par une éducatrice de la crèche porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant». Le Comité a donc conclu que l'obligation imposée à Mme Afif de retirer son foulard lors de sa présence à la crèche constitue «une restriction portant atteinte à liberté de religion» de la salariée, «en violation» du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La France n'aurait, de plus, «pas suffisamment étayé la
façon dont le licenciement» de Mme Afif, «sans indemnité
de rupture», «en raison du port du voile, avait un but légitime
ou était proportionné à ce but», concluant que le
licenciement «ne reposait pas sur un critère raisonnable».
Le Comité a demandé aux autorités françaises d'indemniser
la salariée licenciée «de manière adéquate»,
en lui offrant notamment une compensation pour la perte d'emploi sans indemnité
et le remboursement de tout coût légal. Le Comité a souhaité
par ailleurs que les autorités françaises lui transmettent dans
un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises.
*
LES METHODES MANAGERIALES CONFRONTEES AU DROIT DU TRAVAIL
FRANÇAIS
Le management du personnel [1] redevient d'actualité à l'occasion de la sortie du livre DRH, la machine à broyer [2], sorti le 15 mars dernier. C'est l'occasion de faire le point sur deux approches managériales les plus connues et les plus controversées : le principe de Peter et le ranking. La première méthode est la plus connue, du fait de son ancienneté (presque 50 ans), et a été popularisée par la caricature qui en a été faite : le principe de Dilbert, avec un gros succès d'édition.
Le principe de Peter
Ce n'est rien d'autre qu'une théorie empirique basée sur les observations personnelles [3] des deux auteurs [4] aux États-Unis.
La théorie
Le livre portant le nom de ce principe est paru en 1969. Analysant divers dysfonctionnements
dus à des erreurs ou à l'application de directives strictes, les
auteurs en ont déduit une théorie comprenant des lois scientifiques
diverses : un principe, un corollaire, un théorème, un paradoxe
etc. L'existence précédant l'essence, les auteurs n'ont fait qu'habiller
leurs constatations plus ou moins scientifiquement.
La démarche scientifique est pauvre, s'appuyant sur des généralités, des ressentis personnels. Selon ce principe, " dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence ", avec pour corollaire qu'" avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité ". L'ouvrage de Peter et Hull a pu faire l'objet d'études universitaires ayant étudié sa validité par la modélisation ou par la confrontation à des cas réels, certaines concluant à sa validité complète ou partielle [5].
o Explication du principe
Basé sur une évaluation d'un niveau de compétence, le principe
de Peter propose de décrire les évolutions de carrière
dans les hiérarchies par des principes de base simples, puis étudie
les corollaires qu'impliquent ces postulats.
Principes de base :
o un employé compétent à un poste donné est promu
à un niveau hiérarchique supérieur ;
o un employé incompétent à un poste donné n'est
pas promu à un niveau supérieur, ni rétrogradé à
son ancien poste.
Corollaires :
o un employé ne restera dans aucun des postes où il est compétent
puisqu'il sera promu à des niveaux hiérarchiques supérieurs
;
o par suite des promotions, l'employé finira (probablement) par atteindre
un poste auquel il sera incompétent ;
o par son incompétence à ce poste, l'employé ne recevra
plus de promotion, il restera donc indéfiniment à un poste pour
lequel il est incompétent.
o à long terme, tous les postes finissent par être occupés
par des employés incompétents pour leur fonction ;
o la majorité du travail est effectuée par des salariés
n'ayant pas encore atteint leur " seuil d'incompétence ".
On ne peut déboulonner un hiérarque incompétent pour les
raisons suivantes :
o seul un hiérarque peut le faire ;
o s'il le fait, il se déjuge et admet son incompétence à
discerner le personnel compétent.
Les auteurs décrivent la distribution de la compétence selon une
norme sortie de nulle part, dans laquelle les tranches de compétences
sont des multiples de 10 et de 20.
" Chez les employés d'une organisation, se répartit selon
une loi normale :
o 10 % d'employés sont super-incompétents.
o 20 % d'employés sont incompétents ;
o 40 % d'employés sont modérément compétents ;
o 20 % d'employés sont compétents ;
o 10 % d'employés sont super-compétents ".
Pour éviter de se retrouver à son niveau d'incompétence,
l'auteur estime préférable de se maintenir à un poste auquel
on est compétent, non seulement dans l'intérêt de l'organisation
où l'on travaille, mais aussi parce qu'être compétent à
son poste est un facteur de bonheur personnel. Mais il constate que le refus
d'une promotion est mal vu par l'entourage des intéressés, y compris
la hiérarchie [6].
La théorie expose que la promotion interne, s'appuyant sur la compétence, est basée sur ce que souhaite toute échelle hiérarchique, notamment l'échelon N+1 : l'obéissance, plus que les résultats. La désobéissance du salarié débouchera immédiatement sur son classement dans la catégorie des " super-incompétents ".
o Une théorie remise en question
Mais cette théorie rencontre l'obstacle de ceux qui analysent la baisse
de la compétence comme l'effet de régression vers la moyenne.
Ainsi, " à y réfléchir, ces résultats étaient
prévisibles car ils suivent la régression vers la moyenne. Les
organisations qui déterminent les promotions uniquement au mérite,
cas des très grandes administrations, sont victimes de la régression
vers la moyenne qui tend à produire de l'incompétence. Les organisations
mieux dirigées, tout en n'oubliant pas l'intérêt stimulant
de la promotion au mérite, contrôlent qu'on ne demande pas au promu
de faire ce qu'il ne sait pas faire [7].
La seconde leçon est qu'il faut contrer le mécanisme de cliquet, ce qui est facile, par exemple en changeant rapidement les fonctions des incompétents ou en s'en débarrassant.
La baisse de productivité constatée chez les sujets qui viennent de bénéficier d'une promotion ne résulte-t-elle pas de la régression vers la moyenne ?
L'efficacité d'un employé occupant une fonction à laquelle il vient d'être promu est statistiquement moins bonne que sa précédente efficacité puisque, justement, il a obtenu une promotion du fait qu'il était efficace. En s'approchant maintenant de la moyenne, ce qui est statistiquement inévitable, l'efficacité baisse. Pour certains chercheurs, c'est la raison unique du principe de Peter ".
La réponse prétorienne
Bien que Peter et Hull prétendent que leur principe est universel [8],
il est permis de douter de certains éléments de ce principe.
Le fait qu'un employé soit qualifié d'incompétent par son employeur sans que celui-ci ne réagisse par une prise de décision surprend tout observateur du monde du travail.
o L'incompétence
Il est déjà étrange qu'un employé soit compétent
(donc à 100 %), soit incompétent (à 100 %). Peter ne s'embarrasse
pas de nuance.
La notion de niveau de compétence est discutable. Déjà par ce qu'il existe plusieurs types de compétences (intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sociale) et qu'il vaudrait mieux parler de champ de compétences. Un salarié peut changer de champ sans changer de niveau, l'évolution pouvant s'effectuer horizontalement et pas seulement verticalement.
Cela pose aussi la question de qui juge, sur quel base, avec quels moyens et quelle objectivité ? L'avancement des salariés est une affaire de gestion d'entreprise, dans laquelle un juge ne peut (sauf cas de discrimination) entraver la liberté d'entreprendre [9]. Le salarié qualifié d'incompétent par son employeur ne peut donc arguer du fait que ce jugement patronal s'appuie en général sur une seule personne, qui instruit et juge à la fois[10].
o La promotion
L'employeur est tenu d'adapter et de former ses salariés [11]. Un employeur
qui tenterait de s'extraire de cette obligation s'exposerait au versement de
dommages et intérêts au salarié n'ayant pas bénéficié
du maintien de son employabilité [12].
S'il est normal de considérer que tout employé cherche à s'élever dans la hiérarchie, ne serait-ce que pour bénéficier d'une augmentation de salaire, il est permis de refuser un avancement. Passons sur les moyens présentés par Peter [13] pour refuser inconsciemment les promotions, pour découvrir qu'un salarié dont la nomination à un poste supérieur passerait par une période probatoire pourrait très bien refuser cette dernière [14], avec la quasi certitude de ne pas se voir attribuer le poste présenté.
Une grande part de responsabilité revient à l'employeur en cas d'échec suite à une promotion lorsque le salarié n'a pas bénéficié de formation, qui doit être considérée comme un investissement et non une dépense. Plus le salarié avance hiérarchiquement, moins il a besoin de compétences techniques et plus il requiert de techniques managériales. C'est peut-être par ce qu'ils savent qu'ils n'ont pas suffisamment été formés et accompagnés que certains salariés refusent une promotion [15].
o La rétrogradation
Un salarié ayant déjà passé sa période d'essai
avec succès peut se retrouver promu à un autre poste hiérarchiquement
supérieur [16] ou pas [17]. Une nouvelle période d'essai ne peut
être de mise. Il existe toutefois un garde-fou : la période probatoire.
Celle-ci est calquée sur le même principe que la période
d'essai, sauf que le salarié est déjà titularisé
dans l'entreprise. Si l'employeur est finalement insatisfait par les performances
du salarié, il doit le réintégrer dans ses précédentes
fonctions [18].
Contrairement à ce qui est présenté dans le livre de Peter,
un hiérarque ne se déjuge pas en constatant l'incompétence
d'un salarié qu'il a promu. Permettre une promotion, c'est croire au
potentiel d'un salarié ayant déjà fait ses preuves. On
ne peut être certain de la réussite d'un salarié, comme
on mise sur un cheval ayant déjà un bon palmarès à
son actif. Une promotion s'apparente à un moment dans une dynamique collective
d'accompagnement à la réussite d'un collègue, plus qu'à
un obstacle à franchir dans un 110 mètres haies. Un hiérarque
qui culpabilise d'avoir promu un salarié qui s'est révélé
incompétent à son nouveau poste commet une erreur de jugement.
Il devient alors responsable de la persistance d'un salarié à
un poste qui ne lui est pas destiné.
L'erreur n'est pas d'avoir promu un salarié [19], mais de le maintenir
en place quand il se révèle incompétent. L'accompagnement
qui aurait été nécessaire avant la promotion se trouve
aussi absent après la décision.
o Les objectifs à atteindre
Qu'il y ait une promotion ou non, un certain nombre de salariés ont des
objectifs à atteindre, pas seulement les commerciaux. Un salarié
qui ne les atteint pas peut voir son contrat rompu. Encore fait-il que ces objectifs
soient atteignables. Les mauvais résultats doivent relever d'une insuffisance
professionnelle ou d'une faute imputables au salarié [20]. Ce n'est pas
le cas lorsque les objectifs à atteindre ne sont pas réalistes
en raison, notamment, de l'absence de moyens nécessaires à leur
réalisation [21] ou des difficultés économiques sur le
secteur [22]. Si l'insuffisance est avérée, l'employeur est en
droit de rétrograder le salarié ou de le licencier [23].
Le principe de Peter n'est pas une théorie mise en pratique mais le
constat d'une gestion du personnel manquant parfois de rigueur ou de modèle
théorique. La situation est un ensemble de petites décisions individuelles
et d'une inertie collective. Ce laisser-aller peut naître et subsister
pendant une période économique de vaches grasses.
À l'inverse, le ranking est né en pleine crise à la suite
des chocs pétroliers et de la concurrence asiatique.
Le ranking
À l'inverse du principe de Peter, qui n'est pas intentionnel mais subi
autant par les salariés que par la hiérarchie, la méthode
du ranking (aussi appelée : courbe de vitalité [24]) est d'abord
une théorie voulue pour ne plus subir l'inertie collective, ensuite devenue
une pratique.
Moins ancienne et moins connue [25], elle date des années 1980 et a été
théorisée et mise en pratique par le président du groupe
américain General Electric, Jack Welch. Elle a été mise
en lumière par divers articles et reportages de divers médias.
La théorie
La méthode repose sur un découpage simpliste des salariés
en trois parts : 20 % -70 % -10 %. Il y a 20 % d'excellents éléments,
qui sont les plus productifs, qui bénéficient de primes, 70 %
qui forment le gros de la cohorte et 10 % qui sont non-productifs et qu'il convient
de licencier. Cette opération est amenée à se répéter
chaque année. L'entreprise General Electric l'a appliquée dès
1981, avec une augmentation du profit pendant 20 ans. Cette méthode a
été reprise par beaucoup d'entreprises, qui l'ont ensuite abandonnée
[26].
o Une théorie remise en question
Cette méthode simpliste pose un cadre, dans lequel la réalité
doit se tordre pour s'y adapter. Il est en effet plus facile de classer les
salariés en trois grandes catégories que de les évaluer
individuellement selon leurs mérites. De plus, un salarié classé
parmi les 10 % dans un service peut se révéler d'un meilleur niveau
que le niveau moyen de la concurrence. Un moins bon parmi les très bons.
Être mal classé ne signifie pas être mauvais en soi. Cela
revient à institutionnaliser la mauvaise qualité, même si
elle n'existe pas parmi les salariés d'un service donné. Jack
Welch n'a par ailleurs jamais expliqué comment il fallait noter les salariés,
ni pourquoi il fallait éliminer 10 % plutôt que 5 ou 15.
Les effets pervers sont nombreux :
La stratégie collective de survie
Les managers qui embauchent ne choisiront pas un candidat qui pourrait bousculer
le classement, au point de prendre la place de collègues déjà
en place. D'où la tentation de n'embaucher que des candidats susceptibles
de se retrouver dans la catégorie des 10 % licenciables. La présentation
de ces candidats est alors embellie auprès de la haute hiérarchie
pour éviter la trop grande visibilité de la manœuvre. L'entreprise
se prive donc de nouveaux talents.
Le refus individuel de promotion
Un salarié qui se trouve dans la tranche à 20 % bénéficie
de primes. S'il bénéficie d'une promotion, il devra alors être
dans les meilleurs (les 20 %) pour continuer d'obtenir des primes, alors que
les attentes de sa hiérarchie sont supérieures à celles
de son poste d'origine. Le risque de ne pas toucher de primes devient réel,
malgré le fait de travailler plus et plus durement et finalement toucher
moins qu'à son ancien poste. Pourquoi, dans ce cas, accepter une promotion
? La parade existe dans le fait de n'accepter une promotion que dans un service
dont les performances sont médiocres. Les chances de survie sont plus
élevées, voire certaines.
Le coût du recrutement
Les 10 % qui n'ont pas donné satisfaction devront être renouvelés.
Le recrutement a un coût, et le fait de ne trouver que des candidats de
compétences supérieures n'est pas acquis.
La méthode de classement
Pour pouvoir classer des gens dans la troisième catégorie, la
hiérarchie doit parfois s'aider de moyens déloyaux : harcèlement
moral [27], évaluations truquées [28], sous-notation forcée
[29] et [30]. Surtout quand la troisième catégorie ne doit pas
représenter 10 % mais plus, dans le cas de difficultés économiques
ou de réorganisation. Cette méthode de management devient un outil
pour éviter l'application du Code du travail sur l'accompagnement lié
au licenciement collectif [31].
Cette méthode est illicite et est de surcroît néfaste à moyen ou long terme [32]. De plus, ce qui est légal aux États-Unis ne l'est pas forcément en France.
La réponse prétorienne
Saisie d'un cas d'espèce [33], la Cour de cassation reçoit les
moyens de partie demanderesse :
o que le salarié doit expressément être informé,
préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et
techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à
son égard, et que les méthodes et techniques d'évaluation
des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité
poursuivie [34] ;
o qu'il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de
direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre
la santé et la sécurité des salariés [35] ;
o qu'un système d'évaluation mettant les salariés en concurrence
les uns avec les autres en fonction de critères en partie étrangers
à leurs aptitudes professionnelles est source de stress et de souffrance
;
o que le projet de mise en place d'un système d'évaluation susceptible
de générer une pression psychologique entraînant des répercussions
sur les conditions de travail doit être soumis à la consultation
du CHSCT et du comité d'entreprise [36].
Elle en conclut que la mise en œuvre d'un mode d'évaluation reposant
sur la création de groupes affectés de quotas préétablis
que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite.
Le contrat de travail est un acte juridique reposant sur une fourniture de travail en échange d'une rémunération. Le contrat doit être exécuté de bonne foi. Il s'agit de la fourniture d'un travail et non d'une compétition. Rompre un contrat de travail pour un tel motif n'est donc pas valable.
*
Chaque méthode présentée part de constats de bons sens : chaque personne a ses limites, que ce soit un plafond indépassable ou un plancher trop bas. Le principe de Peter décrit que lorsqu'un salarié a atteint son plafond, il devient un total incompétent dont l'employeur ne peut ou ne veut se débarrasser. Le ranking incite tout employeur à licencier tout salarié dont le niveau de performances est plus bas que celui de ses collègues.
Les Américains ont toujours été friands de nouvelles théories. Les deux citées ci-dessus ne résistent pas à l'observation, et laissent leurs défauts paraître.
Toute entreprise gagne à lutter contre les dérives individualistes que ses méthodes favorisent et doit privilégier l'intégration collective des salariés et la formation.
[1] Parfois appelé " ressources humaines ".
[2] Éditions du Cherche-Midi.
[3] " J'ai eu l'occasion et le privilège d'étudier le mécanisme
de la société civilisée (...) J'ai remarqué que,
à de rares exceptions près, les hommes bousillent leur travail.
Partout, j'ai vu régner l'incompétence (...) J'ai observé
que (...) J'en suis venu à constater l'universalité de l'incompétence
".
[4] Laurence J. Peter & Raymond Hull.
[5] Le principe de Peter, Jean-Paul Delahaye, Pour la Science, n° 407, septembre
2011.
[6] Le principe de Peter, Laurence J. Peter & Raymond Hull, dossier de réflexion,
cas n° 2.
[7] Le principe de Peter, Jean-Paul Delahaye, susmentionné.
[8] Le principe de Peter, Laurence J. Peter & Raymond Hull, page 9.
[9] Pour la mise en œuvre de l'ordre des licenciements,le juge ne peut
substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié
à celle de l'employeur. Cass. soc. 24 septembre 2014, n° de pourvoi
: 12-16991.
[10] Ce n'est donc pas une violation de l'article 6 de la CESDH sur le droit
à un procès équitable.
[11] Cass. soc. pourvoi n° 13-14916.
[12] Cass. soc. pourvoi n° 11-21255 et 06-40950.
[13] Le principe de Peter, Laurence J. Peter & Raymond Hull, chapitre XIV.
[14] Une telle condition requiert l'accord exprès du salarié,
Cass. soc. n° 10-24308.
[15] Ou pour d'autres raisons tout aussi valables : " Parfois, la cause
se trouve dans les conditions de travail du poste vacant, l'entourage/la hiérarchie
avec une mauvaise image, ranking, promotion-piège… ", http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-certains-salaries-refusent-une-promotion-985045.html
[16] Cas de la promotion hiérarchique.
[17] Cas d'une promotion non hiérarchique, dans un autre secteur professionnel
que celui d'origine.
[18] Cass. soc. n° 08-42805, 02-46103, 09-70693, 03-41797.
[19] Sauf si la promotion n'est pas basée sur la compétence, mais
sur les réseaux, le copinage etc.
[20] Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-41028.
[21] En application de l'article 1134 du Code civil, l'employeur doit donner
au salarié les moyens de travailler, y compris la formation nécessaire.
[22] Cass. soc., 22 mars 2012, n° 10-12218.
[23] Cass. soc., 12 février 2002, n° 99-42878, Cass. soc., 13 janvier
2004, n° 01-45931 et 01-45932, Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-21516.
[24] Du fait de son illicéité en France, les DRH préfèrent
la présenter sous des dénominations anodines et mélioratives
: " processus de gestion des talents " ou " procédure
d'évaluation du leadership ".
[25] Il y a 237 000 résultats répondant à la recherche
" principe de Peter " sur le moteur de recherche Google, et 57 500
pour " ranking ".
[26] Un article du Bloomberg businessweek estimait qu'un tiers des entreprises
américaines
" évaluaient les employés en fonction de systèmes
qui les opposaient à leurs collègues ". Selon l'Institute
for Corporate Productivity, 42 % des entreprises interrogées ont déclaré
avoir utilisé un classement forcé en 2009. Toutefois, ce pourcentage
est tombé à 14 % en 2011. https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203363504577186970064375222
[27] https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/video-inventer-exagerer-scenariser-les-trois-astuces-d-un-drh-pour-licencier-des-employes-irreprochables_2645242.html
[28] http://www.leparisien.fr/economie/licencier-1000-personnes-les-confessions-chocs-d-un-drh-17-03-2018-7614120.php
[29] Infliger des évaluations négatives afin de pourvoir prétexter
leur incompétence ou leur manque de résultats pour les licencier
[30] https://www.huffingtonpost.fr/2017/06/09/quand-des-managers-sous-notent-des-salaries-competents-pour-lice_a_22134225/
[31] Article L1233-61 du Code du travail.
[32] Ce qui peut s'avérer bénéfique à court terme
voit souvent l'avenir inverser la tendance. Voir : 'Le paradigme des lapins
et des renards', par Paul Watzlawick
[33] Cass. Soc. 27 mars 2013, n°11-26539
[34] Article L1222-3 du Code du travail
[35] Article L4121-1 du Code du travail
[36] Institutions désormais remplacées par le comité social
et économique
Rémy Poulain
21 05 2018
*
FO saisit le Comité européen des Droits Sociaux
La Confédération Force Ouvrière a déposé
ce jour devant le Comité européen des Droits Sociaux (CEDS) une
réclamation contre la France pour contester une des dispositions –
phare – des ordonnances de 2017 : la mise en place d’un barème
impératif devant les Prud’hommes.
Notre organisation estime que le barème plafonnant la réparation
du préjudice des salariés licenciés de manière injustifiée
est contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne
révisée, en ce qu’il ne remplit pas les critères de
ce que doit être une réparation appropriée, c’est-à-dire
les critères d’adéquation, d’effectivité et de
dissuasion vis-à-vis de l’employeur.
Avec des planchers et des plafonds très bas, ce système d’indemnisation
basé sur le seul critère de l’ancienneté ne permet
plus au juge d’évaluer les autres dommages éventuellement
subis par le salarié tels que l’âge, les mesures vexatoires,
les difficultés liées au bassin d’emploi pour retrouver du
travail. C’est sur la base d’une simple évaluation coûts
– bénéfices que, désormais, l’employeur va pouvoir
se séparer d’un salarié conformément à l’objectif
visé par le gouvernement : sécuriser les employeurs aux dépens
des droits des salariés.
Le juge se trouve donc dorénavant privé de reconnaitre un dommage
plus élevé pour le salarié et de l’indemniser au regard
du préjudice qu’il a réellement subi.
Pour toutes ces raisons, FO demande au CEDS de dire que le barème mis
en place par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est contraire
à l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée.
14 mars 2018
*
L'INDEMNISATION DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE RESPECTE-T-ELLE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE ?
Le Syndicat des Avocats de France (SAF) réagit après la promulgation
des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le droit du travail. Cette
réforme a entre autres modifié à la baisse l'indemnisation
du licenciement sans motif réel ni sérieux. Selon cette organisation,
cette baisse entrerait en conflit avec la Charte Sociale européenne.
"Argumentaire à disposition des salariés, des défenseurs syndicaux et des avocats Contre le plafonnement prévu par le nouvel article L. 1235-3
Sur la réparation intégrale du préjudice et l'inapplicabilité
du plafond de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit
se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force
supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins ête
compatible avec ces normes.
Or l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 indique que : " Les
Traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois […] "
Si le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité
des lois à la Constitution (contrôle de constitutionnalité),
le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions
internationales (contrôle de conventionnalité) appartient en revanche
aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation et
du Conseil d'Etat. (Pour illustration, Décision n° 74-54 DC du 15
janvier 1975 recueil p. 19, Décision n° 86-216 DC du 3 septembre
1986, recueil p. 135)
La Cour de cassation, puis le Conseil d'Etat, se sont reconnus compétents
pour procéder à ce contrôle de conventionnalité.
(Chambre mixte 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Favre,
n° 73-13556 ; Conseil d'Etat, Assemblée Plénière, 20
octobre 1989, Nicolo, n° 108243)
Ce contrôle peut donc conduire, lors de l'examen d'un litige, à
écarter la loi française pour faire prévaloir la convention
internationale dans la résolution du litige.
Tel a été le cas, pour illustration, devant le juge prud'homal,
à l'égard du Contrat Nouvelles Embauches jugé contraire
à la Convention 158 de l'OIT. (CPH Longjumeau, 28 avril 2006, De Wee
c/ Philippe Samzun ; n° 06/00316 ; CA Paris, 18ème E, 6 juillet 2007,
n° S06/06992).
La Cour de cassation a établi que la convention n° 158 était
" directement applicable", et a souligné "la nécessité
de garantir qu'il soit donné pleinement effet aux dispositions de la
convention " (Cass. Soc. 1er juillet 2008, n° 07-44124).
L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée
par la France le 16 mars 1989, dont le Conseil d'Etat a confirmé l'effet
direct (CE Sect., 19 octobre 2005, CGT et a., n° 283471), stipule que si
les tribunaux " arrivent à la conclusion que le licenciement est
injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique
nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances
d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration
du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le
versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation
considérée comme appropriée ".
L'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée
par la France le 7 mai 1999, qui est également d'effet direct (CE, 10
février 2014, M. Fischer, n° 359892), a repris ce même principe
dans les termes suivants :
" En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection
en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (…)
:
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une
indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
"
Le Comité européen des droits sociaux(C.E.D.S), organe en charge
de l'interprétation de la Charte, s'est prononcé sur le sens devant
être donné à l'indemnité adéquate et à
la réparation appropriée dans sa décision du comité
du 8 septembre 2016 " Finish Society of Social Rights c. Finlande "
(n°106/2014, § 45).
Le Comité énonce que " les mécanismes d'indemnisation
sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement
et la décision de l'organe de recours ;
- la possibilité de réintégration ;
- des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader
l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. "
Tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées
ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment
dissuasives est donc, en principe, contraire à la Charte.
La Charte sociale européenne et l'interprétation qu'en fait le
Comité Européen des droits sociaux sont d'application directe
en droit interne français, et doivent conduire le Conseil à faire
prévaloir la nécessité d'une indemnisation intégrale
des préjudices subis par Mr/Mme XXX et à écarter le barème
en fixant une indemnité de 6 mois de salaire à la charge de la
Société YYYY.
La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe
adoptée à Turin en 1961 qui garantit les droits sociaux et économiques
fondamentaux. Elle est le pendant social de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme, qui se réfère aux droits civils et politiques.
Elle garantit un large éventail des Droits de l'Homme liés à
l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation,
à la protection sociale et aux services sociaux.
La Charte est dès lors considérée comme la Constitution sociale de l'Europe.
Le Comité européen des droits sociaux (C.E.D.S) a été
créé dès l'entrée en vigueur de la Charte. Il exerce
depuis 1995 une activité juridictionnelle, ou quasi juridictionnelle,
en tranchant les réclamations collectives introduites par les organisations
nationales ou internationales ainsi que par les organisations non gouvernementales
nationales ou internationales pour apprécier la conformité des
législations, réglementations et pratiques nationales aux exigences
de la Charte sociale européenne.
Le caractère contraignant de la Charte sociale ne fait plus de doute
et les principes qu'elle contient sont directement invocables devant le juge
français.
Ainsi, le Conseil d'Etat a déjà reconnu qu'il s'agissait d'un
traité international dans son arrêt du 7 juillet 2000 (Fédération
nationale des associations tutélaires, n°213461).
La Cour de cassation en a reconnu l'applicabilité directe par un arrêt
du 14 mai 2010 (Soc. 14 mai 2010, n°09-60.426) et se réfère
notamment aux articles 5 et 6 de la Charte dans de nombreuses décisions
sur la liberté syndicale et le droit à la négociation collective.
(Soc. 9 nov. 2010, ns 09-42.064, 09-42.065, 0942.066, 09-42.067, 09-42.068,
et 09-42.069 ; 10 nov. 2010, n° 09-72.856 ; Soc. 1er déc. 2010, n°
10-60.117 ; Soc. 8 déc. 2010, n° 10-60.223). La haute juridiction
s'y référait encore directement dans un arrêt du 15 novembre
2017 (n°16-24884).
S'agissant de l'article 24, le Conseil d'Etat a déjà jugé
que ses dispositions sont directement invocables devant lui puisque son "
objet n'est pas de régir exclusivement les relations entre les Etats
" et qu'elles " ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire
pour produire des effets à l'égard des particuliers, peuvent être
invoqués utilement " (CE 10 février 2014, n°358992, Fischer
-Voir notamment l'analyse du professeur Mouly, Droit social 2017 p 745 )
Quant au juge judiciaire, et notamment le juge prud'homal, il est toujours possible
de soulever devant lui par voie d'exception la non-conformité d'une règle
nationale au regard d'un texte international, la Cour de Cassation soulignant
à cet effet sa volonté de se conformer à l'interprétation
donnée à ce texte international par l'organe international chargé
d'en contrôler l'application (Cass. Soc. 1er juillet 2008, n°07-44.124).
Or dans son arrêt du 8 septembre 2016, le Comité européen
(CEDS) énonce que " tout plafonnement qui aurait pour effet que
les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice
subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est en principe, contraire à
la Charte ".
Le comité en a jugé ainsi à l'égard de la loi finlandaise,
qui se bornait à fixer un plancher de 3 mois et un plafond de 24 mois,
en invitant le juge à fixer entre ces 2 limites légales l'indemnisation
en tenant compte de l'ancienneté, de l'âge du salarié, de
ses perspectives de retrouver un emploi équivalent, de la durée
de son inactivité, et de la situation générale du salarié
et de l'employeur.
Le CEDS a estimé cette législation contraire à la charte
en soulignant que dans certains cas de licenciement abusif, l'octroi d'une indemnisation
plafonnée à hauteur de 24 mois peut ne pas suffire pour compenser
les pertes et le préjudice subis : " (…) que dans certains
cas de licenciement abusif, l'octroi d'une indemnisation à hauteur de
24 mois prévue par la loi relative au contrat de travail peut ne pas
suffire pour compenser les pertes et le préjudice subis. (…) Le
Comité considère que le plafonnement de l'indemnisation prévue
par la loi relative au contrat de travail peut laisser subsister des situations
dans lesquelles l'indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice
subi. En outre, il ne peut conclure que des voies de droit alternatives sont
prévues pour constituer un recours dans de telles situations ".
(CEDS 8 septembre 2016 § 45)
Il en est a fortiori de même à l'égard des barèmes
fixés par le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail qui prétendent
imposer un plafonnement bien inférieur, et limité à seulement
XXX mois de salaire compte tenu uniquement de l'ancienneté de Mr/Mme
XXX.
Le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 est plafonné
à 20 et non 24 mois de salaire. Et à l'égard des anciennetés
les plus faibles, il est flagrant qu'il ne permet pas au Juge de tenir compte
de l'ensemble des éléments de situation du salarié qui
alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux.
Une ancienneté faible n'exclut pas la nécessité d'indemniser
en fonction notamment :
- d'une situation personnelle rendant critique la perte d'emploi (âge,
situation de famille, handicap…) ;
- et/ou ou d'une situation professionnelle rendant la recherche d'un nouvel
emploi plus difficile (éloignement géographique, spécialité
rare,…) ;
- et/ou d'un préjudice professionnel réel plus lourd que l'ancienneté
ne permet de le mesurer (par exemple salarié pouvant avoir été
démarché alors qu'il était en poste et a ainsi renoncé
à l'ancienneté de son ancien contrat pour subir finalement un
licenciement…).
D'ailleurs le barème en vigueur depuis le 23 septembre 2017 ne permet
assurément pas au Juge de moduler l'appréciation des préjudices
du salarié en fonction des différents paramètres de sa
situation lorsqu'il existe si peu de marge laissée entre le plancher
et le plafond (pour une ancienneté de 2 ans, le plancher est de 3 mois
et le plafond de 3,5 mois et pour une ancienneté de 3 ans, le plancher
est de 3 mois et le plafond de 4…).
C'est encore plus criant lorsque le salarié licencié pour motif
économique doit encore recevoir, dans la limite de ce plafond, l'indemnisation
de l'ensemble de ses préjudices, au titre du licenciement sans cause
réelle et sérieuse mais aussi du non-respect de la priorité
de réembauchage ou des critères d'ordre de licenciement, comme
l'impose désormais la même réforme.
Or en droit français il n'existe aucune voie de droit alternative pour
que le salarié obtienne une indemnisation complémentaire dans
le cadre de son licenciement. Depuis la loi du 13 juillet 1973, l'action permettant
au salarié d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause
réelle ni sérieuse est exclusive de toute autre action sur le
terrain de la responsabilité civile.
Et la Cour de cassation, tout en visant expressément le principe de réparation intégrale dans sa décision publiée du 14 septembre 2017, faisait grief à une cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle avait déjà condamné l'employeur à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-11.563, publié)
Le juge prud'homal français a donc l'obligation de fixer une seule et
unique indemnisation de tous les préjudices nés du licenciement,
et l'Ordonnance du 22 septembre 2017 a enfermé cette indemnisation dans
le barème plafonné.
Plus encore que le système finlandais, le mécanisme de barème
français ne permet donc pas de s'assurer que le salarié pourra
recevoir l'indemnisation intégrale des préjudices subis.
Qu'il existe des exceptions au plafonnement, énumérées
à l'article L. 1235-3-1, notamment en cas de discrimination ou de harcèlement,
ne doit en rien faire douter de cette réalité puisque le principe
de réparation intégrale doit présenter un caractère
général.
En outre les plafonds fixés aussi bas pour les anciennetés faibles
ou modérées ne correspondent plus à des " indemnités
d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur "
et manquent au second objectif mis en évidence par le CEDS.
C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'objectif avoué de la réforme
: sécuriser les employeurs par la prévisibilité d'un plafond
maximum de leur condamnation, quitte à amoindrir très sensiblement
les indemnisations qui ne sont pourtant pas consécutives à la
réalisation d'un risque, mais viennent sanctionner une faute.
En réduisant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse par des plafonds trop bas, c'est bien la sanction de la violation
de la loi qui perd son effet dissuasif à l'égard des employeurs
qui peuvent " budgéter " leur faute.
Ce barème viole donc à double égard l'article 24 de la
Charte européenne des droits sociaux.
Il décourage en outre les salariés d'agir en justice pour faire
valoir leurs droits au regard d'espoir d'indemnisation dérisoires, alors
qu'en application de la convention 158 de l'OIT, le droit de n'être licencié
que pour un motif valable est un droit fondamental (article 4), et que sa violation
exige d'habiliter le Juge " à ordonner le versement d'une indemnité
adéquate " à défaut de réintégration
possible (article 10).
Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, le " prix de la violation de
la Loi ", formule du professeur Pascal Lokiec, est fixé si bas pour
les salariés de faible ou moyenne ancienneté, qu'il constitue
une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs
que constituent les licenciements sans cause réelle ni sérieuse.
Ce barème peut être même incitatif à prononcer des
licenciements injustifiés, s'ils ont été provisionnés,
ce qui est manifestement à l'opposé de l'objectif de dissuasion
mis en avant par le CEDS.
Enfin, le droit au procès équitable, protégé par
la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est plus garanti lorsque
le pouvoir du juge se retrouve ainsi drastiquement limité. (voir notamment
Marie-Laure Morin, Droit Ouvrier oct. 2017 p. 596-597)
En conséquence, il est demandé à titre principal de dire
et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation
prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale
européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le
droit au procès équitable."
6 février 2018
*
Les cadres parviennent à négocier une meilleure indemnité de rupture conventionnelle.
Une récente étude commandée par le ministère du Travail* fait le point sur les montants obtenus par les salariés lors des négociations de ruptures conventionnelles individuelles du contrat de travail. L’étude publiée ce 30 janvier par la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) analyse les données recueillies en 2015. Cadremploi a extrait les données concernant en particuliers les cadres.
La rupture conventionnelle, le « jackpot » pour
les cadres
Dans les textes, l’indemnité de rupture conventionnelle est au moins
équivalente à l’indemnité légale de licenciement,
et le cas échéant, à l’indemnité conventionnelle
si elle est plus favorable au salarié. Mais dans les faits, il y a moyen
de négocier. A titre de comparaison, les ouvriers et employés
payés 2 000 euros bruts par mois (avec 5 ans d’ancienneté)
obtiennent les indemnités légales, point barre. Soit 2 000 euros.
Tandis qu’à ce petit jeu, les cadres se montrent plus persuasifs
:
La moitié des cadres émargeant à 2 950 euros bruts par
mois et ayant 5 à 10 ans d’ancienneté (soit 25 % des cadres)
ont obtenu des indemnités supérieures de 45 % aux indemnités
légales. Soit des primes de départ comprises entre 4 277 euros
et 8 555 euros.
Ceux avec un salaire brut mensuel compris entre 3 650 euros et 4 850 euros (et
5 ans d’ancienneté) peuvent espérer dépasser le minimum
légal de 65 %. Soit percevoir entre 6 022 et 8 000 euros.
Enfin, pour les très hauts revenus (plus de 8600 euros/mois), la moitié
des salariés obtient une indemnité de départ représentant
trois fois l’indemnité légale.
« Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte l’indemnité
transactionnelle en général négociée en plus de
la rupture conventionnelle. Un cadre avec 5 à 10 ans d’ancienneté
touchant 5 000 euros par mois, peut au total obtenir 30 000 à 50 000
euros », prévient Laurent Parras, avocat en droit du travail.
Une cagnotte variable selon le secteur d’activité
C’est visiblement dans le secteur des transports que les cadres peuvent
toucher le gros lot. « Dans la moitié des cas, l’indemnité
de licenciement est au moins 1,78 fois supérieure au minimum de référence
», pointe la Dares. L’industrie, l’immobilier, l’information/communication,
les activités financières ou d’assurance offrent également
des marges de négociation intéressantes. A l’inverse, elles
seront plus minces si vous bossez (sic) dans les secteurs de l’hébergement
et de la restauration, dans le commerce, l’enseignement, la santé
et l’action sociale.
Pourquoi des indemnités de rupture plus importantes
pour les cadres ?
Le ministère du Travail y voit plusieurs explications. D’abord des
conventions collectives très avantageuses pour les cadres en termes de
conditions de licenciement. Ainsi, « la négociation collective
permet un surplus de 40 % par rapport au minimum légal pour les cadres
de plus de 3 ans d’ancienneté », soulignent les auteurs de
l’étude.
Deuxième explication : les employeurs sont davantage à l’initiative des ruptures conventionnelles pour les cadres que pour les ouvriers et employés. Dans ce cas, la RCI s’apparente plus à « une transaction après licenciement » voulu par l’employeur. Ce dernier est alors plus enclin à négocier avec son collaborateur cadre afin de minimiser les risques de contentieux.
Les cadres pâtissent également moins que les autres du lien de subordination avec leurs employeurs. Les auteurs de l’étude insistent également sur le fait que les cadres ont une meilleure connaissance du droit du travail. Les rendant ainsi plus prompts à oser demander. Et donc à obtenir des indemnités supra-légales.
Se faire assister peut rapporter plus gros !
A sa demande, un salarié peut être assisté par toute personne
de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (ou issu d’une
liste fournie par la Dirrecte locale) dans sa démarche de rupture conventionnelle.
En 2015, seuls 5,6 % des salariés ont bénéficié
d’une assistance au cours d’un entretien préalable à
la rupture. Et cette assistance n’est pas neutre sur le montant des indemnités.
Parmi les cadres assistés au cours d’un entretien préalable,
près d’un sur deux ont reçu une indemnité au moins
50 % supérieure au minimum légal contre 33,5 % parmi les cadres
non assistés.
A noter que les collaborateurs peuvent aussi se faire accompagner par un avocat. Ce dernier ne peut pas assister en direct à l’entretien mais faire du coaching en amont. « Je leur explique quoi dire ou pas. Et puis, une fois que les deux parties sont d’accord sur le principe de la rupture, je peux négocier le montant des indemnités en direct avec l’entreprise ou avec le conseil de cette dernière, ou conseiller mon client en « sous marin ». En général, on multiplie par 1,5 ou 2 le montant de départ », illustre maitre Parras. Attention, toutes les entreprises ne supportent pas de négocier avec un avocat. « Les TPE préfèrent parfois aller au contentieux », conclut-il.
Depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement représente désormais un quart de mois de salaire par année d’ancienneté sur les 10 premières années, puis un tiers du salaire mensuel pour les suivantes. Source
Note de Lelicenciement.fr : A noter que l'étude de Romain Melot sur les transactions indiquait en 2001 "La proportion beaucoup plus faible de cadres dans les dossiers en contexte judiciaire traduit sans doute de la part des directions d’entreprise un souci d’anticipation du traitement des litiges à l’égard de ces salariés parfois haut placés dans la hiérarchie, et qui disposent par ailleurs, en raison du risque économique qu’ils représentent en termes de coûts de procès, d’un rapport de forces favorable à la négociation."
*
PRUD’HOMMES : depuis la loi Macron de 2015, le nombre des saisines est en chute
*
PRUD’HOMMES : PEUT-ON EXPLIQUER LA DISPARITÉ DES DÉCISIONS ?
Résumé de l'étude :
L’incertitude autour de l’issue des procédures aux prud'hommes est souvent pointée du doigt comme un frein possible à l’embauche. Cette incertitude serait en partie générée par le fait que des cas similaires portés devant les prud'hommes seraient jugés très différemment d'une fois sur
l'autre, ou d’une juridiction à l’autre. Après avoir rappelé l'objectif historique de l’institution prud’homale, son mode de fonctionnement et ses évolutions récentes, cette note montre que les décisions rendues aux prud'homme s varient effectivement fortement d'une juridiction à l'autre. La source de cette variabilité demeure pour autant incertaine : elle peut tout autant refléter le caractère arbitraire de la justice prud'homale que le fait que les affaires jugées par les différentes juridictions sont de nature et de gravité différentes. Cette note s'appuie finalement sur les travaux de Desrieux et Espinosa pour montrer que l’appartenance syndicale des juges élus par les salariés n'influence pas les décisions rendues par les prud'hommes. Ce résultat permet d'écarter une source possible de partialité dans la justice rendue par les différentes juridictions prud'homales.*
Patrice Evra peut-il être licencié par l’OM ?
Le club de football Olympique de Marseille a publié, le 3 novembre, le communiqué de presse suivant :
Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille,
a rencontré Patrice Evra ce jour et lui a signifié sa mise à pied avec effet
immédiat et sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction
disciplinaire. En outre, les premiers résultats de l’enquête interne diligentée
par le club font apparaître un comportement inacceptable de la part d’une
poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement
graves à l’encontre du joueur et ce, alors que celui-ci et ses coéquipiers
s’échauffaient en vue d’une rencontre importante. En tant que joueur professionnel
et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d’une manière aussi
inappropriée. Le club poursuit son
enquête et utilisera tous les moyens de droit à sa disposition à l’encontre
d’individus qui, sous couvert de leur passion pour l’OM, mettent en danger sa
réputation en pénétrant sur le terrain et en injuriant un joueur au lieu de le
soutenir.
Patrice Evra est-il un salarié ?
Oui, comme la totalité des joueurs de football professionnel, Patrice Evra est
un salarié, embauché en contrat à durée déterminée d’usage, comme permet l’article L1242-2 §3 du
Code du travail.
Quels sont les textes qui
s’appliquent ?
Les
relations entre le salarié et son employeur sont régies par le Code du travail,
la Convention collective Nationale applicable, en l’espèce, celle du Sport, et
le contrat de travail, avec ses annexes et ses avenants.
Mais comme il s’agit du domaine du sport, d’autres textes s’appliquent, en particulier ceux de l’autorité sportive compétente, la ligue professionnelle de football.
Qu’implique la signification d’une mise à
pied avec effet immédiat et la convocation à un entretien préalable à une
éventuelle sanction disciplinaire ?
Le
communiqué de presse ne détaille pas s’il s’agit d’une mise à pied
disciplinaire ou conservatoire. Il s’agit sans doute de la seconde.
- La mise à pied conservatoire est une mesure temporaire que prend l’employeur
qui consiste à suspendre le contrat de travail d'un salarié, le temps de tirer
au clair une situation. Cette mesure vise à prévenir les situations de danger
et de désordre que pourrait entraîner le maintien du salarié fautif dans
l'entreprise (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983). De fait, la mise à pied
conservatoire est généralement suivie d’une convocation à un entretien, ce qui
est le cas présentement.
- La mise à pied disciplinaire, qui doit être prévue au règlement intérieur de
l’entreprise, est une mesure disciplinaire et définitive à titre de sanction.
Dans les deux cas, le salarié n’a plus le droit de pénétrer le lieu de travail. Il peut toutefois assister aux matchs à l’intérieur d’un stade en tant que spectateur. Sa rémunération est en principe suspendue jusqu’à la fin de la mise à pied, c'est-à-dire une fois que l’employeur aura décidé.
L’employeur a convoqué son joueur à un entretien préalable à
éventuelle sanction disciplinaire. S’il s’agissait d’un entretien pouvant
déboucher sur un licenciement, l’employeur aurait du préciser dans la lettre
qu’il s’agissait d’un entretien préalable à un licenciement. En effet, la
lettre de convocation doit contenir l'indication non équivoque qu'un
licenciement est envisagé (Cass. soc. 4 avril 1995 n° 93-45634).
Soit le communiqué de presse est resté, volontairement ou non, vague ou
équivoque sur l’objet de l’entretien, soit il ne s’agit que d’un entretien ne
pouvant déboucher que sur une sanction prévue au règlement intérieur (en
application de l’article 12.5 de la convention collective), mais pas un
licenciement. Une convocation à un entretien qui n’indique pas que celui-ci
peut déboucher sur un licenciement rend ce dernier sans cause réelle et
sérieuse, car c’est une formalité substantielle à respecter. Si l’OM licencie
Patrice Evra, ce dernier pourra saisir le conseil de prud’hommes et obtenir
réparation, mais sans pouvoir réintégrer le club.
Le fait que des personnes ont, semble-t-il,
provoqué le joueur, joue-t-il en faveur de Patrice Evra ?
L’OM a
d’ores et déjà reconnu qu’une poignée de provocateurs ont proféré des injures
haineuses particulièrement graves à l’encontre du joueur et ont eu un comportement
inacceptable. L’OM, en tant qu’employeur, a mis ses joueurs, donc ses salariés,
dans une situation ou leur intégrité tant physique que mentale n’avaient pas
été protégées. Par ce communiqué de presse, l’employeur reconnait sa
responsabilité, et donc sa faute. Car tout employeur a une obligation de
sécurité de résultat.
Dans le cas présent, même si ce stade n’appartenait pas à l’employeur, ce dernier a envoyé ses salariés dans un endroit ou ceux-ci se sont fait agresser verbalement, voire plus. L’employeur a bien analysé la situation, et compris le danger : le fait que le joueur puisse accuser l’OM de l’avoir placé dans une situation où son intégrité physique et mentale avaient été mises en danger, par négligence. Et la validité du licenciement pourrait être retoquée par les juges du travail.
Que peut faire Patrice Evra ?
Le joueur
peut dès aujourd’hui tirer la conclusion que l’employeur a fait preuve de
légèreté blâmable en le laissant à la merci de personnes nuisibles et
potentiellement dangereuses, tant pour son intégrité morale que physique. Les
problèmes de sécurité dans les stades de foot sont connus depuis suffisamment longtemps
pour que l’OM ne puisse arguer de l’imprévisibilité des provocations et autres actes
malfaisants. Le joueur peut donc prendre acte de la rupture de son contrat de
travail du fait de l’employeur, ce dernier ayant commis une faute inexcusable.
Il pourra ensuite obtenir le paiement des salaires restant jusqu’à la fin de
son contrat, soit de manière amiable, soit en saisissant le conseil de
prud’hommes.
Ceux qui s’attendaient à un licenciement pour faute grave avec pertes
et fracas risquent d’en être pour leurs frais.
La solution qui arrangerait tous les protagonistes : un licenciement pour
inaptitude.
R. P. , Novembre 2017.
*
Actualité du licenciement 2016/2017
Un salarié qui avise son employeur, au moment de son entretien préalable, du mandat extérieur qu'il détient ne commet pas de faute. ( Cass. Soc. n° 14-26249 du 10 mai 2016 )
*
En application de l'article L2411-1 du Code du travail, le conseiller du salarié est un des 18 mandats légaux bénéficiant d'une 'protection' contre les licenciements. En revanche, l'article L2413-1 indique que lors d'un non-renouvellement ou d'interruption d'un contrat de mission d'un salarié temporaire, cette liste se réduit à 15 mandats, en y ôtant les conseillers du salarié. ( Cass. Soc. n° 15-27286 et 15-27320 du 12 juillet 2017). C'est une décision contradictoire avec celle du 13 février 2012, qui indiquait que le conseiller du salarié était protégé dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission.
*
Un salarié était déjà titulaire d'un mandat de conseiller du salarié lors de la signature d'un contrat de travail temporaire. Peu de temps avant le terme de sa mission et après avoir appris que la mission ne serait pas reconduite, le salarié prévient son employeur de l'existence de son mandat de conseiller du salarié. Ce salarié n'attend pas la réaction de son employeur, et saisit immédiatement le conseil de prud'hommes. A noter que ce salarié avait auparavant déjà tiré parti de sa qualité de conseiller du salarié pour agir contre plusieurs autres employeurs. Pour la Cour de cassation, le salarié commet un abus de droit, et ne peut donc invoquer sa qualité de salarié protégé. ( Cass. Soc. n° 15-27286 et 15-27320 du 12 juillet 2017)
*
La lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement n'est pas obligée de mentionner l'identité des délégués du personnel. Un salarié qui ignore l'identité de ses délégués ne pourra donc bénéficier que d'un droit théorique d'assistance, mais pratiquement privé d'effectivité. ( Cass. Soc. n° 15-12522 du 14 juin 2016)
*
Un salarié détenant le mandat de conseiller du salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement doit, au plus tard lors de cet entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat. Mais cette exigence ne saurait être étendue à l'obligation d'informer l'employeur des conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur. ( Cass. Soc. n° 15-12982 du 30 juin 2016)
*
La procédure participative : une bonne solution pour résoudre les conflits au travail ?
La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, ouvre désormais
la voie de la procédure participative aux conflits du travail.
Cette procédure rapide mais payante (à la fois pour le salarié
et pour l'employeur) se pose en concurrence des prud'hommes. Elle nécessite
le plus souvent la présence d'un avocat.
Et clairement, le
salarié n'a rien à gagner à accepter de s'engager dans
cette procédure.
*
Comme le soulignent Gwenola Bargain et Tatiana Sachs dans un article récent, l’idée de plafonner les montants de l’indemnisation octroyée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse revient de manière récurrente dans les projets de réforme du Code du travail.
Bien qu’ayant fait une apparition « éphémère » dans l’avant-projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, dit « projet de loi El Khomri », l’idée de contrôler les indemnités prud’homales a été présente dans l’avant-projet d’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi de 2013, avant d’en être supprimée. Réintroduite en 2015, dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, elle a buté sur la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-715 du 5 août 2015.
Les économistes spécialisés dans la production de rapports et d’analyse du droit du travail mettent au cœur des diagnostics nouveaux sur les effets de la protection de l’emploi en termes de performance du marché du travail l’enjeu de l’insécurité juridique.
Plus précisément, les conseils de prud’hommes seraient des institutions génératrices d’insécurité pour les employeurs, compte tenu de l’incertitude sur les coûts de la séparation que ces juridictions fixent in fine. Parmi les facteurs d’incertitude sur les coûts définitifs du licenciement, figure en bonne place le montant de l’indemnité prud’homale, c’est-à-dire le montant octroyé au salarié victime d’un licenciement abusif.
Juridiquement, cette indemnité est compensatrice d’un préjudice. Elle est fixée de manière souveraine par le juge, qui dispose d’un « pouvoir souverain d’appréciation », lequel n’est pas contrôlé par le juge du droit, c’est-à-dire la Cour de cassation. Peut-on, de ce principe important dans le droit français, déduire que le contentieux est en quelque sorte imprévisible, qu’il relève d’une roulette russe ? Et, en allant plus loin, que la viabilité des entreprises de petite taille serait mise en péril par leur condamnation à payer des montants déraisonnables ? Beaucoup de fantasmes s’expriment, qui ne s’appuient pas sur des données empiriques.
La présente note se propose de contribuer au débat sur la question des indemnités prud’homales, de manière raisonnée, à partir d’une exploration empirique menée sur 83 jugements de conseils de prud’hommes statuant sur des demandes formulées, par des salariés licenciés, d’obtenir une compensation monétaire du caractère abusif du licenciement. Ces jugements, rendus de 1998 à 2008, ont été recueillis sur la base de données juridique Lamyline.Reflex. Tous ont été publiés au Lamy-Prud’hommes.
Les jugements ont été analysés comme suit : quelle section du Conseil de prud’hommes a rendu le jugement ? quel a été le montant attribué au salarié ? Quel est le salaire mensuel du salarié ? Quelle était la qualification professionnelle du salarié ? Dans quel type d’entreprise travaillait-il ? Combien de mois de salaires l’indemnité représente-t-elle ?
Par souci de simplification, les salariés ont été classés en quatre catégories : cadres, employés, ouvriers de l’industrie ou de l’agriculture, et techniciens. Concernant les employeurs, il a été possible d’identifier leur type : entreprise publique, PME, groupe, association, et particulier. Les principaux résultats sont les suivants :
(1) La section « encadrement » des CPH accorde en moyenne plus de trois fois d’indemnités que la section « industrie » et plus de cinq fois que la section « commerce ». Le montant moyen décidé par la section « encadrement » est de 37 824€. Pour les sections « industrie » et « activités diverses », les montants moyens sont respectivement de 11 728€ et 10 408€. Pour les sections « commerce » et « agriculture » on constate des montants moyens de 7 377€ et 6 227€ (figure 1).
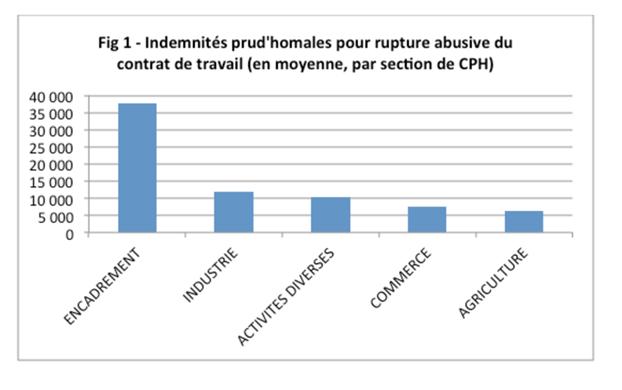
(2) En moyenne, les groupes sont condamnés à trois fois plus d’indemnités prud’homales que les PME (figure2). Les indemnités prud’homales allouées à des salariés de groupes s’élèvent en moyenne à 35 677€, alors que celles décidées en faveur de salariés de PME s’élèvent en moyenne à 8 039€.
(3) En moyenne, les cadres touchent trois fois plus d’indemnités que les ouvriers et techniciens, et six fois plus que les employés, qui représentent les principaux usagers salariés des conseils de prud’hommes. Le montant moyen d’indemnités prud’homales octroyées aux cadres est de 37 824 €. Pour les techniciens, ouvriers et emplois, les montants moyens s’établissent respectivement à 13 014€, 12 488€ et 6 379€ (figure 3). De ce point de vue, les employés sont en quelque sorte six fois moins bien protégés que les cadres (parmi lesquels certains sont cadres dirigeants…). Les différences en moyenne entre les cadres et les autres salariés s’expliquent naturellement par les différences de niveau de rémunération. Reste à préciser le nombre de mois de salaire auxquels correspond l’indemnité prud’homale.
(4) On n’observe pas, en moyenne, de différence significative entre les cadres et les autres salariés en termes d’équivalents en mois de salaire des indemnités prud’homales, du moins pour les 66 jugements qui permettent de saisir cette information (tableau 1). Pour les cadres, les employés et les techniciens, les indemnités pour licenciement abusif représentent en moyenne 6 mois de salaire. Par contre, on observe une nette différence selon que l’employeur est une PME ou un groupe : 5,1 mois de salaire en moyenne pour les PME, 8 mois pour les groupes.
(5) Le taux de refus d’octroi d’une indemnité pour licenciement abusif est nettement plus important pour les associations et les PME que pour les groupes (figure 4). Les conseils de prud’hommes ne font pas droit à toutes les demandes formées par les salariés. Dans certains cas, leur demande est totalement déboutée ; dans d’autres, la juridiction prud’homale fait droit à certaines demandes, mais refuse au salarié le bénéfice d’une indemnité pour licenciement abusif. Lorsque l’employeur est une association, la moitié seulement des demandes d’indemnités est acceptée. Pour les PME, 43 % des demandes d’indemnité sont rejetées, alors que pour les groupes ce taux s’élève à 31 %.
En conclusion de cette brève note, l’analyse de 83 jugements prud’homaux menée ici ne permet pas de conclure à une contrainte forte qu’exerceraient les conseils de prud’hommes sur les PME, qui sont plus préservées, en montant moyen, en mois de salaire et en taux de rejet des demandes formées par les salariés, que les entreprises appartenant à des groupes. Sous réserve de confirmation de ce constat par d’autres analyses sur une base de jugements plus étendue, il semble réaliste de considérer que les juridictions prud’homales prennent en considération la situation économique des employeurs lorsqu’elles statuent sur les demandes d’indemnité pour licenciement abusif.
D’autre part, les montants moyens d’indemnités prud’homales varient selon la qualification et le niveau de salaire. Les cadres sont favorisés par le fait qu’ils sont beaucoup plus rémunérés que les techniciens, ouvriers et employés. Les conseils de prud’hommes évaluent en moyenne le montant des indemnités prud’homales à six mois pour les cadres, les techniciens et les employés.
Enfin, du point de la dispersion des montants d’indemnités, l’écart-type des montants moyens est nettement plus important pour les cadres que pour les employés, respectivement 40 732 € et 3 593 €. Cependant, la compréhension des raisons pour lesquelles les montants varient selon les jugements ne peut être assurée par une simple analyse de dispersion. Les jugements des conseils de prud’hommes sont décidés en fonction de la particularité du cas. Les cas ne sont pas naturellement comparables entre eux. Des études plus approfondies de cette question seraient du plus grand intérêt.
Auteur : Thierry Kirat, Directeur de recherche au CNRS (IRISSO, Paris-Dauphine), , Université Paris Dauphine – PSL.
POUR UNE ÉVOLUTION
DES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES CONSEILLERS DU SALARIÉ
Le nouvel
exécutif veut réformer le monde du travail par ordonnances. Les Institutions
Représentatives du Personnel n’échappent pas à ce tourbillon législatif. Les
délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise fusionneront avec le
CHSCT dans une instance unique, le Comité Social et Economique
Parfois
incluse à tort, dans les IRP, la discrète mission de conseiller du salarié va
sur sa vingt-septième année d’existence. Echappera-t-elle à une réforme de son
mode de désignation et de sa mission ? Les 10000 conseillers du salarié et
les syndicats qui alimentent la fonction à 98% doivent-ils se remettre en
question ?
LES
CONSEILLERS DU SALARIÉ : LA NOTION, LE RÉGIME
Le conseiller
du salarié a été pensé dès le départ comme un moyen d’écarter la présence
syndicale. L’expert neutre, le négociateur tiers, a abandonné très rapidement
une place qui n’était pas la sienne. La nature ayant horreur de vide, ce sont
les syndicalistes qui se sont emparés de la mission, et l’ont réorientée.
La définition des conseillers du
salarié et leur rôle
L’employeur
qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un
entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge. La lettre de convocation prévue à
l'article L. 1232-2 du Code du travail indique l'objet de l'entretien entre le
salarié et l'employeur[1]. Elle rappelle que le
salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions
représentatives dans l'entreprise[2] par un conseiller du
salarié[3].
La Cour de cassation a jugé qu’en présence d’un seul représentant du personnel
dans l’entreprise, et que ce dernier est convoqué, il peut se faire assister
d’une personne extérieure à l’entreprise. Si la lettre de convocation n'indique
pas que le salarié peut se faire accompagner par un conseiller du salarié,
c'est soit que l'employeur a commis une erreur, soit qu'il y a un ou des
représentants du personnel dans l'entreprise ou dans l'unité économique et
sociale[4].
Il se peut que l'établissement dans lequel travaille le salarié n'ait pas de
représentant, mais qu'il en existe un ou plusieurs dans d'autres établissements
de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur n'est pas obligé de fournir au
salarié les coordonnées de ce représentant du personnel[5]. Même si ce représentant
du personnel est à l'autre bout de la France, et que le salarié convoqué à un
entretien préalable au licenciement ignore son nom et ses coordonnées, la Cour
de cassation a considéré qu’il n’y avait pas défaut de possibilité
d’assistance.
Le rôle des conseillers du salarié
Le conseiller du
salarié ne peut être assimilé à un délégué du personnel itinérant. Il y a
certes une mission commune, celle de pouvoir assister un salarié lors d’un
entretien préalable au licenciement. Mais tout le reste diffère[6]. La proximité ou
ressemblance de certaines missions n’entraine pas l’identité des
fonctions.
Rappelons
que la mission du délégué du personnel est de représenter le personnel auprès
de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou
collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du
travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et
sécurité…). Il n’en est rien pour le conseiller du salarié, qui ne peut
qu’assister un salarié et non le représenter, n’est aucunement porteur de
réclamation, et il n’appartient pas à un
conseiller qui constate, à l’occasion de sa mission dans l’entreprise, des
situations non conformes aux dispositions relatives à la réglementation du
travail ou aux règles concernant l’hygiène et la sécurité d’en référer à
l’inspection du travail compétente.[7] Il convient d’ailleurs de
se demander si les conseillers pourraient être à même de pouvoir informer le
CODAF[8] en cas de situation de
travail dissimulé. Le délégué du personnel peut effectuer un mandat entier sans
assister un salarié lors d’un entretien. Sa mission première est d’ordre
collectif, et sa présence est attendue lors des réunions mensuelles. Pour un
délégué du personnel, l’assistance d’un salarié n’est qu’une mission
accessoire, alors qu’elle représente l’unique activité du conseiller du
salarié, inscrit sur une liste extérieure.
Pas d’assimilation du conseiller du
salarié aux IRP
Le conseiller ne représente pas, il assiste. Son champ d’action n’est pas le
personnel, au sens collectif, mais juste un salarié. Il entre dans la catégorie
des IAS, Institutions d’Assistance du Salarié, dont le champ est l’individu et
le moyen l’assistance.
L’employeur informe les IRP de sa structure, et leur remet des renseignements
par voie écrite sur divers sujets[9]. Il n’en est rien pour les
conseillers qui ne sont destinataires d’aucun document.
Les IRP sont
internes, le conseiller du salarié est externe, tout comme le défenseur
syndical, dont le statut a été modifié en 2016. Ces deux dernières institutions
présentent plusieurs points communs :
- elles sont externes à l’entreprise,
- la contestation de leur désignation se fait auprès du tribunal administratif,
alors que celle des IRP se déroule auprès du tribunal d’instance,
- elles n’ont pas l’initiative de chaque mission, alors que les IRP peuvent
agir sans qu’un salarié le leur demande,
- les IRP ont une fonction, un mandat, pérenne, ininterrompu.
- les IAS ont une mission[10], non pérenne,
discontinue.
Les conseillers du salarié agissent sans mandat écrit du salarié. De cette
oralité découle un engagement, qui n’est pas un mandat. Le conseiller ne
dispose d’ailleurs d’aucun mandat ou pouvoir, ni du salarié, ni du syndicat, ni
de la DIRECCTE, ni du Préfet de région qui le nomme[11].
Les défenseurs syndicaux, eux, disposent d’un mandat écrit de leur syndicat, et
peuvent opérer grâce au pouvoir que leur remet le salarié. Tant le défenseur syndical
que le conseiller du salarié entrent donc dans la catégorie des IAS.
IAS et IRP sont les deux branches des Institutions de Représentation et
d’Assistance des Salariés (IRAS).
Leur
définition et leur rôle étant définis, les conseillers du salarié peuvent
désormais agir une fois leur désignation effectuée.
2) La désignation du conseiller du
salarié
C’est l’article D1232-4 du Code du
travail qui détermine l’élaboration de la liste départementale des conseillers.
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des
relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Loin de l’idée que l’on
s’en fait, la mission de conseiller du salarié n’est pas un mandat syndical
formel. Si les organisations patronales et syndicales sont consultées, du moins
sur le papier, les syndicats n’ont pas le monopole de la présentation des
candidats. Lors de la création de l’assistance extérieure des salariés
dépourvus de représentant du personnel en 1989, l’idée était même d’écarter les
syndicats[12],
dont le rôle est de défendre les salariés. Jean Pierre Soisson, alors ministre
du travail, déclara devant le Sénat que loin d’être une brigade de négociateurs,
la personne qui assisterait un salarié pourrait être un fonctionnaire en retraite ou un cadre retiré des
affaires qui accepte bénévolement d'apporter son assistance[13]. Le
fait d’écarter les syndicats comme naturels pourvoyeurs de défenseurs des salariés
embarrassa les sénateurs radicaux[14],
centristes[15],
et fit même s’étonner l’opposition de droite[16] [17].
Peu de volontaires non syndiqués
Les volontaires, anciens conseillers
prud’hommes, anciens magistrats et anciens fonctionnaires du travail, furent en
nombre assez faible[18] [19]. Il en ressortit des
défaillances de présentation. Pour masquer l’échec, les Directions
départementales demandèrent aux syndicats de présenter des volontaires[20]. Certains syndicats
saisirent cette occasion inespérée d’entrer dans les PME, et les inondèrent
[les listes de conseillers] de candidatures (permanents, délégués syndicaux
essentiellement)[21].
Loin d’être de paisibles retraités, les
personnes désignées par les directeurs du travail étaient le plus souvent des
syndicalistes en activité, et en majorité, des cégétistes. L’opposition
parlementaire s’est émue de cette situation[22].
Leurs pires craintes s’avéraient dépassées par la réalité. Le Sénat, à majorité
de droite, se demanda s’il est raisonnable que les préfets aient systématiquement
désigné sur les listes [des personnes habilitées] des salariés en activité
présentés par les organisations syndicales. Selon lui, il eut mieux valu suivre
« l’exemple des quelques départements dans lesquels ont été désignés, sans que
cela pose de problème particulier, une majorité de retraités, compétents et
disponibles[23]».
Le rapporteur, M. Thierry Mandon, reconnut que les syndicats étaient à même de
présenter des personnes, car les DDTE[24]
éprouvaient de grandes difficultés à élaborer les listes. Ce qui fait qu’en
2017, les candidats à la mission de conseillers du salarié sont présentés par
des organisations syndicales à près de 98%. Il y a dans quelques régions,
quelques conseillers qui se présentant de manière individuelle. En Région Auvergne-Rhône-Alpes, ils représentent 1,5%
des conseillers[25].
Constitution des listes
C’est le Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
qui prépare les listes, après consultation des organisations d'employeurs et de
salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale
de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le
délai d'un mois. Le Préfet signe ensuite la liste. La simple signature du
Préfet suffit à écarter encore plus la qualification d’IRP pour les
conseillers. Ce n’est pas le rôle du Préfet que de valider ou désigner la
représentation collective des salariés. Dès le début, le syndicat CGT tentera
d’empêcher que les services du travail demandent l’avis des employeurs lors de
l’élaboration de la liste des conseillers[26]. Il
n’existe pas la même réciprocité pour les assistants des employeurs lors d’une
rupture conventionnelle : un employeur peut se faire assister par un
membre de son syndicat, sans que les syndicats de salariés aient eu leur mot à
dire sur la personne, ce qui crée une rupture d’égalité entre employeurs et
salariés.
En 2017, les syndicats se contentent
d’envoyer les listes de candidats aux DIRECCTE, qui effectuent parfois un tri.
Il est certain que les organisations patronales ne participent pas, par
désintérêt, à l’élaboration de la liste. Si tant est qu’ils y aient participé
au moins une seule fois. L’article D1232-4 du Code du travail doit être adapté
à la réalité du terrain pratiquée depuis ses débuts il y a près de 30 ans, du
fait de sa désuétude.
En application de l'article L 1232-7 du Code du travail, les conseillers
prud'hommes en activité ne peuvent pas figurer sur les listes des conseillers
du salarié. Cependant, dès 1992, la CGT et FO ne trouvent justifiée cette
interdiction que dans l’hypothèse où le conseiller prud’hommes siège dans la
section où est jugée l’affaire dont il a eu à connaitre en qualité de
conseiller du salarié[27]. L’article 339 du Code de
procédure civile permet à tout juge de se déporter s’il suppose en sa personne
une cause de récusation. Même si certains le désirent, il n’est pas souhaitable
qu’une seule personne cumule un nombre considérable de fonctions au détriment
d’autres. Il faudrait quand même laisser l’opportunité de pouvoir effectuer une
transition en douceur entre deux fonctions[28].
La mission de conseiller du salarié voulu comme une tierce partie n’a
pu être effectuée que par les syndicats, écartés tant de la préparation de
cette loi, que de son contenu. C’est le fait qui crée le droit, et l’engagement
syndical a été le moteur de ce retournement de situation.
LA VALEUR
DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF
Les
organisations syndicales ont été capables de proposer, dès le départ, en
nombre, des conseillers du salarié, et ce, de manière durable. Quels sont les
éléments structurants qui ont motivé les syndicats à s’engager de façon
proactive ?
Une mission syndicale sans mandat
La
définition succincte du syndicalisme en France est donnée par la Constitution. L’article
6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que « Tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer
au syndicat de son choix ». Ce préambule est cité par celui de la
Constitution de 1958. Il fait partie du bloc de constitutionnalité. L’article
34 de la Constitution précise qu’il revient à la loi de déterminer les
principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical.
L’article L2131-1 du Code du travail définit précisément la mission des syndicats :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la
défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Cette
restriction d’action, dans le monde associatif, est propre aux syndicats.
Des valeurs internes….
Le syndicalisme est
né de la reconnaissance des intérêts antagonistes et des rapports asymétriques
entre salariés et employeurs. Les sentiments d’injustice, de déséquilibre, de
disharmonie ne sont pas étrangers à ce constat. Partant de ce bilan, le
syndicat a pour but de transformer les rapports sociaux, d’inverser le rapport
de force défavorable aux plus nombreux. Les syndicats agissent au nom de
l’intérêt général (les plus nombreux) et ont pour vocation de prendre en charge
le mouvement social[29]. Le syndicat est un outil
de régulation du travail collectif (faire du bon travail) et du collectif de
travail (agir sur les conduites au travail)[30]. Les syndicats exercent,
indépendamment de leur force, une fonction sociale fondamentale d’expression de
l’opinion. Le travail syndical des militants syndicaux s’articule autour d’un
projet commun. Le syndicalisme a opté pour la stratégie collective, en
dépassant l’individualisme, par le groupement des individus. L’engagement
gratuit, le don de temps, le dévouement altruiste, voire le sacrifice[31] en sont les liens, les
moyens d’action[32].
Les valeurs fondamentales du syndicalisme résultent de l’engagement collectif,
dans un but de rééquilibrage des rapports salariaux, suite au constat d’inégalité
entre salariés et employeurs. Tout groupement qui ne respecte pas ce triptyque
ne saurait être qualifié de syndicat. L’action syndicale se démarque de la vie
associative, car cette dernière est plus tournée vers l’intérêt individuel des
membres-consommateurs que vers la défense d’intérêts communs[33].
…Et des critères externes.
La représentativité
des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs
suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la
transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ
professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, une audience
établie selon les niveaux de négociation, l'influence, prioritairement caractérisée
par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations.
La mission de représentation et
d’assistance aux salariés est donc dévolue, selon la constitution et la loi,
aux syndicats, avec une mission bien cadrée. L’assistance des salariés lors
d’un entretien préalable au licenciement entre bien dans le champ d’action des
syndicats[34].
Il est donc permis
de s’interroger sur la présence de non syndiqués dans les listes de conseillers
du salarié. Une QPC[35] n’est pas à exclure[36]. Quelle peut être la
motivation de personnes qui refusent de partager les valeurs syndicales ?[37] Le bénéfice du statut de ‘salarié
protégé’ répond à cette interrogation[38] [39]. Il est possible aussi
que certains conseillers non syndiqués aient précédemment été exclus de leur
syndicat, non pour des raisons idéologiques, mais pour des motifs de droit
commun.
Quant à la présence
de conseillers du salarié issus de syndicats non représentatifs, on peut
s’apercevoir qu’elle prend sa source dans une stratégie d’entrisme[40], ou financière[41]. Tant d’ailleurs, pour
les non syndiqués que pour les micro-syndicats, se pose la question de
l’effectivité de la formation fournie au futur conseiller, du suivi, de la
formation continue. Ce qui peut expliquer le niveau parfois très bas de
connaissances d’un certain nombre de conseillers[42]. Enfin, les
micro-syndicats peuvent être un moyen d’approche pour des organisations
éloignées des valeurs syndicales[43].
La question de la légitimité de la
qualité de l’intervenant externe se pose[44]. Quel crédit accorder à
un conseiller du salarié dont le syndicat n’est présent que sporadiquement,
dans de rares établissements, dans une région donnée ? La présence d’un
syndicaliste sera d’autant plus légitime à se présenter dans une entreprise
dépourvue d’institution représentative du personnel que son syndicat est
présent nationalement depuis de nombreuses décennies dans beaucoup
d’entreprises de tous secteurs d’activité. Le syndicat n’a de légitimité que
s’il repose sur une implantation sur le lieu de travail[45]. Il n’en a plus lorsqu’il
ne repose que sur des statuts et non sur la masse de ses adhérents, et la
volonté de ses dirigeants de saisir l’opportunité de pouvoir faire bénéficier
ses rares militants du statut de ‘salarié protégé’.
La protection
Les conseillers du
salarié entrent dans la catégorie des ‘salariés protégés’, qui n’immunise en
rien du licenciement[46], ces derniers étant
autorisés à 75% par l’administration du travail. Cette protection est destinée
à empêcher l’arbitraire, les représailles, toutes choses issues des
antagonismes et intérêts divergents des protagonistes du monde du travail.
La Constitution indique que le fait de défendre ses droits et ses intérêts en
tant que salarié s’effectue par l'action syndicale. Assister et défendre les
droits et les intérêts d’un salarié lors d’un entretien préalable est donc une
action syndicale. Le Conseil constitutionnel valide d’ailleurs la mission de
conseiller du salarié comme étant dans
l'intérêt des travailleurs employés dans les entreprises dépourvues
d'institutions représentatives du personnel[47]. Le Conseil confirme par
ailleurs le lien entre la mission de conseiller du salarié et l’activité
syndicale, en validant le statut de salarié au licenciement soumis à
autorisation, en subordonnant le licenciement par l'employeur d'un conseiller
du salarié aux mêmes exigences que celles prévues pour le licenciement d'un
délégué syndical[48].
La mission de contrôle des salariés investis de fonctions d’assistance et de
représentation a pour but de s’assurer que le salarié, œuvrant pour l’intérêt
général, n’est pas victime de l’arbitraire, de représailles d’un patronat au
comportement peu citoyen.
Actuellement,
les conseillers du salarié sont des syndiqués à 98%. Ceci est normal car
défendre l’intérêt collectif des salariés est le cœur d’action des syndicats,
et la motivation est présente. Le conseiller du salarié doit recevoir du
législateur la reconnaissance de son appartenance au monde syndical, en
n’accordant la mission qu’à des conseillers porteurs des valeurs syndicales[49]. Les syndicats pouvant
présenter des conseillers en quantité, la carence n’est pas envisageable.
L’examen des
conditions de désignation des conseillers du salarié s’impose. Cela s’inscrit
dans un renouvellement des conditions d’exercice des missions des protagonistes
sociaux.
2)L’évolution des acteurs d’assistance
et de représentation.
Depuis près
de 15 ans, les institutions de représentation et d’assistance ont évolué.
Au sein de l’entreprise, la durée
des mandats de délégués du personnel et membre du comité d’entreprise sont
passés de 4 ans à une durée négociable, allant de 2 à 4 ans[50]. Le délégué syndical doit
désormais, pour être désigné, être présent sur les listes de candidats aux élections
professionnelles et obtenir au moins 10% des voix[51], et prouver, en cas de
contestation par l’employeur, qu’il existe au moins deux syndiqués dans
l’entreprise[52].
Les listes des candidats aux élections professionnelles devront respecter la
parité[53], avec la certitude que
toute non-application se traduirait par l’invalidation de l’élection de
certains candidats[54].
En dehors de l’entreprise, les
syndicats devront atteindre les 8% pour être représentatifs dans une branche[55]. La transparence
financière est un nouveau critère de représentativité. Il est vrai que
l’opacité a favorisé l’apparition de soupçons de corruption de certaines
structures syndicales par le patronat[56]. Les conseillers
prud’hommes seront désignés pour la prochaine mandature de 2018[57] et non plus élus. La
mission de défenseur ouvrier, ou défenseur syndical, apparue en 1958[58], obtient en 2016[59] un statut qui lui ouvre
le monopole partagé avec les avocats, de pouvoir défendre des salariés devant
la Cour d’appel. La Cour de cassation ne lui est plus accessible depuis 2005[60]. Le défenseur syndical
doit maintenant être assuré pour sa mission[61]. Celle-ci est reconnue
pour sa valeur[62]
mais tend à perdre de son importance[63]. Les avocats récupèrent
quasiment tous les autres dossiers avec assistance, dont ceux obtenus avec
l’aide juridictionnelle. Cette dernière n’est octroyée qu’aux dossiers défendus
par des avocats, excluant les défenseurs syndicaux. Moins de 1% des affaires
avec assistance sont défendues par le conjoint, un salarié de la même branche,
ou un représentant du personnel. Il est vraisemblable que ces derniers seront
exclus dans les années qui viennent de la défense des affaires en premier
ressort.
Le statut du conseiller du salarié
doit évoluer lui aussi, d’autant que la circulaire ministérielle DRT 91-16, qui encadre
l’activité des conseillers devrait, elle, être revue entièrement. Elle est
aujourd’hui totalement obsolète. La recodification de 2008 la rend peu
intelligible, les jurisprudences sont dépassées, elle renvoie à certaines circulaires[64] et lois abrogées depuis
des années[65]
et ignore les changements qu’ont pu apporter les nouvelles technologies. En
1991, il n’existait ni internet ni téléphone portable. Aujourd’hui, la lettre
de convocation à un entretien préalable au licenciement précise que la liste
des conseillers n’est disponible qu’en mairie ou auprès de l’Inspection du
travail[66]. Or les DIRECCTE publient
cette liste sur leur site internet. La lettre de convocation devrait
l’indiquer. Il ne reste plus qu’aux protagonistes sociaux de s’emparer du sujet
pour en débattre.
[1] Article R1232-1 du Code du travail.
[2] Les instances représentatives du personnel (IRP) sont
l'ensemble des fonctions de représentation du personnel définies dans le droit
français. En droit privé, elles sont de deux types : d’une part les
représentants indirects : délégués syndicaux (DS) , agissant au nom des
organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise qui les
ont désignés, d’autre part les représentants directs, élus directement par les
salariés : délégués du personnel (DP), membres élus au comité d’entreprise
et/ou d’établissement (CE).
[3] Article L1232-4 du Code du travail.
[4] Cass. Soc. 21 septembre 2005, 03-44810.
[5] Cass. Soc. 14 juin 2016, n° 15-12522.
[6] « La fonction d’assistant (appellation provisoire du conseiller du salarié pendant les travaux
parlementaires) n’ [est] en rien comparable à celle de représentant du
personnel, tant en ce qui concerne le mode de désignation que l’importance des
activités exercées » Rapport de la Commission des affaires sociales du
Sénat, n°481, 27 août 1990.
[7] Circulaire DRT 91-16, article 2.2.4
[8] CODAF : Comités opérationnels départementaux anti-fraude, https://www.economie.gouv.fr/dnlf/codaf-comites-operationnels-departementaux-anti-fraude
[9] Article L1233-10 du Code du travail.
[10] Réponse du Ministre du travail, J.O. 1990, page 1429.
[11] Sa légitimité est sui generis, mais reconnue et
validée par la DIRECCTE via l’article D1232-4 du Code du travail.
[12] « Si le conseil est un syndicaliste extérieur, le
responsable de l'union locale ou départementale d'un syndicat, il risque d’y
avoir un blocage. » M. Michel Coffineau, rapporteur de la loi n° 89-549 du 2
août 1989, relatif à la prévention du licenciement économique et au droit à la
conversion. JOAN, 25 mai 1989, page 1274.
[13] Le Ministre voulait des "médiateurs", des
"experts" ou des "conciliateurs", des personnes consensuelles,
avec une approche paritariste dans leur désignation. JOAN, 25 mai 1989, page
1275.
[14] Georges Mouly, sénateur radical « Faut-il
supprimer l'article 19 ? Je vous avoue mon embarras. S'il est bon, s'il est
heureux qu'un salarié puisse se faire assister, il serait préjudiciable que la
mesure proposée contribue - mais le fait-elle ? - à amoindrir un tant soit peu
la place et le rôle éminent et irremplaçable des syndicats. » JO 1989,
page 1474.
[15] M. Xavier de Villepin, sénateur centriste «Ce
dispositif est contesté à la fois par les responsables des P.M.E. et par les
organisations syndicales les plus représentatives. En fait, il apporte une
mauvaise réponse à une vraie question, celle de la représentation des salariés
dans les petites entreprises. » JO 1989, page 1509
[16] Louis Souvet, sénateur RPR « Cette construction
juridique est rejetée par les grandes centrales syndicales aux motifs qu'elle
affaiblirait leur rôle tout en plaçant les salariés dans une position
d'assistés. » JO 1989, page 1467.
[17] Jean-Pierre Fourcade, sénateur RPR, président de la
commission des affaires sociales « Votre démarche, monsieur le ministre,
comporte également quelques contradictions et la lecture des articles 18 bis et
19 montre que, d'une part, on élargit le rôle des syndicats et que, d'autre
part, on le limite. Ce va-et-vient inquiète tout autant les employeurs que les
organisations syndicales et, lors des auditions auxquelles la commission a
procédé, plusieurs organisations, qui, je le souligne, n'étaient pas que
patronales, s'en sont émues. » JO 1989, page 1477.
[18] Rapport n° 481 de la Commission des affaires sociales du Sénat du 26 septembre 1990, pages 23 et 24.
[19] «Après des appels (discrets) à candidatures, les directions départementales du travail durent constater que les « ex, comme on les appelait déjà, furent peu nombreux à se porter volontaires pour aller assister à cinquante kilomètres de leur domicile un salarié qu’ils n’avaient jamais vu, pour un entretien qui durait parfois moins de 5 minutes.» Jean Emmanuel Ray, Une fausse bonne idée : « le conseiller du salarié », revue Droit Social n°6 de juin 1991, page 477.
[20] « Les directions départementales ont généralement
purement et simplement sous-traité la constitution des listes aux organisations
syndicales de salariés » Idem, page 482.
[21] Idem, page 477.
[22] Exposé général du rapport de la Commission des
affaires sociales du Sénat, n°481, 27 août 1990.
[23] Sénat, Rapport n° 41 de la première session ordinaire
de 1990-1991.
[24] DDTE : Directions départementales du travail,
ancêtres des unités territoriales des DIRECCTE.
[25] Les conseillers du salarié en Rhône-Alpes en 2015, page 10, édité par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, mai 2016.
[26] Les
conseillers du salarié état des lieux en 2014, R. Poulain, Annexes,
page 160.
[27] Les
conseillers du salarié état des lieux en 2014, R. Poulain, Annexes,
page 165.
[28] Par exemple, un conseiller prud’homme dont le mandat
s’achève en janvier 2018, et qui n’a pas l’intention de renouveler son mandat,
pourrait être nommé conseiller du salarié en septembre 2017.
[29] François Sellier, 1961, stratégies de la lutte
sociale, France 1936-1960, éditions ouvrières.
[30] Yannick Le Quentrec –Stéphanie Benson, Un JOB pour la
vie, les salariés de JOB en lutte. 2005, Syllepse.
[31] Les représentants du personnel, Thomas Breda, Coll.
Sécuriser l'emploi, Les Presses de Sciences-Po, 2016.
[32] Francine Soubiran Paillet, 2005, Le syndicat saisi
par le droit ou l’émergence d’une catégorie juridique, dans
« Epistémologie du syndicalisme, construction disciplinaire de l’objet
syndical », L’harmattan.
[33] Jean-Pierre Loisel, 1999, les français et la vie
associative, collection des rapports, n°201, Credoc.
[34] C’est ce qu’a rappelé le rapport n°353 de la
commission des Affaires sociales du Sénat, 6 juin 1989 : « l'intrusion dans l'entreprise de
personnes extérieures à celle-ci, au mépris des prérogatives traditionnelles
des syndicats ».
[35] Question prioritaire de constitutionnalité
[36] La question de la constitutionalité de conseillers s’excluant de l’action syndicale est posée. Le Conseil n’a été saisi, sur ces intervenants extérieurs, que sur l’aspect du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989.
[37] Le compassionnel n’entre pas dans la mission du
conseiller du salarié, qui est de conseiller et défendre le salarié. Il ne peut
donc exister de confusion avec le syndicalisme. Le compassionnel, qui peut
parfois n’être qu’individuel, ne cherche pas les causes du problème, et ne
cherche pas la transformation de la société. Son champ d’action ne s’établit
pas dans une dynamique du temps, mais dans la statique de l’ici et maintenant.
[38] « Il ressort tout de même que le simple désir de
protection a été évoqué par de nombreux répondants, surtout des avocats, un
conseiller du salarié, un conseiller prud’homal, et dans le mémoire d’Alain
Leblay. » Les conseillers du
salarié état des lieux en 2014, R. Poulain, page 34.
[39] Au point qu’un conseiller issu du syndicat SAP est
présent à la fois dans deux départements : Hauts de Seine et Seine Saint
Denis. Une fois avec une étiquette syndicale, une fois sans…
[40] « Certains petits syndicats ont ainsi saisi l’opportunité qui s’offrait à eux pour à la fois se faire connaitre auprès de salariés faisant appel à eux, mais aussi pour nommer des militants dans le but non avoué de pouvoir monter une section syndicale dans leur entreprise d’origine, grâce à la protection ainsi obtenue. Cette pratique a été utilisée dans le département des Yvelines par un micro-syndicat (SAP) ayant réussi à nommer vingt cinq conseillers en 2011. L’unité territoriale des Yvelines n’a pas reconduit ces conseillers en 2014. Toutes les unités territoriales ou DIRECCTE n’ont pas ce regard, et il arrive que la nomination de conseillers inactifs en vue d’implantation ‘interne’ à l’entreprise du conseiller soit admise pour le prix d’une certaine « paix sociale ». La question de la nature de la fonction des conseillers du salarié renvoie en effet à celle de l’investissement, c’est-à-dire de l’usage pratique que les syndicats en font.» Les conseillers du salarié état des lieux en 2014, R. Poulain, page 28.
[41] La Cour de cassation a jugé que l’activité du
syndicat SAP consistait exclusivement à proposer des services rémunérés
d’assistance et de conseil juridique, ce qui n’est pas la définition du
syndicalisme. Cass. Soc. 15 nov. 2012, n° 12-27315.
[42] Les
conseillers du salarié état des lieux en 2014, R. Poulain, pages 32 et
51.
[43] Partis politiques (Cass. Civ, n° de pourvoi :
97-16970 97-17097 97-17272 97-17323, 10 avril 1998), sectes, courants
religieux…
[44] Le conseiller du salarié est en effet, avec
l’inspecteur ou le contrôleur du travail, le seul, issu du monde du travail, à
pouvoir s’introduire de façon légitime dans une propriété privée.
[45] La validation des acquis de l’expérience militante
dans le champ syndical : une reconnaissance du militantisme, page 17,
Yannick Le Quentrec, Institut Régional du Travail de Midi-Pyrénées, 2007.
[46] Plus des trois quarts des licenciements de salariés
protégés sont autorisés par l’inspection du travail. DARES Résultats, mars
2017. Selon cette étude, cette protection ne fonctionne pas dans 75% des cas.
Plutôt que de les désigner comme ‘salariés protégés’, les faits conduisent à
les désigner comme des ‘LSA’ : ‘salariés au Licenciement Soumis à Autorisation’.
[47] Considérant n°6 de la décision n° 90-284 DC du 16
janvier 1991.
[48] Considérant n°10 de la décision n° 90-284 DC du 16
janvier 1991.
[49] Ce que demandait la CFDT lors de son audition par la
commission des affaires sociales du Sénat. Rapport n°481, page 52, 26 septembre
1990.
[50] Loi n°2005-882 en faveur des PME du 2/08/2005.
[51] LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de
la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
[52] Article L2142-1 du Code du travail.
[53] LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l'emploi.
[54] Article L2314-25 du Code du travail.
[55] LOI n° 2008-789 du 20 août 2008, précitée.
[56] Denis Gautier-Sauvagnac a indiqué que les sommes en
liquides, dont il refuse d'indiquer les destinataires, « servaient à fluidifier
les relations sociales ».
[57] Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la
désignation des conseillers prud'hommes.
[58] Hélène MICHEL et Laurent WILLEMEZ, Université de
Poitiers, SACO, 2007, page 18.
[59] Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques du 6 août 2015.
[60] Décret n° 2004-836 du 20/8/2004.
[61] En application des articles 1991 & 1992 du Code
civil.
[62] « Ils continuent à constituer, tant pour les
justiciables que pour les juges, un recours apprécié et compétent ».
L'avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du XXIème
siècle, Alain Lacabarats, juillet 2014.
[63] En 2004, la part des défenseurs syndicaux était de
26% en premier ressort. Huit ans plus tard, elle ne représente plus que 16%. L’activité
des conseils de prud’hommes de 2004 À 2012 : Continuité et changements,
évolution 2004-2012 et situation en 2012, Maud GUILLONNEAU et Evelyne SERVERIN,
Septembre 2013, Ministère de la Justice.
[64] Dont les circulaires DE/DRT n° 89-46 et n° 12-89 des
1er et 04-10-1989 relatives au licenciement économique.
[65] Comme par exemple l'article 378 du Code Pénal qui a
été remplacé dans le nouveau Code par l’article 226-13.
[66] Article 1232-5 du Code du travail.
Un expert-comptable extérieur à l'entreprise ne peut procéder au licenciement d'un salarié de son client.
Un expert-comptable d'une entreprise,
ayant signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, ayant
mené l'entretien préalable de la salariée et ayant signé la lettre de
licenciement, tous ces documents étant signés « pour ordre » par ce
dernier, commet une erreur.
La finalité même de l'entretien préalable
et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à
l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise
(en l'occurrence, un expert-comptable externe) pour procéder à
l'entretien et notifier le licenciement, les documents comportant la
mention « po » (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la
personne ayant le pouvoir de signature, qu'ainsi, la lettre de
licenciement signée « pour ordre » au nom du gérant est valable, quand
bien même l'identité de la personne signataire ne serait pas connue.
La procédure de licenciement (entretien et signature de la lettre)
avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne
étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature
pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle
il était interdit à l'employeur de donner mandat.
N° de pourvoi: 15-25204
*
Réforme du code du travail : même Bruxelles estime que Macron n'en a pas besoin
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Union européenne ne plaide pas pour qu’Emmanuel Macron mène plus loin la réforme du code du travail. A Bruxelles, on est déjà très content de la loi Travail de Myriam El Khomri !
Cela va en surprendre plus d’un : la Commission européenne ne recommande pas une libéralisation du marché du travail par la refonte du code du même nom. On l’apprend en lisant les « recommandations pays » envoyées cette semaine aux 28 gouvernements de l’Union européenne.
Dans le chapitre consacré à la France, on trouve bien sûr l’obligation de ramener le déficit public sous les 3% du PIB ou la « consolidation des mesures de réduction du coût du travail » (en clair, la transformation du CICE en baisse définitive des cotisations sociales), ou encore la réduction de l’impôt sur les sociétés. Des antiennes aussi vielles que le pacte de stabilité européenne.
Mais lorsqu'on aborde le social, on ne lit que la nécessité d’« améliorer l’accès au marché du travail des demandeurs d’emploi (merci Bruxelles pour une idée aussi nouvelle…), notamment les travailleurs les moins qualifiés, les immigrés… ». Nulle mention d’une réforme du code du travail, pourtant la première à l’agenda d’Emmanuel Macron, qui a pris personnellement le dossier en main en recevant seul les dirigeants des centrales syndicales à l’Elysée.
Commentaire d’un haut-fonctionnaire de la commission : « La réforme portée par loi El Khomri est déjà un modèle pour l’Europe ». Donc pas besoin d’aller plus loin en détricotant davantage encore les relations sociales. Le silence de Bruxelles (qui ne s’oppose pas non plus aux projets présidentiels) sous-entend que cela n’apportera rien à la croissance de la France, ni à la compétitivité des entreprises tricolores.
Emmanuel Macron pourra certes arguer que les réformes, il faut les faire pour le pays, pas pour plaire à la commission européenne. Vrai, mais il lui reste à prouver qu’elles servent l’intérêt général...
Par Hervé Nathan, Publié le 23/05/2017 sur Marianne.net
*
La mission de soutien et d’accompagnement à la réforme de la justice prud’homale vient de rendre son rapport.
Après la mise en oeuvre de la
loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques consacrées à la justice prud’homale
ainsi que celles du décret d’application du 20 mai 2016 relatif
à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux,
une mission d'observation a été mise en place, qui vient
de rendre son rapport.
7/5/2017
*
Le nouveau COD-IT est
paru
*
Les licenciements et ruptures conventionnelles des contrats des salariés protégés, principaux indicateurs
La DARES vient de publier sa dernière édition de
son étude récurrente sur les ruptures de contrat des salariés
protégés.
Le nombre de demandes d’autorisation de licenciements et de ruptures conventionnelles
des contrats de salariés protégés dans le cadre de leurs
fonctions de représentation du personnel s’élève à
près de 20 000 en 2014. Au cours de la période 2010-2014, plus
des trois quarts des demandes de licenciement et près de 95 % des demandes
de rupture conventionnelle ont été autorisées par l’inspection
du travail. Pour un salarié protégé, le risque de rupture
de contrat de travail est plus élevé dans les établissements
de petite taille ; il est aussi plus élevé dans les domaines du
commerce et des services que dans l’industrie ou la construction. Ces chiffres
démontrent une stabilité des autorisations de licenciement depuis
des années.
23 mars 2017
*
ANNULATION DE LA DESIGNATION DES CONSEILLERS DU SALARIE DANS LES HAUTS DE SEINE
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une décision
d'annulation de la désignation des conseillers du salarié dans
les Hauts de Seine.
Le demandeur est le SAP, Syndicat Anti Précarité, basé
à Chatou. Il a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté
de désignation des conseillers du salarié du 8 septembre 2014
pris par le Préfet des Hauts de Seine. La liste retenue par le préfet
ne contenait aucun des candidats présentés par le syndicat SAP,
ce qui a entraîné l'ire du SAP. A noter que les candidats individuels
n'ont pas non plus été retenus.
Le syndicat basait sa motivation sur le fait que le DIRECCTE, qui a en charge
la préparation de la liste, n'avait pas appliqué l'article D1232-4
du Code du travail qui impose à l'autorité administrative de n'établir
la liste des conseillers qu'après avoir consulté les organisations
d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national
siégeant à la Commission nationale de la négociation collective.
Or le DIRECCTE n'avait pas organisé de réunion formelle ni informelle
pour établir les listes. La procédure était de ce fait
irrégulière. Le tribunal a donné raison au syndicat SAP
qui estimait que la décision administrative les privait de la garantie
de faire valoir leur défense, puisque la décision était
implicite, donc sans motivation.
Depuis la notification de cette décision, il n'y a donc plus, officiellement,
de conseillers du salarié dans les Hauts de Seine, sans que ceux-ci en
soient officiellement informés. Cela ouvre des perspectives de contentieux
inédits :
- Des salariés qui ne peuvent se faire assister, en violation de l'article
6.1 de la CEDH ;
- Des employeurs qui découvriront a posteriori que le conseiller du salarié
qui était présent lors de l'entretien n'avait pas le droit d'assister
à l'entretien.
- Que vaudra l'attestation en justice d'une personne ayant perdu, sans le savoir,
toute qualité pour assister à l'entretien ?
Un syndicat procédurier
Ce syndicat s'est fait connaître en 2012 pour sa velléité
à se présenter aux élections professionnelles des TPE.
Il s'était fait débouter, son activité étant, selon
le tribunal d'instance de Paris 15ème "exclusivement
tournée vers?le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action
en justice et s'apparente à l'exploitation rémunérée
d'un cabinet d'avocat".
Ce syndicat avait déjà présenté, en 2010, un
nombre considérable de conseillers dans les Yvelines, sans commune
mesure avec sa représentativité, avant que la DIRECCTE décide
de ne pas les renouveler fin 2013.
Comme le fait remarquer le SAP, le DIRECCTE s'appuie sur des syndicats
ayant 'une audience certaine'. Faut-il accorder le droit exorbitant de pouvoir
proposer des candidats à la mission de conseiller du salarié à
des syndicats à l'audience incertaine ?
Cette volonté du syndicat de pouvoir bénéficier de nombreux
conseillers du salarié s'inscrit-elle dans la démarche de s'appuyer
sur eux afin d'alimenter un service de défense syndicale, générateur
de revenus ?
Ce jugement pose toutefois la question de la pertinence du maintien du recours
à la consultation des organisations d'employeurs pour la désignation
de conseillers dont la mission est de conseiller et défendre uniquement
les salariés. Espérons que la nouvelle majorité qui émanera
des futurs scrutins répondra de façon appropriée.
*
L'ABSENCE D'ASSISTANCE DU SALARIÉ
LORS D'UN ENTRETIEN PRÉALABLE AU LICENCIEMENT CHEZ LE PARTICULIER EMPLOYEUR
Tout salarié en contrat de travail de droit privé peut voir celui-ci rompu par l’employeur. Cela se nomme rupture anticipée pour un contrat à durée déterminée et licenciement pour un contrat à durée indéterminée. Dans les deux cas, le salarié doit d’abord être convoqué à un entretien préalable. Lors de cet entretien, le salarié peut se faire accompagner, soit par un simple salarié de l’entreprise, soit par un représentant du personnel. En l’absence d’institutions représentatives du personnel, le salarié peut faire appel à un conseiller du salarié.
Les personnels travaillant pour le compte de particuliers échappent
à cette disposition, du fait de la dérogation au droit commun
caractérisant ce secteur d’activité. Plus particulièrement,
l’accès au domicile de l’employeur est proscrit au conseiller
du salarié. Il est permis de se demander si cette exception qui entame
sérieusement les droits des salariés est conforme au droit européen
et communautaire, alors que la Cour de cassation n’y trouve rien à
redire. Les entreprises, soumises à l’obligation de permettre
au salarié de se faire assister, ont trouvé toutes sortes de
solutions lorsque la tenue de l’entretien préalable ne peut se
dérouler sur le lieu de travail ou au siège de l’entreprise.
L’obligation d’assurer le droit fondamental de se faire assister,
issu du droit européen, oblige les particuliers employeurs à
examiner les solutions trouvées par les entreprises, sans disposer
des mêmes moyens financiers, juridiques et pratiques. Il ne reste plus
qu’aux protagonistes de la convention collective applicable qu’à
codifier les modalités de l’assistance. Ou de laisser ce soin
au législateur ou aux juges.
I. Le droit à l’assistance lors de l’entretien préalable
au licenciement
Depuis la loi de 1973 [1], lors d’un licenciement, le salarié
est auparavant convoqué à un entretien préalable [2].
Seuls les licenciements de dix salariés ou plus pour motif économique
sur une période de trente jours ne sont pas soumis à l’obligation
d’un entretien préalable [3]. Lorsqu’il y a des institutions
représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié
convoqué peut se faire accompagner lors de cet entretien par une personne
appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise. Cela peut être
un salarié sans mandat, ou un membre d’une institution représentative
du personnel [4]. En cas de carence [5] ou d’absence d’institutions
représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister
soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise,
soit par un conseiller du salarié dont le nom figure dans une liste
dressée par l’autorité administrative [6].
A) L’employeur personne physique
Un particulier qui emploie un salarié devient un employeur
même s’il n’a aucune activité commerciale ou associative
[7].
Si l’employeur personne physique est tenu de convoquer le salarié
à un entretien préalable lors d’un licenciement [8], il
ne lui est pas imposé de recevoir un conseiller extérieur [9].
En effet, l’article L7221-2 du Code du travail dispose que seules les
dispositions relatives au harcèlement, aux congés, au premier
mai, et aux visites médicales sont applicables aux employés
de maison.
La Cour de cassation a validé l’impossibilité de l’assistance
[10] au motif que cela n’est applicable uniquement qu’au personnel
des entreprises et ne s’applique donc pas au personnel employé
de maison [11] [12] [13] . Cette décision s’appuie implicitement
[14] sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen qui stipule que la propriété est un droit imprescriptible.
Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie dans son article premier
à la Déclaration de 1789. Cette dernière a donc valeur
constitutionnelle et est pleinement intégrée au bloc de constitutionnalité
[15]. En droit interne, la hiérarchie des normes fait prévaloir
les textes constitutionnels avant les lois. Le droit de propriété
(au sens large, car même un locataire peut être concerné)
prévaut donc sur le droit de se faire assister. C’est la notion
de l’inviolabilité du domicile, garanti également par l’article
66 de la Constitution [16].
De plus, la convention collective en vigueur [17] indique que ‘Le particulier
employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant
son domicile privé [18], les règles de procédure spécifiques
au licenciement économique et celles relatives à l’assistance
du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable
ne sont pas applicables’.
Droit européen
Tout salarié, quel que soit son sexe, convoqué à un entretien
préalable au licenciement, s’il perd ce droit de se faire assister,
se fait aussi dépouiller de l’équité à laquelle
il a droit en application de l’article 6.1 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme. La Cour européenne des droits de l’homme
considère que cet article s’applique également aux procédures
de licenciement [19] [20].
En ce qui concerne les employés de maison, en France,
la CESDH n’a eu à se prononcer que sur la notion de travail forcé
[21]. La question de l’assistance pourrait alors être soulevée
jusqu’à cette instance, pour un licenciement d’un employé
de maison.
Ou plutôt d’une employée, car le personnel visé est
très majoritairement féminin.
Discrimination indirecte
Selon la DARES [22], 97,4% des aides à domicile et aides ménagères
sont des femmes, et 86,8% des employés de maison [23]. L’observatoire
des inégalités trouvent des résultats similaires : 97,7
% des aides à domicile et aides ménagers et assistants maternels
[24] sont des femmes [25].
Ce sont donc des femmes à plus de 95 % qui sont touchées par des dispositions apparemment neutres écartant la possibilité d’une assistance lors d’un entretien préalable au licenciement.
Les dispositions de droit interne et communautaire prohibent la discrimination indirecte [26]. Les décisions de la Cour de cassation [27] et de la CJUE [28] permettent d’affirmer que cette lutte contre la discrimination n’est pas que théorique.
Les dispositions de l’assistance lors d’un licenciement
sont surtout prévues pour les entreprises qui doivent y faire face
quelles que soient la nature de leur locaux.
B) L’employeur personne morale
Le Code du travail a été élaboré pour améliorer et unifier les conditions de travail des salariés et de leurs patrons. La quasi-totalité de ces derniers ont le statut de personnes morales, dont les formes les plus répandues sont les entreprises et les associations. Depuis 1973, lors d’une procédure de licenciement engagée contre un salarié pour motif personnel, ce dernier peut se faire accompagner par un membre du personnel ou par un délégué [29]. En l’absence de représentation du personnel, le salarié peut se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise, ce dernier pouvant alors pénétrer dans les locaux.
Si le local qu’utilisent les entreprises relève de la propriété privée, un local à usage professionnel ne relève plus de la qualité de domicile. Il n’y a pas de violation de la vie privée, corollaire du domicile. Les entreprises, même en statut unipersonnel, sont tenues de laisser pénétrer le conseiller du salarié dans les locaux en l’absence d’institutions représentatives du personnel. Cela peut parfois poser quelques soucis à l’employeur lorsque le domicile privé est attenant ou intriqué au local professionnel. Le délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié est décrit par l’article L. 1238-1 du Code du travail qui fixe les pénalités. Il est surtout appliqué à l’encontre des employeurs qui empêchent le conseiller du salarié d’exercer sa mission, en refusant, par exemple, sa présence lors de l’entretien préalable alors qu’il aurait fait état de sa qualité.
Le principe est que l’entretien préalable doit se dérouler sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou au siège social de l’entreprise, sans que l’un de ces lieux prime sur l’autre [30]. Il est possible, si l’employeur justifie de circonstances rendant impossible l’organisation de l’entretien préalable au siège social de l’entreprise ou sur le lieu d’exécution du travail, qu’il se déroule dans un autre endroit [31]. L’employeur étant l’entité qui convoque, le salarié ne peut invoquer le manque de neutralité du lieu de convocation [32] . Le lieu de l’entretien préalable est en principe celui où s’exécute le travail ou celui du siège social de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’employeur doit justifier la pertinence du choix d’un autre lieu. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy admet que l’entretien préalable puisse avoir lieu dans le cabinet de l’administrateur judiciaire lors d’une procédure collective, car ce lieu est assimilé au siège de l’entreprise [33].
Le lieu de l’entretien doit permettre un échange
serein entre les parties, en préservant la discrétion et la
confidentialité des propos, sans circonstances vexatoires pour le salarié.
Les juges ont plusieurs fois sanctionné l’attitude d’employeurs
ayant effectué l’entretien préalable dans des endroits
dans lesquels des tiers (autres salariés, clients, public) pouvaient
tout entendre [34]. Lorsque l’employeur n’a pas de local propre
[35], il lui est loisible de convoquer le salarié dans un local temporaire
comme peuvent l’être les entreprises de domiciliation, les pépinières
d’entreprises ou les locations de bureaux [36] . La Cour d’appel
de Versailles a même admis que l’entretien pouvait avoir lieu dans
un café, du fait de l’indisponibilité des locaux et que
cela n’avait pas empêché le salarié de s’expliquer
[37].
Peut-on s’inspirer des pratiques des entreprises pour les appliquer aux
particuliers employeurs ?
II. Transposition des pratiques
Les entreprises ne sont pas concernées par la problématique
de l’inviolabilité du domicile privé. Pourtant, lorsque
le cas s’est présenté, elles ont pu trouver certaines solutions
de remplacement à leur impossibilité factuelle de pouvoir tenir
un entretien préalable au licenciement dans leurs locaux. Certaines
de ces solutions sont peut-être applicables aux particuliers employeurs,
tandis que l’innovation juridique doit apporter son lot de propositions.
A) Le choix du lieu de l’entretien
Si le particulier employeur regimbe à laisser entrer
un conseiller extérieur à son domicile, il lui est loisible
de pouvoir convoquer le salarié dans un lieu autre que son domicile
personnel, afin de respecter l’article 6.1 de la CESDH. Des entités
privées, associatives ou publiques peuvent apparaitre comme des solutions
possibles :
Il est envisageable de louer un espace clos auprès d’une entreprise
de domiciliation ou de locations de bureaux. Ce seront des frais uniquement
à la charge de l’employeur, et encore faut-il que ces locaux ne
soient pas trop éloignés du lieu de travail du salarié.
Les pépinières d’entreprises ne s’adressent
qu’à des entreprises, elles sont liées aux Chambres de
commerce et d’industrie. Quand elles proposent des locations de bureaux
à la journée, elles ne le font qu’aux entreprises qu’elles
hébergent.
Bien que le lieu de convocation puisse par nature ne pas être neutre,
l’entretien ne devrait pas avoir lieu dans un lieu tiers fortement marqué,
comme la délégation départementale du syndicat patronal
[38].
Les entités appartenant à la sphère publique garantissent
la neutralité ainsi qu’une présence bien répartie
localement, et une éventuelle gratuité de leurs locaux en cas
d’accord entre les protagonistes sociaux de la convention collective,
et, par exemple, la direction nationale d’organismes comme Pôle
Emploi ou la CAF. Mais pour le moment, ces deux organismes ne s’orientent
pas vers ce genre de diversification [39].
Les collectivités territoriales, en revanche, et notamment
les mairies, pourraient être mises à contribution. Les mises
à dispositions de salles à des organisations à but non
lucratif sont courantes. Dans les grandes agglomérations, des salles
pourraient être même spécialement dédiées,
voire même un ensemble de salles. Ce pourrait même être
un endroit qui, outre l’accueil des entretiens préalables au licenciement,
accueillerait du public en recherche d’emploi pour des offres de travail,
des formations, de l’orientation professionnelle. Particuliers comme
entreprises pourraient y déposer des offres d’emplois.
Ces endroits ont existé dès la fin du 19ème siècle,
il en existe encore un peu, et étaient dénommés ‘Bourses
du travail’, à l’image de la Bourse des valeurs. Elles sont
peu à peu tombées en désuétude. Elles hébergent
parfois des unions locales de syndicats, mais n’en perdent pas pour autant
leur neutralité du fait de leur rattachement statutaire à une
collectivité territoriale.
Enfin, la DIRECCTE dispose de locaux dans les départements, et pourraient les mettre à disposition pour des entretiens préalables. Le principe de neutralité est préservé, le travail et l’emploi sont au cœur de leur action, et les conseillers du salarié y sont administrativement rattachés [40] .
Dans le cas où le particulier employeur convoquera le
salarié à l’extérieur de son domicile, il conviendra
de déterminer les modalités de la tenue de l’entretien.
B) Les modalités de la convocation
Comme les autres types d’employeurs, le particulier doit,
avant de procéder à un licenciement, convoquer le salarié
à un entretien préalable [41].
La lettre de convocation doit parvenir au moins 5 jours ouvrables avant l’entretien.
Doivent impérativement figurer dans la lettre : la date et l’heure
de l’entretien, le lieu. Les temps partiels sont nombreux parmi les employés
de maison. Il serait déloyal de convoquer le salarié à
un moment ou il travaille ailleurs [42], alors que la jurisprudence accorde
à l’employeur le droit de convoquer le salarié en dehors
des heures de travail [43], en fin de journée [44], pendant un jour
de repos [45], pendant une période de congé [46].
Pour un particulier employeur, la convocation pourrait indiquer si l’employeur accepte la présence d’un conseiller du salarié lors de l’entretien. En cas de refus de l’employeur, deux solutions seraient possibles :
Soit de laisser le salarié choisir de se faire assister
ou non. En cas de refus d’assistance, l’entretien se déroulerait
au domicile de l’employeur.
Si le salarié souhaite bénéficier d’une assistance,
il en informerait l’employeur, qui prendrait alors ses dispositions en
réservant une salle parmi une des propositions présentées
plus haut. L’employeur peut aussi décider unilatéralement
de se passer du choix du salarié et de réserver une salle directement.
La tenue d’un entretien préalable avec la possibilité de l’assistance permet aux particuliers employeurs de sécuriser juridiquement la rupture de contrat de leur salarié. C’est une solution justifiée par le droit européen [47] et communautaire [48], et proportionnée, de par le respect de l’inviolabilité du domicile.
Il ne reste qu’aux organisations syndicales et à la FEPEM de s’emparer du sujet avant que la décision ne s’impose de manière prétorienne [49]. Il est sûr que certains particuliers employeurs ne s’embarrasseront pas d’attendre un accord de branche ou une loi dans le cas où ils ne voudraient pas recevoir un conseiller du salarié chez eux, ce qui est leur droit le plus strict, et choisiront d’eux même la délocalisation de l’entretien préalable au licenciement pour une tranquillité juridique assurée.
Plus globalement, les syndicats, dont la mission est l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts [50], seraient bien inspirés de confronter les situations de discrimination indirecte aux dispositions légales et conventionnelles.
Tout ceci est sans doute compliqué à mettre en œuvre, dans le but de ne pas recevoir une autre personne, en plus de son salarié, à son domicile. La simplicité étant d’accepter la présence pour un temps très limité d’une personne dépourvue de toute autorité.
R.P., 20 décembre 2016
[1] Loi n°73-680 du 13 juillet 1973 portant modification du Code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail a durée indéterminée.
[2] C’est le cas pour un licenciement pour motif personnel (article L1232-2 du Code du travail), pour un motif économique si cela ne concerne moins de 10 salariés dans une même période de trente jours (Article L1233-11 du Code du travail).
[3] Article L1233-38 du Code du travail.
[4] Délégués du personnel, membre du comité d’entreprise, membre du CHSCT.
[5] Article L2314-5 du Code du travail.
[6] Article L1232-4 du Code du travail.
[7] Pour les particuliers, la convention collective applicable se nomme « Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 », elle a été étendue par arrêté ministériel le 2 mars 2000.
[8] Article L1232-2 du Code du travail, réponse ministérielle du 26 janvier 2010 à une question de M. Claude Birraux, député, posée le 20 octobre 2009, Cass. Soc. n° 99-40254 du 29 janvier 2002, n° 02-41624 du 25 février 2004.
[9] Même si certains acceptent quand même la présence du conseiller (100 licenciements, de Didier Schneider, éditions Négatif, pages 211 et 291).
[10] Cass. soc. 4 juin 1998, n°95-44693, "Attendu, ensuite, que l’article L. 122-14 du Code du travail ne prévoit l’assistance du salarié par un conseiller de son choix qu’en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise ; qu’il en résulte que cette disposition, applicable uniquement au personnel des entreprises, ne s’applique pas au personnel employé de maison au sens de l’article L. 772-1 du Code du travail".
[11] Article L1232-7 du Code du travail (anciennement L122-14) « Le conseiller du salarié est chargé d’assister le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel. »
[12] Ce qui implique aussi, littéralement, que les salariés des associations ne puissent non plus se faire assister, car une association n’est pas une entreprise, pas plus qu’un syndicat ou un GIE.
[13] La transcription des débats parlementaires des séances des 16 mai 1990, 8 octobre 1990 et 28 novembre 1990 sur les conseillers du salarié n’ont pas fait état du domicile des particuliers.
[14] La Cour de cassation, dans l’arrêt n° 95-44693 précité, ne cite pas la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni la Constitution, ni un principe constitutionnel, ni le mot ‘propriété’.
[15] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
[16] Conseil constitutionnel, décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983
[17] Convention collective nationale des salaries du particulier employeur, signée le 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000.
[18] Au-delà du droit de propriété, le libellé ‘domicile privé’ renvoie aussi à l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » ainsi qu’à l’article 8 de la CESDH qui garantie le même principe.
[19] "La Cour a jugé l’article 6 § 1 applicable à des contestations portant sur des questions sociales, notamment à une procédure relative au licenciement d’un employé par une entreprise privée", Arrêt Buchholz c/ Allemagne, CESDH, 6 mai 1981, cité dans le Guide sur l’article 6 de la CESDH, édité par le Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2013.
[20] Il n’est pas exclu de penser que la CESDH étire aussi la possibilité de l’assistance aux salariés en CDD dont le contrat de travail est rompu avant la fin prévue, ce que le droit interne prohibe actuellement. Une rupture anticipée de contrat et un licenciement peuvent être tous deux qualifiés de ‘rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur’, et à ce titre, l’un des deux ne peut subir une différence de traitement que si cela est justifié et proportionné.
[21] www.dalloz-actualite.fr/printpdf/essentiel/servitude-et-travail-force-france-toujours-sur-sellette-europeenne.
[22] Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au Ministère du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
[23] http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xls/dares_analyses_082-_donnees_a_telecharger.xls
[24] Les assistants maternels, des femmes, pour environ 97%, dépendent actuellement essentiellement de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, et du Code de l’action sociale et des familles.
[25] http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1048
[26] Article L 1332-1 du Code du travail, article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[27] Cass. soc., 1 décembre 2009, n°07-42.801, Cass. soc., 3 juill. 2012, no 10-23.013
[28] Arrêt Bilka du 13 mai 1986 (affaire 170/84)
[29] Article R. 1232-1du Code du travail : La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
[30] Cass. soc. 3 octobre 1995, n°94-40995.
[31] Cass. Soc. 9 mai 2000, n° 97-45294 et Cass. Soc. 20 octobre 2009, n° 08-42155.
[32] Même pendant l’entretien préalable, le lien de subordination persiste.
[33] CA Nancy, 12 décembre 2005 n°03-2770
[34] CA Poitiers, 4 mars 2008, n°06-1087, CA Paris, 12 sept. 2007, no 06-1603, CA Toulouse, 1er octobre 1999, n°98-2306, CA Grenoble, 10 mars 2003 n°00-3162.
[35] L’uberisation du monde de l’entreprise va peut être faire décoller le nombre d’employeurs sans locaux, et employant des salariés en télétravail ou sur le terrain, en dehors de tout local professionnel.
[36] Les bureaux peuvent être loués à la journée, la demi-journée, ou à l’heure.
[37] CA Versailles, 11e ch., 17 oct. 1994
[38] En l’occurrence la FEPEM
[39] En revanche, La Poste utilise ses locaux pour organiser des sessions de permis de conduire : http://legroupe.laposte.fr/actualite/code-de-la-route-la-poste-accueille-les-candidats-a-l-examen
[40] Si la liste des conseillers est signée par le Préfet, la liste des conseillers a été préalablement dressée par la DIRECCTE, qui, une fois la décision entérinée, fait parvenir aux conseillers leur carte qui leur permettra de prouver leur qualité à l’employeur.
[41] Cass. Soc. n°99-40254
[42] Cass. soc., 9 avr. 1992
[43] Cour d’appel Orléans, 18 janv. 1990
[44] Cour d’appel Dijon, 24 sept. 1996
[45] Cour d’appel Dijon, 16 nov. 1999
[46] Cour d’appel, 22 sept. 1999
[47] La France est signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
[48] Le traité de Lisbonne a été ratifié par le Parlement le 8 février 2008.
[49] La CGT s’est d’ailleurs déjà prononcée pour l’assistance des employés de maison (Les conseillers du salarié, Etat des lieux en 2014, R. Poulain, page 19)
[50] Article L. 2131-1 du Code du travail
Auteur : R. P. Décembre 2016
*
Emmanuel Macron, pas encore candidat, prône un temps de travail selon l'âge
Emmanuel
Macron, dans une interview au Nouvel Observateur consacrée à ses propositions,
l'ex-ministre revient sur cet épineux dossier. Fidèle à la philosophie
libérale, selon laquelle la loi ne définit qu'un socle minimal, il avance : «
On peut imaginer que les branches professionnelles négocient une possibilité
pour les salariés qui le souhaiteraient de travailler moins à partir de 50 ou
55 ans : 30 heures, 32 heures, pourquoi pas ? En revanche, quand on est jeune,
35 heures, ce n'est pas long. » Suivant cette même logique, il souhaite
davantage de flexibilité concernant les retraites. « Certains veulent la
prendre à 60 ans, d'autres à 65, d'autres encore à 67. Il faut pouvoir moduler
selon les individus et les situations », explique-t-il, tout en rappelant sa
volonté de confier la gestion de l'Unédic à l'Etat ou de permettre aux salariés
démissionnaires de percevoir des allocations chômage.
Ne demandez pas à un magistrat à la Cour de cassation qu’il vous
décrypte la politique jurisprudentielle de sa chambre1. Il vous
rétorquera qu’il apporte simplement une solution aux questions qui lui
sont posées. Il précisera qu’il juge seulement le droit et rien que le
droit. Il ne rejuge pas l’affaire. Il n’est donc pas un troisième degré
de juridiction, même s’il intervient après le conseil des prud’hommes
et la cour d’appel. Les décisions sont collégiales, discutées en
audience. Les magistrats du Quai de l’Horloge à Paris ne chercheraient
donc pas à construire une jurisprudence en faveur des salariés ou des
employeurs. Et surtout pas se substituer au législateur.
1. Les lanceurs d'alerte
Cette réponse qui tient de la posture est un peu courte. Car des
orientations existent et elles sont souvent réfléchies. Prenons le
dernier arrêt emblématique de la chambre sociale. Le 30 juin, elle
décide d'annuler le licenciement d’un lanceur d’alerte sur le fondement
de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme sur la liberté d’expression. Elle aurait pu s’en tenir là,
garantir au salarié une belle indemnisation et une réintégration à sa
demande mais elle décide d’esquisser un régime juridique du lanceur
d’alerte (périmètre de l’alerte, procédure à suivre) dans l’attente des
réformes qui ne manqueront pas de s’appliquer.
Etait-elle tenue d’en faire autant ? C’est son côté « législateur
rentré » et la marque d’une volonté indéniable d’assurer une pleine
protection à ceux qui sont souvent présentés comme les héros des temps
modernes. « Une telle décision est de nature à protéger les lanceurs
d’alerte », assure-t-elle timidement dans sa « note explicative »,
terme préféré au traditionnel communiqué de presse qu’elle utilisait
pourtant auparavant. Quand la Cour de cassation fait sa pub, elle se
lance avec prudence. Contrairement à sa grande sœur, la Cour de justice
de l’Union européenne, basée à Luxembourg, elle ne maîtrise pas encore
pleinement les arcanes du service après-vente.
2. La responsabilité de la société mère
La chambre sociale sait donc être créative et bâtir des constructions
juridiques. Elle l’a déjà fait pour le co-emploi, une technique
permettant de mettre en jeu la responsabilité de la société mère et de
sanctionner les abus commis dans les rapports de domination économique
entre la mère et la filiale. C’est à l’occasion des plans de sauvegarde
de l’emploi et des fermetures de site que l’immixtion de la société
mère est prégnante et le co-emploi appelé à la rescousse.
Dans un premier temps, soit entre 2007 (arrêt Aspocomp du 19 juin 2007)
et 2014, la chambre sociale a eu tendance à reconnaître assez
facilement les situations de co-emploi, s’attirant un flot de critiques
du monde patronal. Avec de telles décisions, les investisseurs
étrangers allaient fuir la France. Certains professeurs de droit
travaillant pour des cabinets d’avocats employeurs ont multiplié des
articles dans les revues juridiques. Des lobbystes patronaux ont dit
tout le mal qu’ils pensaient de ce qui a été assimilé à une « verrue ».
Et la construction s’est effondrée.
Sensible à la polémique qui ne cessait d’enfler, la chambre sociale a opéré un revirement de jurisprudence sur le co-emploi
Sensible à la polémique qui ne cessait d’enfler, la chambre sociale a
opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt Molex du 2 juillet
2014. Le co-emploi y devient une situation pathogène, anormale qui
intervient en cas de confusion d’intérêts, d’activités et de direction
se manifestant « par une immixtion dans la gestion économique et
sociale » de la société dominée.
Bref, ce qui était possible devient exceptionnel. Le 6 juillet 2016,
les salariés de Continental en ont fait les frais. L’arrêt était très
attendu mais sans surprise, la Cour de cassation a refusé d’admettre la
responsabilité de la société mère allemande. Peu importe que « la
politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence
sur l’activité économique et sociale de sa filiale », peu importe que
la maison mère « se soit engagée à garantir l’exécution des obligations
de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des
emplois », cela ne peut suffire à caractériser une situation de
coemploi. Le choix jurisprudentiel est net : c’est un coup d’arrêt.
3. Le « préjudice nécessaire »
Même volonté pour ce qu’il est convenu d’appeler « le préjudice
nécessaire », c'est-à-dire un préjudice automatique qui se passait de
preuve. Les situations visées étaient multiples. Au moment du
licenciement, lorsque l’employeur délivrait avec retard le bulletin de
salaire, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi, le
salarié pouvait obtenir une indemnisation devant les conseils de
prud’hommes sans avoir à démontrer le dommage.
Le 13 avril 2016, dans une décision dont la motivation n’est pas des
plus explicites, la chambre sociale opère un revirement de
jurisprudence au nom d’un alignement sur les règles de droit commun.
Dès lors, le salarié va devoir prouver le préjudice, démontrer
qu’il a subi un dommage du fait d’un défaut de remise des documents
sociaux, ce qui ne sera pas simple. La solution est sévère : la
déclaration avec retard de ses revenus aux impôts ou à l’Urssaf
n’entraîne-t-elle pas mécaniquement des majorations ?
4. Les avantages catégoriels
L’image du mouvement de balancier incarne à merveille certains
cheminements de la chambre sociale. Les avantages catégoriels accordés
aux cadres dans les accords collectifs sont révélateurs de cette
évolution. Dans nombre d'accords négociés, ces derniers bénéficient en
effet souvent d'une durée du préavis, d'une indemnité de licenciement
ou d'un régime de prévoyance plus favorables que ceux d'un ouvrier.
Mais en 2009, dans un arrêt Pain, la Cour de cassation place le juge au
centre du débat. Il doit vérifier « la réalité et la pertinence » des
différences de traitement entre les cadres et les non-cadres résultant
d’un accord collectif. Pour être justifiée, la différence doit reposer
sur « des raisons objectives ».
La décision, qui remet en cause ces écarts, a suscité un tollé.
Pourquoi bouleverser une construction historique datant de
l’après-guerre qui a structuré le tissu conventionnel française dont un
des axes est la distinction cadres/non cadres ? Pourquoi donner autant
de pouvoir au juge, autorisé à annuler des accords favorisant les
cadres ? Pourquoi prendre le risque de fragiliser les accords
susceptibles à tout moment d’être attaqués ? Il est aussi permis de
s’interroger : en quoi le principe d’égalité ne s’appliquerait-il pas
aux accords ? En quoi les partenaires sociaux ne devraient-ils pas
rendre des comptes ? Le débat a fait rage et la chambre sociale s’est
divisée sur le sujet. D’un côté, les partisans de l’égalité ; de
l’autre, les tenants de la promotion de la négociation collective
portée il est vrai par la réforme du 20 août 2008 sur la
représentativité syndicale.
Prime à la négociation
Lorsqu’une chambre est divisée sur un sujet, elle a tendance à rendre
des arrêts de compromis qui, s’ils ont le mérite de contenter les deux
thèses en présence, sont souvent difficilement lisibles quant aux
orientations réellement prises. L’arrêt du 8 juin 2011 témoigne des
atermoiements des magistrats de la chambre sociale qui n’arrivent pas à
se mettre d’accord. Mais le doute sera vite levé. Après avoir choisi
l’égalité, la chambre consacre la négociation collective, dans une
décision du 27 janvier 2015. Les différences de traitement qui se
logent dans les accords sont présumées justifiées, à moins de démontrer
qu’elles sont étrangères à toute considération professionnelle.
En clair, les cadres ne peuvent pas avoir plus de jours de congé
offerts en cas de mariage ou de décès d’un proche que les non-cadres.
Pour le reste, les indemnités de licenciement, la durée du préavis, la
prévoyance… peuvent différer. Le vieux rêve égalitaire est mort. Le 8
juin 2016, la chambre sociale persiste et signe en admettant que les
partenaires sociaux puissent définir eux-mêmes les catégories
professionnelles et y instituer des différences. Le juge, qui sort du
jeu, devra fermer les yeux. L’intérêt général serait-il garanti par
l’intérêt collectif ? Pascal Lokiec, professeur à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, résume la tendance par cette formule : « qui
dit conventionnel dit juste », en réponse à l’adage forgé au 19ème
siècle par le philosophe Alfred Fouillée « qui dit contractuel dit
juste ». L’évolution est nette.
Reste qu’en sept ans, la chambre sociale est passée du tout égalité au
tout négociation, suivant un mouvement largement impulsé par le
législateur. Dans ce cadre, il n’est pas impossible qu’elle trouve son
équilibre dans quelques années en redonnant plus de pouvoir aux juges
dans le contrôle qu’ils opèrent des accords collectifs. En attendant,
cette séquence n’a pas été inutile pour la pédagogie de la négociation.
Le vent du boulet n’ayant pas soufflé loin, les partenaires sociaux ont
intégré l’idée de l’égalité, totalement absente des débats avant la
jurisprudence Pain.
5. Le harcèlement moral
Le mouvement de balancier est également perceptible en matière de santé
au travail régi par la fameuse obligation de sécurité de résultat2.
L’évolution est particulièrement intéressante s’agissant du harcèlement
moral. Le 3 février 2010, la Cour de cassation condamne un employeur
pour violation de l’obligation de sécurité de résultat pour des faits
de harcèlement moral subis par un de ses salariés. Or, il s’avère que
l’employeur prévenu de la situation avait pris des mesures pour faire
cesser ces agissements.
Mais la chambre sociale est inflexible. L’employeur doit être condamné
car le dommage (le harcèlement moral) a eu lieu. Il a failli à son
obligation de sécurité de résultat car il a échoué en termes de
prévention. Dans la logique de la chambre, les faits de harcèlement
démontrent que le climat de travail était malsain. Dès lors,
l’employeur ne peut être que responsable. Là encore, les critiques ont
fusé sur le mode « quoi que fasse l’employeur, il est condamné ». S’il
ne fait rien, il est condamné, s’il fait cesser les agissements de
harcèlement, il est condamné aussi. Ce n’est pas faux.
Un employeur doit avoir pris des mesures dès qu’il a été informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral
Là encore, la Cour de cassation a entendu les critiques et corrigé sa
jurisprudence. Le 1er juin 2016, elle décide qu’un employeur sera
exonéré de sa responsabilité à une double condition. Il doit avoir mis
en œuvre une politique de prévention de qualité ; il doit avoir pris
des mesures dès qu’il a été informé de faits susceptibles de constituer
un harcèlement moral. Par conséquent, un employeur diligent n’a rien à
craindre. Un retour à l’équilibre bienvenu.
La Cour de cassation sait corriger ses excès. Elle sait aussi se mettre au diapason de l’idéologie dominante.
*
A partir du premier août 2016, pour défendre leur dossier prud'homal
jusqu'en cour d'appel, les salariés pourront utiliser les services des
défenseurs syndicaux.
*
Un site
internet se propose de classer des avocats dans de multiples secteurs. L'un
de ces secteurs est celui des avocats qui conseillent (et défendent) les salariés
et les syndicats. Vous pouvez commenter cette liste sur le forum.
Seulement
24% de femmes conseillers du salarié : une mission misogyne ?
La Direccte
de Rhône Alpes vient de publier une étude sur les conseillers du salarié[1].
C’est une
étude quantitative auprès de 1100 conseillers réalisée dans le but d’obtenir une
vision d’ensemble de leurs caractéristiques, des conditions d’exercice de cette
mission, des difficultés ressenties et des demandes d’amélioration. Il ressort
de cette étude que les conseillers femmes ne sont que 24% à exercer cette
mission[2].
La
question qui se pose est : pour quelles raisons les femmes sont-elles si
peu nombreuses en tant que conseiller du salarié ?
La première
hypothèse serait de ne considérer ce pourcentage que comme une situation
purement locale, circonscrite aux 8 départements de la région, et qu’au niveau
national, la situation serait toute autre.
La deuxième serait que les désignations ne respecteraient pas la parité, et ce,
depuis longtemps.
La troisième est que les femmes renouvelleraient moins leur mission après la
première désignation.
La dernière hypothèse suggère que certaines difficultés rencontrées par les
femmes les écarteraient de leur mission.
Le grand nombre de répondants à cette étude écarte le biais que pourrait
induire une faible participation[3].
Les causes externes : La
géographie et le syndicalisme
La
désignation des conseillers est circonscrite géographiquement à chaque
département. Et dans chaque département, chaque syndicat présente sa liste de
conseillers. Le problème peut donc être lié à individuellement ou conjointement
à ces deux causes.
Le particularisme local
La surreprésentation des hommes parmi les conseillers attire l’attention de
l’auteur de l’étude. Elle ne correspond pas à la situation rencontrée dans le
monde du travail, d’où sont issus les conseillers à 72%, ou les retraités
(24%).
Cette situation est-elle propre à la région Rhône-Alpes, contrairement au
niveau national ?
La DGT[4]
apporte une réponse dans son bilan annuel sur les conseillers : « En
2011, le bilan d’activité fait ressortir la présence de 10 056 conseillers du
salariés désignés sur le territoire, dont 76 % d’hommes, 24 % de femmes[5] ».
Ce pourcentage national est strictement identique à celui de la région Rhône
Alpes.
Une autre étude de la Direccte Normandie dresse les nominations par genre
depuis 1996 : la proportion de femmes oscille entre 16 et 24 %[6].
D’autres départements
possèdent la même caractéristique :
-
23% de femmes dans le département du Nord[7],
-
33% dans le département des Pyrénées Orientales[8],
-
25% dans le département du Val de Marne[9].
La
première hypothèse de ne considérer le faible pourcentage féminin comme une
situation purement locale ne peut prospérer. La deuxième hypothèse serait que
les désignations ne respecteraient pas la parité, et ce, depuis longtemps.
De la
revendication de la parité par les syndicats à la mise en œuvre
La Direccte pense que la faible
représentation des femmes serait issue du faible pourcentage de syndiquées[10].
Or, le pourcentage de celles-ci est nettement supérieur au niveau national[11],
entre 40 et 50% en moyenne.
Lors de chaque
renouvellement des conseillers du salarié, les syndicats prétendent appliquer la parité :
« J’ai connu le mandat de conseiller du salarié l’année dernière par
l’intermédiaire du l’union départementale, qui m’a proposée de postuler, ce que
j’ai fait. Il fallait des femmes sur la liste, au nom de la parité[12]. »
« C’est un collègue qui m’a fait découvrir cette fonction de conseiller du
salarié et qui me l’a proposée. Il fallait une femme pour la parité.[13] »
« Nous avons 22 conseillers du salarié sur le département. Nous en avons
renouvelé la moitié, en nous focalisant sur la parité et les jeunes.[14] »
Cette parité tant vantée
en 2014 s’étend-elle à toutes les organisations syndicales de manière homogène
et dans tous les départements ? Si oui, depuis combien de temps ?
Une prise en
compte tardive de la désignation paritaire pourrait expliquer la différence,
liée à l’inertie de la durée des mandats et des conseillers renouvelant leur
mandat[15].
Cette hypothèse ne peut donc être écartée, seule une étude poussée pourrait
apporter une réponse à cette question.
Les causes internes : le
turn-over fatal et les épreuves inhérentes à la mission
Une fois
plongées dans leur mission, les femmes vont affronter deux caractéristiques de
la mission du conseiller du salarié : une forte élimination à la fin de la
première désignation[16],
et la confrontation à des difficultés récurrentes.
Une attrition issue du non-renouvellement ?
Selon
l’étude, « La
répartition des conseillers « actifs » selon leur ancienneté dans la mission
est assez équilibrée. 30% ont moins de trois ans d’ancienneté, ce qui dénote un
renouvellement notable de ces derniers et l’intérêt porté par les syndicats à
cette mission, 49% ont entre trois et dix ans d’ancienneté et 21% plus de dix
ans d’ancienneté.[17] »
Le fort pourcentage de renouvellement
suppose, au vu des autres chiffres, de considérer que bon nombre de premières
désignations ne sont pas suivies de renouvellement. La stabilité n’intervient
que pour ceux, peu nombreux, qui souhaitent poursuivre leur mission. Les femmes
sont-elles plus touchées par cette singularité ?
Cette forte élimination pose une première question : retrouve-t-on
ce même phénomène dans les mandats de représentation du
personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, …) et une seconde :
les difficultés de la mission ont-elles plus d’effets sur les femmes ?
Les écueils naturels de la mission de conseiller du
salarié
Plusieurs difficultés rencontrées par
les conseillers au cours de leur mission reviennent fréquemment dans leur
témoignage[18].
En premier lieu, la formation insuffisante, organisée par les
syndicats. Ces dernières sont jugées tout à fait suffisantes et adaptées par
60% d’entre eux, partiellement pour 36% et pas du tout par 4%. L’écart
d’appréciation entre femmes
et hommes est
ici notable puisque
63% des hommes contre 51% des femmes
sont tout à fait satisfaits
de ces formations,
sans que des
facteurs explicatifs aient
pu être établis. Une
hypothèse est que
les femmes étant
proportionnellement plus nombreuses
à avoir une faible
ancienneté dans la
mission (40% ont
moins de 3
ans d’ancienneté contre
26% des hommes), celles-ci ont peut-être davantage
d’attentes vis-à-vis des formations.[19] »
Pour les conseillers qui ne sont pas pleinement satisfaits par les
formations suivies (c'est-à-dire 40% des conseillers au total), c’est avant
tout le caractère partiel des formations qui est pointé (41% d’entre eux). Le
deuxième problème pointé est celui de la fréquence des formations (30% des
répondants), notamment au regard d’une législation qui évolue régulièrement.
Enfin, aux autres écueils moins souvent formulés ressortent de l’enquête : la
durée des formations, jugée trop courte par 16% des répondants et l’aspect trop
théorique des formations[20].
41% des
conseillers n’ont pas l’assurance d’avoir toutes les compétences nécessaires
pour remplir correctement leur mission. Le point de vue partiellement ou
totalement négatif sur les formations suivies et l’absence d’un mandat de représentant
du personnel ou de défenseur syndical sont parmi les facteurs explicatifs de
cette difficulté. En d’autres termes, le manque de formation ou le manque d’expérience syndicale
expliquent que cette difficulté soit pointée. A noter que, moins satisfaites
des formations suivies, les femmes sont plus nombreuses à faire part de ce type
de difficulté (56% contre 36% des hommes)[21].
Le manque de formation initiale avait déjà été relevé avant cette étude,
tant par des avocats travaillistes[22]
que par des conseillers eux-mêmes[23].
De plus, le problème du manque d’échanges avec les autres conseillers
concerne 30% d’entre eux. Un facteur d’explication est l’appréciation sur les
formations suivies. Plus cette appréciation est mauvaise, plus le manque de
partage d’expériences entre conseillers du salarié est pointé[24].
Aux désagréments déjà proposées lors du questionnaire, les conseillers
en ont ajouté :
La première d’entre elles est le manque de temps pour remplir la
mission (14% des conseillers)[25].
L’activité liée au mandat syndical excède le cadre de la mission légale
des conseillers, n’est pas indemnisée mais pèse fortement sur l’activité de
conseiller dans l’articulation avec sa vie professionnelle et personnelle[26]
[27].
Au temps passé à la mission légale (entretien et déplacement) vient s’additionner
l’étude et la préparation, le débriefing et la rédaction d’un compte rendu. Ces
dernières activités sont chronophages, mais indispensables à l’efficacité de la
mission.
Une autre difficulté est la dimension humaine pour 8% des conseillers.
Dans son aspect négatif, elle se retrouve tant dans l’attitude de l’employeur
(agressivité) que dans celle des salariés (le fait de mentir, le fait d’avoir
caché des informations au conseiller) ou dans la relation à gérer entre les
deux parties dans un contexte tendu ou conflictuel[28].
On peut se demander si l’aspect confrontation fait fuir les conseillers
du salarié femmes.
Il a été demandé aux conseillers de définir leur mission. Les termes qui reviennent le plus pour la
définir sont « utile », « indispensable », « nécessaire », « importante »[29].
La
mission sécurise le salarié en amont même de l’entretien dans le sens où elle
permet de le « rassurer », lui apporter un « soutien ». Elle sécurise également
la relation humaine avec l’employeur durant l’entretien dans le sens où elle
permet une « médiation », où elle « apaise » les tensions. On retrouve ici les
termes qui constituent la motivation des conseillers pour s’engager dans cette
mission : « aider », « défendre », « accompagner »… les salariés. Cependant, il
n’y a aucune précision sur le fait qu’il pourrait exister une différence de
motivations et d’attentes en fonction du genre des conseillers.
La
difficulté de la mission et ses limites en matière de résultats sont mises en
avant au regard d’un investissement personnel lourd car non indemnisé. Le
conseiller se voit comme ayant peu de pouvoir sur l’issue de l’entretien, tout
au plus comme un accompagnateur de la rupture de contrat, garant d’une
procédure respectée dans un climat apaisé. Le manque de connaissance de cette
mission par les salariés et les employeurs est également déploré par les
répondants, ainsi que le manque de reconnaissance de la part des salariés et de
la Direccte. La mission de conseiller s’effectue le plus souvent en solitaire,
en dehors de tout collectif apportant de la reconnaissance, du lien social, ou
même de l’information en retour. Ce résultat social peut être jugé décevant par
les conseillers femmes[30].
Le fait de préparer individuellement les entretiens préalables multiplie
par 2,3 la volonté de se faire appuyer par la Direccte, et par 1,7 celui de ne
pas avoir l’assurance d’avoir toutes les compétences nécessaires pour remplir
correctement cette mission[31].
Les femmes étant plus nombreuses que les hommes dans ce second cas, elles sont
36% à souhaiter plus d’appui contre 19% des hommes.
Les femmes douteraient-elles de leur capacité à effectuer cette
mission, en mesurant les carences de leurs connaissances en droit du travail ?
*
Si quelques pistes ont pu être rapidement écartées, quelques questions
restent en suspens. Ainsi, il reste à valider si la parité parfois revendiquée
lors des désignations est généralisée, et connaitre la part des femmes dans le
non renouvellement à la fin de leur première désignation.
La formation initiale, jugée trop courte et partielle, doit être
renforcée, pour permettre aux conseillers de se sentir plus à l’aise dans leur
mission.
Enfin, l’objectif d’obtenir une meilleure compatibilité entre la
mission de conseiller et une vie professionnelle et familiale, ne peut passer
que par un questionnement sur la reconnaissance du mandat syndical,
chronophage, mais non compris dans le temps nécessaire à l’exercice de la
mission[32].
[1] http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/etude_conseillers_du_salarie-2.pdf , auteur : Didier Graff, mai 2016
[2] Didier Graff, étude, page 10 « La
répartition des conseillers par sexe donne une large surreprésentation des
hommes (76% contre 24% de femmes). Si celle-ci ne reflète pas la réalité de
l’emploi salarié, on peut émettre l’hypothèse qu’elle se rapproche de la
représentation syndicale en entreprise »
[3] Méthodologie, Etude précitée, page 6.
[4] DGT : Direction Générale du Travail
[5] Cité dans Les conseillers du salarié,
état des lieux 2014, annexe, page 120.
[6] bulletin des conseillers du salarié de
Haute-Normandie, page 11 : http://normandie.direccte.gouv.fr/sites/normandie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/bulletin_regional_special_20_ans_juin_2011.pdf
[7] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, annexe, précité, page 120. « Pour 2013 nous avons 57 femmes et 188
hommes sur 245 conseillers »
[8] Idem, page 111. « Nombre de CS en 2013
: 78, 52 hommes, 26 femmes »
[9] Idem, page 118 « Homme : 82 – Femmes :
27. »
[10] Etude, page 10, « La répartition des
conseillers par sexe donne une large surreprésentation des hommes (76% contre
24% de femmes). Si celle-ci ne reflète pas la réalité de l’emploi salarié, on
peut émettre l’hypothèse qu’elle se rapproche de la représentation syndicale en
entreprise »
[11] « Les femmes, qui constituent près
de la moitié de la population active salariée, représentaient, en 2014, 36,8 %
des adhérents de la CGT, 47 % de ceux de la CFDT, 45 % de ceux de la CGT-FO, 42
% de ceux de la CFTC,
29,1 % de
ceux de la CFE-CGC et 52 % de ceux de l’UNSA. L’évolution est lente, mais elle
est en marche. Ainsi, en 2011, parmi les
nouveaux adhérents de la CGT, 43 % étaient des femmes». Claire Guichet, Les
forces vives au féminin, Conseil Economique et Social, octobre 2015.
[12] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, précité, annexe, page 69.
[13] Les conseillers du salarié, état des lieux 2014, précité, annexe, page 82.
[14] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, précité, annexe, page 132.
[15] Etude, page 10 « Une hypothèse est que
les femmes étant proportionnellement plus nombreuses à avoir une faible
ancienneté dans la mission (40% ont moins de 3 ans d’ancienneté contre 26% des
hommes)».
[16] On ignore le pourcentage exact de
primo-désignés qui ne renouvelleront pas leur mission, tous sexes confondus. Il
devrait approximativement avoisiner les 50%.
[17] Etude, page 15
[18] Etude, page 25 : « Trois types de difficultés ont été soumis via l’enquête aux conseillers du salarié pour en mesurer la fréquence : le manque de disponibilité pour répondre aux demandes, l’incertitude sur la possession des compétences nécessaires à cette mission et le manque de partage avec d’autres conseillers. »
[19] Etude, page 23
[20] Etude, page 24
[21] Etude, page 25
[22] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, précité, annexe pages 16, 23, 26, 28, 33, 40, 45 : « Leur niveau
des conseillers est médiocre, je me demande s’ils ont reçu une formation. ».
[23] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, précité, annexe, page 47, « Comme notre syndicat national ne nous
forme plus, je demande à la Direccte de réaliser des formations, gratuites, ou
avec des avocats. Notre syndicat nous offre juste une brochure. »
[24] Etude, page 25
[25] Etude, page 26
[26] Etude, page 26
[27] Les conseillers du salarié, état des
lieux 2014, précité, pages 26 à 39.
[28] Etude, page 26
[29] Etude, page 27
[30] Les conseillers du salarié, état des lieux 2014, précité, annexe page 93 : « Ce qui lui déplait, c’est que les salariés ne se rendent pas compte de l’investissement en temps et en énergie, d’avoir un compte rendu à rédiger. Elle attend au moins un remerciement, ce qui n’arrive pas à chaque fois. », Page 100 : « Quelques temps à la suite de l’entretien, certains salariés les remercient chaleureusement, alors que d’autres feignent de ne pas les reconnaitre. »
[31] Etude, page 28
[32] 15 heures par mois, en application de l’article L1232-8 du Code du travail.
Matthieu Longatte est un comédien engagé qui poste des vidéos sur Youtube. Dans sa dernière vidéo, Matthieu Longatte donne des conseils en droit du travail, et en particulier sur le licenciement. Un de ces conseils attire pourtant l’attention : celui d’enregistrer l’entretien préalable au licenciement.
« Faut penser à les enregistrer avec le téléphone »
Or il ne faut surtout pas enregistrer l’entretien préalable au licenciement hors la connaissance de l’employeur. L’enregistrement n’aura de valeur devant le conseil de prud’hommes que si l’employeur est d’accord pour être enregistré. Ce dernier refusera d’ailleurs catégoriquement d’être enregistré.
Plus grave, la personne qui se rend coupable de tels faits peut poursuivie au pénal :
« Article 226-1. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui :
« 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
« 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci,
l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au
su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
« Article 226-2. - Est puni des mêmes peines le fait de
conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un
tiers
ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou
document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. Lorsque
le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois
qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des
personnes responsables ».
Un entretien préalable n’est pas un fait de la vie privée,
mais de la vie professionnelle. Mais l’enregistrement sera quand même un délit.
L’enregistrement d’une personne à son insu n’est valable qu’en
cas de procédure pénale, ce qui n’est pas transposable à une affaire prud’homale.
L’idée de professer le droit pratique aux internautes est une bonne idée, d’autant que la vidéo est courte, sur un ton humoristique, avec du rythme. Mais il serait souhaitable que Matthieu Longatte modifie sa dernière vidéo pour ne pas induire les internautes en erreur.
Pour préparer l'entretien préalable au licenciement, et sécuriser sa vie professionnelle, nous vous conseillons "Salariés, comment déjouer les pièges du licenciement".*
TRIBUNE LIBRE
Jugement homophobe. Tout le monde tombe à bras raccourcis sur le Conseil de Prud’hommes de Paris ! Il n’est pas inintéressant d’essayer d’analyser comment un Conseil de Prud’hommes peut arriver à une telle motivation critiquée et critiquable.
Un jeune coiffeur
s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail en période d’essai.
Celle-ci est en effet libre et dénuée de formalisme (L.1231.1 du Code du
travail). D’aucuns en ont rêvé récemment, même au-delà de la période
d’essai !
Personne ne lui tombe dessus, lui ?
Militant
syndical, ancien conseiller prud’homme, Le plus
récent, à jour de la loi Macron, un Droit en poche, chez Lextenso/Gualino.

*
Les prud'hommes en bref
Chaque année, ce sont 3 millions de personnes qui s’inscrivent
à Pôle Emploi, suite à une rupture de contrat pour motif économique, personnel,
ou pour rupture conventionnelle.
Seulement 6 % de ces ruptures en moyenne font l’objet d’une
contestation en justice. 200 000 nouvelles affaires par an sont introduites devant
les conseils de prud’hommes.
Sur ces contestations devant les prud'hommes, moins de 2%
portent sur le licenciement économique
*
Joelle Courant, ancienne conseiller du salarié, témoigne de sa mission dans un récit de 16 pages.
*
TRIBUNE LIBRE
Loi travail El Khomri.
Barème des indemnités prud'homales : question de plafonds ou de plancher ?
par Patrick LE ROLLAND
C'est ainsi que, par analogie, on pourrait résumer le débat complètement
faussé et erroné sur le plancher et les plafonds de l'indemnisation devant les
Conseils de Prud'hommes des licenciements abusifs ou sans cause réelle et sérieuse.
Là où les organisations syndicales les plus radicales veulent le retrait pur
et simple du projet El Khomri et donc un maintien de la situation antérieure,
les organisations les plus « réformistes » crient à l'envie qu'elle
ne veulent pas que la loi fixe un barème. En alternative, que ce barème soit
sérieusement relevé.
La ministre souligne pourtant de son côté, et avec raison, que ce barème est
largement au niveau de ce que les Conseils de Prud'hommes accordent habituellement.
A se demander alors pourquoi légiférer ?
Pourquoi ? Pour supprimer le minimum d'indemnisation, pardi !
Explications « pour les nuls » en prud'homie :
Jusqu'à présent, le licenciement qui survient pour une cause qui n'est
pas réelle et sérieuse est sanctionné, selon l'article L.1235-3 du Code
du travail, par une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C'est un plancher. Mais il n'a jamais concerné tous les salariés.
L'article L.1235-5 du Code du travail prévoit en effet que ce plancher
de 6 mois ne s'applique pas :
- aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté,
- aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins
de 11 salariés.
Ces deux exclusions se lisent et se combinent : et/ou.
Pour s'y retrouver, les praticiens aux prud'hommes ont d'ailleurs
pris l'habitude de différencier les deux régimes légaux en parlant :
- « de dommages et intérêts
pour rupture abusive », quand il n'y a pas de minimum ou autrement dit
de plancher ;
- « d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse », quand les conditions d'application de
l'article L.1235-3 avec le minimum de 6 mois ne font pas l'objet
de l'une ou l'autre exclusion de l'article L.1235-5.
On a donc, de longue date, une « inégalité devant la loi » selon l'ancienneté
du salarié et selon la taille de son entreprise. Et on se souvient, autour de
la censure partielle et toute récente de la loi Macron, qu'autant le Conseil
Constitutionnel n'a rien trouvé à redire à une différenciation de l'indemnisation
selon l'ancienneté, autant il a retoqué toute différenciation reposant sur la
taille de l'entreprise.
Loi Macron décriée (avec raison) et censurée (les voies du Conseil Constitutionnel
sont parfois impénétrables mais mieux vaut tard que jamais) qui contenait toutefois
et paradoxalement ( ?) des dispositions somme toute plus favorables pour les
salariés que la version El Khomri.
Macron prévoyait en effet des plafonds plus hauts, variables selon à la fois
l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. Et surtout,
dès deux ans d'ancienneté du salarié, un plancher était maintenu. Certes
parfois pingre et inférieur aux 6 mois de l'article L.1235-3, avec un
seuil d'effectif relevé de moins de 11 à moins de 20 (2 mois) et de 20
à 299 (4 mois), avant d'arriver aux 6 mois antérieurs qui ne devait plus
concerner que les entreprises de 300 salariés et plus. L'objectif était
clairement déjà de ménager un plus grand nombre d'entreprises, pas toujours
si petites et moyennes que ça, en réduisant le risque financier d'un licenciement
litigieux. Mais, avec ces planchers, c'était déjà au moins ça de potentiellement
« gagné » pour les salariés concernés, quoique déjà bien moins nombreux que
ceux relevant du régime antérieur de 6 mois minimum.
Du passé faisons table rase, dans la loi « visant à instituer de nouvelles libertés
et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » (c'est
son nom), plus aucun minimum (plancher) pour personne !
Et le gouvernement se dit ouvert à discuter plafonds !
Comptes d'apothicaires
Car, dans la vraie vie, aucun Conseil de Prud'hommes n'a l'intention
d'accorder des indemnités pour licenciement abusif ou sans cause réelle
et sérieuse à hauteur des montants discutés. Jusqu'à 15 mois dans la version
actuelle de la loi. Macron allait jusqu'à 27 mois.
La belle affaire ! Car peu importe. Les salariés qui s'y sont frottés
savent bien que les indemnités fixées par les juges sont plus proches
de 6 mois (dans la fourchette de 6 à 8 ou 9 mois parfois quand les conditions
de licenciement sont jugées particulièrement sordides) et encore à condition
que les conditions de l'application du L.1235-3 soient remplies.
Pour les autres salariés, relevant du L.1235-5, la logique des conseillers prud'hommes
du collège employeur lors des délibérés est imparable : si ces salariés ne bénéficient
pas de par la loi (actuelle) de la garantie d'une indemnisation minimale
de 6 mois, c'est qu'ils n'ont par définition droit qu'à
moins, beaucoup moins le cas échéant.
Et il n'était donc pas rare que des salariés se retrouvent avec 2 ou 3
mois de dommages et intérêts seulement. 6 mois tout au plus si la loi ne permettait
pas aux juges de faire autrement, mais ces derniers avec leur extrême parcimonie
accordaient rarement davantage. Et ceci, quoiqu'on dise même avec une
ancienneté très importante parfois !
Demain, avec la loi El Khomri, ce sont tous les salariés qui ne pourront
compter que sur une indemnisation « au doigt mouillé ». A tel point que, souvent,
ils renonceront à engager une procédure prud'homale si c'est pour
avoir des frais d'avocat supérieurs à la réparation en monnaie sonnante
et trébuchante qu'ils peuvent espérer, en l'absence de tout plancher.
Dans une prochaine version de la loi les plafonds peuvent doubler. Ils peuvent
même être supprimés. Si un minimum (plancher) n'est pas remis en selle,
le recul considérable pour le salarié lambda sera consommé !
On comprend ainsi que le patronat ne soit pas hostile à une réévaluation
des plafonds dont il sait qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sa victoire, son intérêt ce sera la renonciation à tout plancher. Des années
qu'il en rêve !
Sur le fond, il s'agit quand même de prendre le risque ou de la quasi-certitude
de ne plus sanctionner réellement des licenciements abusifs, sans cause réelle
et sérieuse. Imaginons, l'automobiliste devant un feu rouge, devant un stop
: tant pis, il passe sans s'arrêter, sans même regarder ! Pourquoi pas complètement
ivre ? Et s'il y a des dégâts sociaux, il ne s'expose qu'à les réparer que par
des clopinettes (un euro symbolique ?) et, en tout état de cause, sous un plafond.
D'éminents juristes pour justifier ça ? Malgré les articles 1382 et 1383 du
Code civil ? C'est pourtant ce qui est en train de se tramer ici. Qu'au Conseil
Constitutionnel ne plaise de nouveau.
Mais cessons de regarder les plafonds. C'est au plancher que ça se passe
!
Patrick LE ROLLAND
*
Les congés payés sont dus même lors d'une faute lourde
Le Conseil Constitutionnel vient de décider que le non paiement des congés payés en acquisition lors d'un licenciement pour faute lourde n'était pas constitutionnel.
En effet, les salariés du secteur du bâtiment n'étaient pas touchés par cette mesure, du fait de leur rattachement à une caisse de congés.
Cette décision n'est active qu'à partir du 2 mars 2016.
*
Le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, entre initiative, adhésion et résignation
*
Interdiction du vapotage au travail
Il est désormais interdit de vapoter (utilisation de la cigarette électronique) au travail.
Cette interdiction est inscrite au Code de la santé publique : article
L3511-7-1. Il y aura peut-être une transcription dans le Code du
travail.
*
Le Conseil de prud'hommes de Paris, 2015 : les chiffres
Le nombre de saisines baisse depuis 2 ans. -10% en 2014, idem
en 2015. Malgré cela, les délais s'allongent, passant de 19 à
22 mois (26 mois à la section commerce).
La conciliation est toujours aussi peu prisée : seulement 4% des affaires.
57% des affaires ont droit à un jugement, tandis que 38% sont éteintes
par caducité ou désistement.
Le départage touche une affaire sur 4.
Une affaire sur 6 est un référ, jugée assez rapidement
: deux mois en moyenne.
Les infos sous forme de graphique.
Faut-il lister les griefs retenus contre le salarié dans la lettre de convocatoin à l'entretien préalable ?
Selon l'article L1232-2 du
Code du travail, seul l'objet de la convocation doit être indiqué sur la lettre
de convocation à l'entretien préalable.
Mais les conventions internationales, et notamment la 158 de
l'OIT, par son article 7, et la CESDH, par son article 6, imposent le droit au
procès équitable.
Un salarié qui ne sait pas à l'avance ce qui lui est
reproché ne peut se défendre efficacement.
C'est ainsi que dernièrement, deux tribunaux ont décidé de ne
pas considérer la procédure de licenciement comme valide lorsque les griefs
reprochés au salarié ne figurent pas sur la lettre de convocation. (COUR D'APPEL DE PARIS , 7 mai 2014, S12/02642, rectifié par arrêts du 10
septembre 2014 et du 15 octobre 2014 et Conseil de prud'hommes d'Evreux, RG
F13/00379 du 26 mai 2015).
Désormais, les conseillers du salariés seront bien inspirés de demander au salarié d'exiger la publication des griefs avant l'entretien.
*
Pratiques syndicales du droit - André Narritsens et Michel Pigenet
Explorant les pratiques syndicales du droit en France aux XXe et XXIe
siècles, ce livre s'intéresse à la manière dont les syndicalismes ont
pensé et organisé leurs interventions sur le terrain de la justice et du
droit, alors même que, producteurs de normes, ils contribuaient à les
diffuser et à en contrôler le respect.
De l'expérience fragile et contrastée acquise au début du XXe siècle aux
ruptures introduites par le développement simultané des syndicats et de
l'État social au cours des années 1930 à 1970, et avant la vague de
fond néo-libérale des décennies suivantes, les usages syndicaux du droit
n'ont cessé d'évoluer. Au fil des chapitres, sont mis en perspective
historique l'articulation des multiples sources des normes, l'inégale
maîtrise de leurs ressources, l'émergence de services juridiques
syndicaux, les liens noués avec les professionnels du droit, la
juridicisation de l'action syndicale et la judiciarisation des relations
professionnelles, la transcription législative d'accords collectifs...
Fruit de rencontres originales, cet ouvrage confronte les approches et
les analyses d'acteurs syndicaux et de chercheurs issus de plusieurs
disciplines et participe ainsi au renouvellement de la réflexion sur les
rapports entre le salariat, ses représentants et la République.
*
Les litiges individuels du travail de 2004 à 2013
*
Un guide pratique concentré, résumé,
optimisé, format réduit de cette célèbre collection « Droit en poche »
d'un éditeur de qualité : Gualino.
Surtout, l'un des tous premiers sur le marché de l'édition, à jour de
l'emblématique loi Macron du 6 août 2015 réformant entre autres la
procédure devant les Conseils de Prud'hommes.
-Bureau de conciliation devenu Bureau de conciliation et d'orientation ;
-bureau de jugement à l'occasion à composition restreinte (2 conseillers au lieu de 4) ;
-possibilité du renvoi direct d'une affaire devant le magistrat professionnel « lorsque la nature du litige le justifie » ;
-obligation nouvelle d'un exposé sommaire des prétentions dès la saisine ;
-défenseurs syndicaux agréés ;
-assistance obligatoire devant la Cour d'appel ;
-promesses légales (vaines selon l'auteur) d'accélération de la procédure...
Toutes les nouveautés sont présentées, analysées et parfois critiquées
au gré de la trame habituelle de la procédure. Un ouvrage au contenu
pragmatique et sans erreur comme nous y a habitué l'auteur avec ses
précédents guides pratiques « Gagner aux prud'hommes » ( édités d'abord
chez First puis chez Maxima) mais qui ne sont plus à jour.
Ce « Droit en poche », rédigé pour un public large (du salarié au chef
d'entreprise, responsable RH, syndicaliste, étudiant, journaliste')
arrive à point.
On lui reprochera seulement de ne pas trop différencier les points de
la réforme d'application immédiate de ceux qui nécessiteront encore que
les décrets soient sortis.
Mais c'était sans doute le prix à payer par l'éditeur et l'auteur pour
présenter un outil pratique à jour de la dernière vague de réformes.
Auteur : Patrick LE ROLLAND
Éditeur : Gualino
Collection : Droit en Poche
ISBN : 978-2-297-05394-5
EAN13 : 9782297053945
Date de parution : 11/2015
6,80 '
Quel bilan de l'usage de la rupture conventionnelle depuis sa création ?
le Centre d'Etudes pour l'Emploi vient de publier un court rapport sur lce mode de rupture.
Le bilan esquissé ici révèle un usage du dispositif pour motif économique avec un risque pour le salarié de ne pas bénéficier des dispositions d'indemnisation et de reclassement prévues dans le cadre du licenciement économique. Le succès de la rupture conventionnelle pourrait conduire à une participation accrue de l'assurance-chômage à la sécurisation des parcours professionnels.
*
CSP : accès à l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à partir d'1 an d'ancienneté
La convention du 26 janvier 2015 relative au CSP prévoit que les salariés ayant 1 à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise pourront bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP), sous conditions. Ces conditions doivent être définies dans une convention entre l'État et l'Unédic.
Dans l'attente de la signature de cette convention, l'État s'est engagé auprès de l'Unédic à financer le surcoût de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) par rapport à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Ainsi, les licenciés économiques à partir du 1er février 2015 ayant 1 à 2 ans d'ancienneté, qui adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), bénéficient de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à hauteur de 75% de leur salaire journalier de référence.
Par conséquent, l'employeur contribue au financement du dispositif en versant à Pôle emploi une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du CSP.
Si cette indemnité de préavis est supérieure à trois mois de salaire, la fraction qui excède ce montant est versée au salarié dès la rupture de son contrat de travail.
Source : Unedic
8/4/2015
*
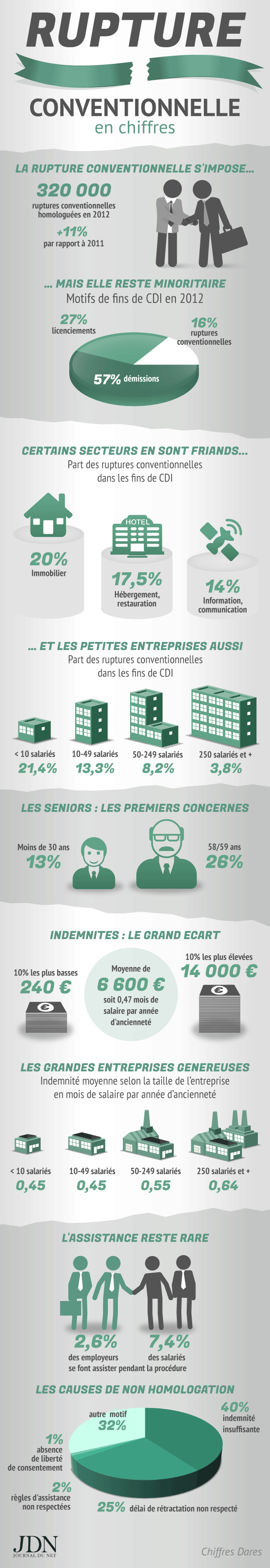
*
Un dessin du dessinateur ELIASCARPE colorisé par LAUREL pour LELICENCIEMENT.FR

Merci Eliascarpe, merci Laurel !
*
Quand l'irrespect d'une procédure de licenciement mérité permet à un salarié antisémite d'obtenir des dommages & intérêts
L'agence parisienne NSL Studio a annoncé lundi avoir engagé
une procédure de licenciement contre l'un de ses salariés, à
l'origine d'une offre d'emploi cherchant début février un graphiste
"si possible pas juif".
L'auteur de cette annonce, un salarié de la société
incriminée, va être licencié, a annoncé lundi l'agence
parisienne.
"Un salarié de l'entreprise, a reconnu être
l'auteur de cette mention et l'avoir transmise pour publication à un
site spécialisé d'offres d'emploi", a affirmé lundi
l'entreprise NSL Studio se disant "victime de la diffusion en son nom d'une
offre d'emploi à caractère antisémite". Condamnant
"un acte odieux", "une véritable trahison" lui portant
"un tort considérable" ainsi qu'à ses salariés,
NSL Studio a annoncé avoir "engagé une procédure de
licenciement envers son salarié avec une mise à pied à
titre conservatoire". (Source
: Le Parisien, 3 mars 2015).
Si cette entreprise a pris les bonnes décisions en mettant le salarié
à pied à titre conservatoire et en engageant une procédure
de licenciement, elle a commis une erreur monumentale en annonçant son
licenciement.
L'annonce du licenciement ne peut intervenir verbalement, à fortiori
avant la tenue de l'entretien préalable. Ce défaut de procédure
rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit
le motif retenu.
Le salarié ne pourra qu'obtenir satisfaction gagner, devant les prud'hommes
s'il y va, et obtenir des dommages & intérêts.
Le 3 mars 2015
*
Démissionner, la solution face au harcèlement ?
Poussés à bout, de plus en plus de salariés préfèrent partir d'eux-mêmes. Comment se défendre même si on démissionne et qu'est-ce que cette décision implique ? Nos experts vous guident dans cette douloureuse situation.
La déprime est parfois mauvaise conseillère. Vous vous sentez à bout et harcelé ? Peut-être faut-il d'abord s'assurer de quoi on parle. « Attention, il n'y a harcèlement que s'il y a faits répétés, insiste Didier Schneider, auteur du livre Salariés, comment déjouer les pièges du licenciement. Un mot de travers, sous le coup de l'énervement, de la fatigue ou de toute autre raison n'est pas en soi du harcèlement. » Christian Gury, auteur du livre Les 5 clés pour rebondir et piloter sa carrière recommande un état des lieux préalable avant d'agir. « Si vous êtes constamment dénigré par votre manager par exemple, il faut d'abord vérifier, auprès de vos collègues, que ce n'est pas qu'une impression. » Et sinon, mieux vaut prendre quelques mesures et vite'
Se protéger' tout de suite
Avant toute décision hâtive, Didier Schneider conseille d'aller parler au principal intéressé. « Face à un harceleur malgré lui, le simple fait de lui en parler, idéalement avec la présence d'un délégué du personnel ou à défaut autre témoin, peut s'avérer suffisant pour calmer le jeu. » Mais cet ancien représentant du personnel sait que c'est rarement aussi facile. « Après, si on tape "dans le dur" et qu'il s'agit d'un mode de management, de fonctionnement dans l'entreprise, ce sera plus difficile. Mieux vaut alors avoir de bons syndicats, de bons délégués, des instances comme le CHSCT qui agissent efficacement, un médecin du travail vigilant et actif. » « Si les symptômes persistent, il faut s'adresser à la direction générale par écrit », abonde Christian Gury. Avec un conseil : si le manager ne change pas, il peut être sain de négocier une mutation en interne par exemple.
Réunir des preuves en pensant à l'avenir
« Car quoi qu'il arrive, il faut se protéger, explique Loïc Scoarnec, président de l'association Harcèlement Moral Stop. Et quelle que soit la décision que l'on prend pour son avenir, il faut essayer de réunir un maximum de preuves. » Cet ancien cadre dans la banque sait de quoi il parle. « Un jour, j'ai été déménagé dans un bureau seul, au fond d'un couloir pour me pousser à bout. » Il raconte que ses collègues avaient interdiction de lui parler ou que son imprimante n'était jamais réparée par exemple. « Je ne pouvais plus travailler et on ne me donnait plus aucune mission pour me pousser à démissionner. Mais j'ai tenu bon et j'ai compilé des preuves pour mon futur dossier. » « Idéalement, même si on envisage de démissionner, il faut réunir des preuves de ce que l'on vit, ajoute l'avocat Éric Rocheblave, avocat en droit social au barreau de Montpellier. Si les témoignages de collègues sont délicats à obtenir, d'autres éléments peuvent être utiles, notamment des échanges de mails, des mémos. Ainsi, même si on part, on peut avoir un début de dossier' »
Démissionner pour se reconstruire
Loïc Scoarnec a tenu sept ans avant de négocier son départ dans de bonnes conditions. Mais il refuse d'ériger son cas en exemple. « J'étais syndicaliste ce qui m'a aidé à tenir. Il faut penser à son bien-être d'abord. Inutile de rester si c'est pour être broyé. Beaucoup préfèrent démissionner ou accepter des ruptures conventionnelles au rabais. » Les inconvénients de la démission sont en effet nombreux, notamment auprès de l'assurance chômage qui risque de ne pas considérer cette démission forcée comme une perte de travail involontaire' « C'est bien de se battre, mais on peut aussi choisir de tourner la page et saisir une opportunité ailleurs. Nous accompagnons ceux qui veulent lutter, mais tous n'en ont pas la force. » « Chacun voit midi à sa porte, confirme Didier Schneider. La démission peut être vue comme un échec, une reddition. Mais plutôt que d'y laisser sa santé, cela reste une solution. »
Faire condamner son harceleur après la démission
D'autant que sur le papier, rien n'empêche un salarié harcelé de se battre' après. « Toute démission peut faire l'objet d'une demande de requalification en prise d'acte de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, comme si c'est ce dernier qui avait licencié, avec toutes les conséquences juridiques qui vont avec », confirme Patrick Le Rolland, auteur du guide Gagner aux prud'hommes. Ancien conseiller aux prud'hommes de Paris, il explique que le dossier se plaide comme la contestation des motifs d'un licenciement. « L'une des demandes concernera la requalification de la démission donnée en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Suivront toutes les demandes indemnitaires relatives à cette situation. » Restera cependant à prouver devant la juridiction, y compris en Appel, voire jusqu'en Cour de cassation, qu'il s'agissait bien de harcèlement. « 80 % des dossiers n'aboutissement pas, déplore Éric de Rocheblave. Ce sont des affaires difficiles à prouver mais on y arrive quand même parfois. Même en ayant démissionné. »
*
Des questions sur le licenciement ? posez votre question sur le FORUM !
*
Au coeur des prud'hommes
de Véronique Brocard
Pendant deux ans, Véronique Brocard s'est installée dans
les salles d'audience de la justice du travail, les prud'hommes, et
a écouté les salariés qui se battent pour leurs droits,
voire leur dignité. Leurs histoires sont grinçantes, édifiantes,
parfois drôles, invraisemblables ou d'une grande cruauté,
jamais banales.
*
RUPTURE CONVENTIONNELLE
Changement dans le différé d'indemnisation lié à
l'indemnité de rupture :
Le salarié perçoit une indemnité de rupture lors de la
rupture conventionnelle. Cette indemnité de rupture peut être supérieure
à l'indemnité prévue par la loi, du fait de la convention
collective, ou de la négociation entre l'employeur et le salarié.
Dans ce cas, Pôle Emploi applique un différé d'indemnisation,
en plus de la carence de 7 jours :
- La différence entre l'indemnité de rupture perçue et
l'indemnité légale est l'indemnité supra-légale.
- Cette indemnité supra-légale est divisé par 90.
- Le chiffre ainsi obtenu correspond au nombre de jours de carence lié
à l'indemnité de rupture supra-légale.
Le différé d'indemnisation lié à l'indemnité
de rupture est plafonné à 180 jours à compter du 1er juillet
2014.
Le plafond de 75 jours reste applicable à compter du 1er juillet 2014
aux salariés victimes d'un licenciement économique, ou d'un licenciement
ou départ négocié dans le cadre d'un plan de départ
volontaire.
*
Chômage : 4 changements importants :
1 Des allocations revues à la baisse :
A partir de ce 1er juillet, les nouveaux inscrits à Pôle emploi qui gagnaient plus de 2054 euros brut par mois lorsqu'ils étaient en poste (salaires + primes), subissent une légère baisse du montant de leur allocation chômage. Pour ces demandeurs d'emploi, le taux de remplacement du salaire de référence (rémunérations brutes sur 12 mois/365 jours) passe de 57,4 % à 57 %.
Ainsi, l'Aide au retour à l'emploi (ARE) versée à un salarié rémunéré 2500 euros par mois s'élève désormais à 1405 euros pour 30 jours d'indemnisation contre 1415 euros auparavant. Pour les salariés qui touchaient moins de 2054 euros, pas de changement : le taux de remplacement reste à 57,4% du salaire de référence, tout comme pour ceux déjà indemnisés avant le 1er juillet, quel que soit leur ancien salaire.
2 Des différés d'indemnisation plus ou moins longs
Les salariés qui quittent leur entreprise avec un gros chèque vont devoir patienter plus longtemps avant de toucher une indemnisation de Pôle emploi. En effet, le différé d'indemnisation qui leur est imposé peut désormais aller jusqu'à 180 jours, contre 75 jours jusqu'alors.
Il est calculé de la manière suivante : il faut diviser le montant des indemnités de rupture, c'est-à-dire celles qui sont supérieures au minimum légal, par 90.
Par exemple, le différé d'indemnisation d'un employé licencié touchant 4000 euros d'indemnités de rupture sera de 44 jours, "soit presque une semaine de moins qu'avec la règle de calcul précédente" précise l'Unedic. A l'opposé, un cadre ayant signé une rupture conventionnelle avec, à la clé, une indemnité de rupture de 25.000 euros, se verra appliquer le différé d'indemnisation maximum de 180 jours avant de pouvoir toucher une quelconque indemnisation de la part de Pôle emploi. Une exception à cette nouvelle règle, toutefois : les licenciés économiques continuent à bénéficier de l'ancien plafond du différé, c'est à dire 75 jours maximum.
Ce nouveau mode de calcul se révèle donc défavorable pour les cadres qui reçoivent un chèque représentant plusieurs mois de salaire. En effet, dès 16.200 euros d'indemnités il faudra patienter le maximum de 6 mois avant de pouvoir toucher les allocations. En revanche, certains ex-salariés ayant de faibles revenus pourraient voir ce report réduit.
Attention ! Ce différé d'indemnisation se cumule avec le "délai d'attente" de 7 jours qui s'applique à tous les demandeurs d'emploi indemnisés ainsi qu'avec le différé lié aux jours de congés non pris par le salarié et qui reportent d'autant le début de l'indemnisation. Une seule catégorie de chômeurs échappe à l'ensemble de ces reports : les licenciés économiques qui acceptent un Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
3 Les droits rechargeables :
Le dispositif est tellement complexe à mettre en oeuvre qu'il a été reporté au 1er octobre 2014. Et pour l'expliquer au mieux, rien ne vaut un exemple. Prenons le cas d'un salarié licencié qui a le droit à un an d'allocations chômage. 6 mois après son inscription à Pôle emploi, il retrouve un CDD de 4 mois à salaire équivalent. Son contrat terminé, l'indemnisation reprend. Il possède donc d'un côté, 6 mois de reliquat de ses anciens droits, plus 4 mois de nouveaux droits. Avec le système actuel, Pôle emploi retient la plus favorable de ces périodes pour le demandeur d'emploi, c'est-à-dire 6 mois d'indemnisation (la plus élevée), et élimine l'autre (4 mois). A compter de cet automne, notre salarié licencié qui a retravaillé temporairement se retrouvera dans une tout autre situation : à la fin de son contrat, il touchera durant 6 mois le reliquat de ses premiers droits puis, s'il n'a toujours pas trouvé d'emploi, les 4 mois de nouveaux droits qu'il s'est constitué avec son CDD. Seule condition pour en bénéficier : avoir retravaillé au moins 150 heures, soit un mois plein, en une ou plusieurs fois.
Ce dispositif a pourtant un gros défaut : en versant le reliquat des droits plutôt que l'allocation la plus élevée (en montant et/ou en durée) les indemnités de 500.000 allocataires devraient baisser dès sa mise en oeuvre. 500.000 autres demandeurs d'emploi qui cumulent des contrats courts devraient, en revanche, voir leurs droits à l'indemnisation s'allonger en durée, ce qui représentera "potentiellement 7 mois de droits supplémentaires pour plus d'un tiers des CDD et 5 mois pour près de la moitié des intérimaires", avance l'Unédic.
4 L'activité réduite simplifiée
Autre mesure complétant les droits rechargeables et allant dans le sens du soutien aux travailleurs précaires qui alternent courtes périodes d'activité et chômage : la simplification de l'indemnisation de l'activité réduite qui permet de cumuler salaires et allocations. A partir du 1er octobre, tous les seuils existants seront supprimés : limite de 110 heures de travail par mois, salaire inférieur de 70% à la rémunération antérieure, impossibilité de cumul au-delà de 15 mois.
La règle sera simple : en cas de reprise d'une activité partielle (petit boulot, intérim), les allocations seront réduites de 70% du salaire touché. Seule condition à respecter : le cumul allocation/salaire ne doit pas dépasser le salaire perçu avant la perte d'emploi.
Exemple concret : un ex-salarié indemnisé à hauteur de
1250 euros mensuels travaille partiellement durant un mois et touche 500 euros.
Pôle emploi lui versera donc un peu moins de 900 euros d'allocations (70%
de 1250 euros). Au total, en cumulant revenu d'activité et allocations,
il percevra donc 1400 euros. L'Unédic précise toutefois que dans
certains cas, "les allocations versées en plus du salaire mensuel
seront d'un montant légèrement inférieur à ce qu'elles
étaient", mais qu'en contrepartie, elles seront versées sur
une plus longue durée.
*
10000 conseillers du salarié.
Près de 10000 ! 9835
en France métropolitaine, pour être précis.
C'est le nombre de conseillers du salarié en fonction au début
2013. Un vrai succès pour cette institution crée en 1991.
On trouvera ici
la présentation de cette fonction.
Le conseiller du salarié ne
peut assister les salariés en CDD dont le contrat est rompu de manière
anticipée, et c'est bien dommage.
Cette disposition tiendra t elle longtemps avant que la CEDH ne tranche en faveur
des salariés ?
Chaque DIRECCTE les désigne au niveau départemental pour une durée
de trois ans. Ils sont 15 dans le Cantal, et 483 sur Paris. La densité
des conseillers est très inégale : de 1 conseiller pour 1840 habitants
dans les Alpes de Haute Provence, à 1 pour 14951 habitants, dans le département
le plus mal loti : les Pyrénées orientales. Un rapport de 1 à
8. Au moment l'on parle d'attribuer les nombres de conseillers prud'hommes en
fonction du nombre de décisions rendues, appliquer un tel raisonnement
aux conseillers du salarié ne serait pas inutile. Car les salariés
se plaignent souvent d'avoir du mal à obtenir un conseiller disponible.
Alors que le
rapport LACABARATS préconise l'obligation de la formation initiale
des conseillers prud'homaux, il serait aussi bienvenu d'obliger les conseillers
du salarié nouvellement désignés à suivre une formation
initiale. Les réunions organisées par les DIRECCTE permettent
aux conseillers de poser des questions, parfois basiques, sur le droit du travail.
Pour ceux qui seraient intéressés de découvrir le monde
étonnant des entretiens préalables au licenciement, nous conseillerons
de lire '100 licenciements', récit de 100 entretiens préalables
au licenciement. Le livre est désormais
en accès libre sur le site de l'éditeur, sous forme numérique.
*
Prise d'acte de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d'acte les prud'hommes devront statuer sous un mois
Mercredi 18 juin, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi visant à accélérer la procédure prud'homale en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. La loi entrera en vigueur après examen d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel et publication au Journal officiel.
Jusque-là, un salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail ne pouvait, sauf dans quelques cas restreints, bénéficier des allocations chômage tant qu'une décision de justice n'avait pas fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui pouvait prendre plus d'un an.
Un nouvel article est créé dans le code du travail (c. trav. art. L. 1451-1 nouveau). Il prévoit que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes devra donc statuer sans conciliation préalable.
Dès lors que le conseil de prud'hommes fera produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pourra faire valoir ses droits aux allocations chômage.
Toutefois, si le conseil de prud'hommes ne précise pas que sa décision est exécutoire à titre provisoire, un appel aura pour effet de suspendre l'exécution de sa décision et de reporter d'autant le bénéfice des allocations chômage. À moins qu'un décret ne vienne préciser que, lorsqu'un conseil de prud'hommes statue sur ce type de demande, sa décision est exécutoire « de droit » à titre provisoire, ou que la réglementation de l'Unedic soit modifiée.
21 juillet 2014
*
Les prud'hommes, trop lents et mal formés?
Un rapport sur l'avenir des juridictions de travail a été remis le 17 juillet à Christiane Taubira, ministre de la Justice. Parmi les préconisations du texte figurent la simplification des procédures et une meilleure formation des conseillers.
Les prud'hommes ne fonctionnent pas. Procédure trop longue (12 mois contre 5 mois les tribunaux de commerce), taux d'appel de 60% contre 10 à 15% ailleurs, le rapport remis mercredi 16 juillet à Christiane Taubira dresse un portrait sombre de la juridiction. En 2013, la France a d'ailleurs été condamnée 51 fois pour déni de justice en matière prud'homale.
"Le constat est unanime: la juridiction du travail, dans son mode d'organisation
actuel, ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards
européens et connait de graves carences", annonce le groupe de travail
présidé par Alain Lacabarats en préambule. Pour tenter
de moderniser les instances et définir le "tribunal prud'homal du
XXIe siècle".
Préciser l'appartenance des prud'hommes
Première lacune pointée par le rapport : un problème d'identité. Pour ses auteurs, les prud'hommes doivent davantage se considérer comme un vrai tribunal. Car, rappelle le texte, "la juridiction prud'homales appartient à l'ordre judiciaire et est soumise en principe aux textes du code de préocédure civile". Il conviendrait donc "symboliquement, de modifier l'appellation du CPH, qui n'est pas un conseil mais une juridiction : le tribunal des prud'hommes, composé de juges prud'homaux", propose le rapport.
Pour aider les prud'hommes à mieux se définir, il faut également dissocier plus précisément les territoires du ministère de la Justice et celui du Travail. Charge à la Place Vendôme de s'occuper de l'organisation, du focntionnement et des procédures tandis que la rue de Grenelle veillera sur l'élection des juges/conseillers et les relations avec les partenaires sociaux.
En revanche, pas questionn de toucher au paritarisme, au coeur de l'organisation
des prud'hommes.
Mieux former les conseillers/juges
De ce rapprochement avec le ministère de la Justice, naît une autre préconisation : l'information des conseillers. Ces derniers pourraient ainsi avoir un recours sécurisé à l'intranet du ministère de la Justice, outil essentiel pour accéder à la jurisprudence de la Cour de cassation. Autre suggestion : des échanges réguliers entre les juges prud'homaux et les juges départiteurs des TGI ou de la cour d'appel.
En ce qui concerne la formation des conseillers/juges prud'homaux, le rapport
propose deux choses : une formation initiale obligatoire de 15 jours sous l'égide
de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et celle des Greffes (ENG) sur
la déontologie, la rédaction des jugements ou la technique de
conciliation. La formation continue, elle, d'une semaine par an, serait assurée
par les Cours d'appel. Cette formation accrue est aussi un moyen de ne pas suivre
l'idée d'une introduction de juges professionnels dans les prud'hommes.
Refaire le maillage territorial
La procédure pourrait elle aussi être revue. Le rapport propose de s'écarter un peu de la dimension orale en introduisant un calendrier de procédure pour mieux organiser l'échange des pièces écrites.
Enfin, une refonte du maillage territorial des conseils de prud'hommes est proposée. Car certaines juridictions sont saturées alors que d'autres sont insuffisamment occupées.
Que deviendront ces propositions ? Restant évasive, Christiane Taubira a indiqué que certaines des préconisations pourraient être mises en oeuvre rapidement. "Je pense que nous n'aurons pas de grosses réticences" concernant la formation, a-t-elle dit à titre d'exemple. Pour le reste, il faudra voir... D'autant que François Rebsamen, son homologue au Travail, réfléchit lui aussi à une réforme prud'homale, notamment sur la question de la nomination des conseillers.
*
Les prud'hommes, l'instrument d'un droit qui sur-règlemente le marché du travail et freine les embauches ?
Le Centre d'études
de l'emploi vient de publier un rapport sur
les prud'hommes qui bouscule les idées reçues.
Comment la France se situe-t-elle par rapport aux autres pays ?
« Des travaux ont par ailleurs démontré que la probabilité
d'un recours diffère considérablement selon le motif invoqué.
Par exemple, le ratio entre les requêtes liées à une rupture
de contrat par l'employeur et le nombre de personnes nouvellement inscrites
à Pôle emploi à la suite d'un licenciement se situait
dans une fourchette de 20 à 30 % entre 2004 et 2012. En ce qui concerne
les licenciements à caractère économique, ce pourcentage
n'a jamais dépassé 3 % pour la même période
».
« Ce ne sont pas les procès prud'homaux qui contribueraient à augmenter le chômage, mais la hausse de celui-ci qui provoquerait un recours plus élevé aux arbitrages judiciaires ».
Qu'est-ce qui favorise la baisse des recours prud'homaux ? : «
un taux de syndicalisation élevé, souvent associé à
une forte représentation salariale dans l'entreprise, diminue la
fréquence des recours prud'homaux».
13 juillet 2014
*
Nouveau différé d'indemnisation de l'ANI du 22 mars 2014 : La double peine pour le salarié victime d'un licenciement injustifié
Le SAF s'inquiète du contenu de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 22 mars 2014 relatif à l'indemnisation du chômage en ce qu'il porte des régressions pour les droits des salariés privés d'emploi. Le SAF s'alarme tout particulièrement de l'article 6 de cet accord relatif au différé d'indemnisation, qui, hors licenciements pour motif économique, porte le différé d'indemnisation de 75 jours à 180 jours, soit l'équivalent de six mois.
Présenté à tort comme une disposition concernant une minorité de cadres les mieux payés, ce nouveau délai a en réalité vocation à s'appliquer à tous les salariés, dès lors qu'ils perçoivent des indemnités de rupture au-delà du minimum légal, ce qui est très fréquemment le cas.
Or, Pôle Emploi fait notamment entrer dans le décompte des indemnités de rupture servant de base au calcul du différé, et ce de manière rétroactive, les dommages et intérêts obtenus par les salariés lorsqu'ils contestent leur licenciement devant la juridiction prud'homale. Ainsi, un salarié licencié qui aura gain de cause dans le cadre d'un procès prud'homal ou qui obtiendra une indemnisation transactionnelle pourra se voir réclamer jusqu'à six mois de remboursement d'allocations chômage, sachant que ce maximum de six mois sera atteint dès l'obtention de 16 200 ' de dommages et intérêts.
Ce nouveau différé d'indemnisation par Pôle Emploi aura pour effet de dissuader les salariés de faire usage de ce qui est un droit essentiel : saisir le Conseil de Prud'hommes lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement injustifié. Pourquoi en effet s'infliger une procédure longue et les frais d'une défense souvent nécessaire, dès lors que les sommes obtenues au final en réparation du préjudice du salarié seront en grande partie récupérées par Pôle Emploi ?
Il s'agit là d'un grave détournement de l'objet de ces sommes, qui est d'indemniser le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi. Ces sommes n'ont pas à être confondues avec un revenu de substitution.
Pour le SAF, ce différé d'indemnisation génère une double atteinte aux droits des salariés : au droit d'accès au juge d'une part, et au droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice d'autre part.
En outre, le Code du travail prévoit explicitement, en son article L. 1235-4, les conditions dans lesquelles Pôle Emploi peut être indemnisé à la suite d'un litige prud'homal, en demandant à l'employeur fautif, condamné ' et non au salarié ' de rembourser jusqu'à six mois d'indemnités de chômage. Le SAF déplore que Pôle Emploi n'utilise que très rarement cette faculté légale qui pourtant fait logiquement peser sur l'employeur la charge d'un licenciement abusif et représente une source de financement potentiellement importante pour le service public de l'emploi.
Le SAF alerte donc sur ces dispositions de l'ANI du 22 mars 2014 qui viennent faire peser sur le salarié le remboursement de ces six mois d'indemnité.
Rappelant que le droit à un recours effectif est une liberté fondamentale, le SAF en appelle aux partenaires sociaux et au Ministre du travail afin que soient exclues des assiettes de calcul des droits à l'allocation chômage toutes les sommes à caractère indemnitaire qui doivent rester acquises au salarié.
Le SAF rappelle enfin qu'il est primordial de distinguer l'indemnité servie par Pôle Emploi de l'indemnisation octroyée par un juge pour réparer un préjudice. Pôle Emploi ne saurait faire l'amalgame.
Paris, le 6 mai 2014
Communiqué
du SAF (Syndicats des avocats de France)
*
Un nouvel avocat pour les salariés
Maitre Catherine MEYER-ROYERE, Avocat au Barreau de TOULON (cour d'appel d'AIX EN PROVENCE) , vient rejoindre la liste des avocats spécialisés en droit du social.
Titulaire d'un doctorat en droit social, maître de conférences des universités, DU de contentieux administratif (très utile pour les contestations d'autorisation de licenciement de salariés protégés) , plus de 12 ans d'expérience, voilà qui assure au salarié une interlocutrice compétente.
*
Rupture conventionnelle :
Ne pas être informé de la possibilité d'être assisté
d'un conseiller du salarié n'annule pas la convention de rupture.
Le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence est la date de rupture voulue conventionnellement.
Impact d'une erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation
:
Si la Cour de cassation reconnnait l'erreur commise dans la convention de rupture
sur la date d'expiration du délai de 15 jours, elle estime toutefois
que cette erreur ne peut pas entraîner la nullité de la convention
sauf si "elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties
ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation".
"l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec
le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel
n'avait pas affecté la liberté de son consentement"
*
La rupture conventionnelle possible même en cas de conflit
Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ;
Arrêt numéro : 12-13.865
*
Le forum aux questions est rouvert !
Le forum et ses centaines de posts avait disparu, suite à une mauvaise manipulation du serveur.
Mais il renait de ses cendres, et vous pouvez poser à nouveau des questions. Patrick LE ROLLAND et Didier SCHNEIDER y répondront !
C'est gratuit !
*
La saisine du conseil de prud'hommes est de nouveau gratuite
Depuis le 1er octobre 2011, tout salarié qui engageait une procédure
devant la juridiction prud'homale devait s'acquitter d'un droit de timbre de
35 '. Les personnes bénéficiant éventuellement de
l'aide juridictionnelle en étaient toutefois dispensées. La loi
de finances pour 2014 abroge cette taxe.
La taxe reste applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2014.
*
"Droits des pauvres, pauvres droits"
Qui connaît la réalité de la justice sociale ? Le dernier livre de Pierre Joxe est une plongée dans un univers d'une rare complexité où se débattent les plus démunis. Edifiant.
Ministre de François Mitterrand, notamment à l'Intérieur et à la Défense, puis premier président de la Cour des Comptes, Pierre Joxe a siégé au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Il publie aujourd'hui "Soif de justice. Au secours des juridictions sociales" (Fayard).
Extraits de l'interview publiée dans "Le Nouvel Observateur" du jeudi 2 janvier 2014.
"Soif de justice", le livre que vous consacrez aujourd'hui aux juridictions sociales, se situe dans la lignée du précédent, consacré à la justice des mineurs. Même méthode d'enquête, même mise en perspective historique. Quel est le lien entre ces deux justices peu connues du grand public ?
- C'est dans les antichambres des tribunaux pour enfants que j'ai d'abord mesuré les graves problèmes de cette justice-là. On passe beaucoup de temps à attendre dans les couloirs des palais de justice. On y parle, on y discute. J'y ai rencontré des mères - elles sont toujours là ! - ayant des problèmes d'enfants, des enfants à problèmes - et tous les problèmes de la précarité, de la pauvreté et souvent de la misère. Ce sont elles qui m'ont montré, tirés d'enveloppes ou de sacs en plastique, des papiers auxquels elles ne comprenaient rien, portant sur des affaires d'allocation pour un enfant handicapé, de RSA, de licenciement abusif ou de surendettement... Des enjeux financiers parfois limités - apparemment -, mais énormes pour des mères qui n'ont ni connaissance ni assistance pour faire valoir leurs droits. (')
J'ai mesuré, à l'occasion de ces consultations improvisées, les conséquences terribles pour une mère célibataire victime d'un licenciement abusif des délais incroyables engendrés par la crise des prud'hommes. Faute de moyens ! Deux ans, trois ans d'attente, ce n'est pas rare à Bobigny si l'employeur condamné fait appel ! A tel point que, ces dernières années, l'État a été lui-même condamné plusieurs fois pour retard et déni de justice. (')
Il y a là, selon vous, un déni de justice ?
- A proprement parler oui, aux prud'hommes. Ailleurs, on en est souvent proche. Les magistrats qui traitent les très nombreuses affaires d'accidents du travail aux Tass sont le plus souvent compétents et dévoués. J'en ai vu, en cours d'audience, faire même un vrai boulot de travailleur social, alors que cela aurait dû être effectué en amont. Mais ils sont débordés. Dans les CDAS, c'est pire.
Pour y voir clair, j'ai enquêté à Paris, en province, puis en Suisse, en Belgique et outre-Rhin. Peu de gens savent que les magistrats sont deux fois plus nombreux en Allemagne qu'en France, surtout dans la justice sociale. (')
"Droits des pauvres, pauvres droits", dites-vous !
- La formule n'est pas de moi. "Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ?", tel est le titre d'un article mémorable du Pr Imbert dans l'austère "Revue de droit public" en... 1989, l'année du bicentenaire que l'on sait. Dans son ironie mélancolique, elle est terriblement juste. Hélas, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. En Suisse, les tribunaux du travail sont rapides. En Belgique, les droits des requérants sont défendus au besoin par un auditeur du travail : un parquet social ! En Allemagne, des syndicalistes siègent et jugent dans les cours d'appel sociales et même jusqu'en cassation ! Pascal écrivait : "Plaisante justice qu'une rivière borne."
Est-ce si difficile de mettre un peu d'ordre dans cette justice-là ?
- Non. Pas plus que chez nos voisins. Mais, comme en France peu de gens s'y intéressent, la volonté de réforme est faible. Mon livre est une tentative pour reprendre ce problème à la base. D'abord faire savoir ! (')
Mais alors comment réformer cette justice sociale ?
- La refondre au sein d'un nouvel ordre de juridiction, avec des moyens propres, un parquet social, une visibilité, comme l'avait proposé Laroque. Ce n'est pas une utopie. Cela existe déjà chez nos plus proches voisins. A deux heures de TGV de Paris, à Lausanne ou à Liège, vous trouvez des juridictions bien armées pour la justice sociale. Des affaires expédiées chez nous en dix minutes - ou retardées deux ans - sont soigneusement traitées là-bas en une heure. Les dossiers y sont vérifiés en amont. Les justiciables sont assistés. En Allemagne, ce sont deux ordres parallèles qui existent depuis plus d'un siècle : tribunaux du travail et tribunaux sociaux. Il y a soixante ans, Pierre Laroque proposait que la France choisisse entre ces deux systèmes. Aujourd'hui, le choix reste ouvert. (')
*
PROCEDURE DISCIPLINAIRE POUR LES CDD
Précision : La procédure disciplinaire pour les
CDD est différente en ce qui la convocation à l'entretien préalable.
La convocation peut être envoyée en lettre simple et pas obligatoirement
en recommandé.
( Arrêt
de cassation 12-30100 )
*
Affaire de la crêche BabyLoup
L'arrêt de renvoi est disponible.
*
Une étude de la DARES sur la rupture conventionnelle.
La DARES a enquêté auprès de 4500 salariés. Le résumé de l'étude est ici.
Elle dit à peu près les mêmes choses que l'étude publiée l'année dernière par le centre d'études de l'emploi et la CFDT, étude que notre site avait commenté en son temps. .
*
La période de mobilité volontaire sécurisée
La période de mobilité volontaire sécurisée permet au salarié de prendre un emploi dans une autre entreprise en ayant la garantie d'un droit de retour dans son entreprise d'origine au terme de la période de mobilité, s'il le souhaite.
L'avenant n° 5 du 29 mai 2013 (agréé par arrêté du 8 juillet 2013, J.O. du 3 août) modifie le règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Il définit les conditions et modalités selon lesquelles les salariés, bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail, peuvent être pris en charge par l'Assurance chômage en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période.
Ces mesures entrent en vigueur à compter du 4 août
2013 pour toute cessation de mobilité volontaire sécurisée
intervenant à partir de cette date.
Source
*
EMT : L'évaluation en milieu du travail
Du "travail gratuit" pour les syndicats, un "moyen d'évaluer
les compétences des chômeurs" pour Pôle emploi. Le service
public pour l'emploi ne l'a pas crié sur les toits mais ses agents proposent
depuis près de deux ans à ses "clients" (entreprises
et chômeurs) deux dispositifs innovants qui ont concerné plus de
110 000 personnes en 2009 : l'évaluation en milieu de travail préalable
au recrutement (EMTPR) et l'évaluation en milieu de travail (EMT). Et
qui font tiquer les syndicats.
Le premier est lié à une offre d'emploi déposée
par une entreprise et vise "à tester un candidat" en lui confiant
des tâches, en vue de son embauche, afin de vérifier ses compétences.
"L'employeur peut observer le demandeur d'emploi en situation réelle
de travail pour s'assurer qu'il correspond bien aux exigences du poste disponible",
assure-t-on chez Pôle emploi où l'on a recensé plus de 80
000 EMTPR en 2009. Le chômeur est suivi par un tuteur pendant toute l'évaluation
qui peut "aller jusqu'à 40 heures sur cinq jours". Il conserve
durant cette période son statut de demandeur d'emploi -sa couverture
sociale est prise en charge par Pôle emploi- et n'est ni rémunéré
ni dédommagé pour le travail effectué.
"Il continue de toucher ses allocations chômage s'il est indemnisé
et bénéficie d'aides de sa maison pour l'emploi s'il a moins de
26 ans", précise toutefois Sylvie Lievens, conseillère à
Lattes, dans la banlieue de Montpellier, qui juge le dispositif utile. Rien
que dans cette agence spécialisée dans l'hôtellerie et la
restauration, une trentaine de chômeurs ont bénéficié
d'une EMTPR l'année dernière avec un taux d'embauche de 50% à
la clé. "Je n'ai eu qu'un seul non-recrutement à l'issue
d'une évaluation dans mon propre portefeuille, ajoute Sylvie Lievens.
Elle émanait d'un demandeur d'emploi qui n'avait pas de véhicule
et ne pouvait pas se rendre sur le lieu de travail."
Des arguments qui laissent froids les syndicats qui assimilent l'EMTPR à
de l'exploitation. "Cela revient plus à offrir aux employeurs une
période d'essai gratuite, non décomptée en cas d'embauche,
que de mettre le pied à l'étrier aux chômeurs ", rétorque
Rubens Bardaji, de la CGT Pôle emploi, qui dénonce l'absence de
chiffres au niveau national pour juger de l'efficacité de la mesure.
"Les conventions signées avec l'entreprise sont bidons et n'engagent
à rien, complète-t-il. Ce n'est que du travail gratuit."
Le second dispositif, l'évaluation en milieu technique (EMT) qui a concerné
près de 30 000 chômeurs en 2009, part de la même philosophie.
Il permet "à un demandeur d'emploi de vérifier ses compétences
et capacités professionnelles pour un emploi dans les conditions réelles
d'exercice du métier", selon la brochure de Pôle emploi. Là
encore, le chômeur travaille gratuitement mais pour une durée maximum
de 80 heures.
Seule grosse différence avec l'EMTPR : l'entreprise qui accueille le
chômeur n'a pas l'intention de l'embaucher -elle est prestataire de services-
et peut être rémunérée jusqu'à 2 euros l'heure.
"Ce dispositif est utile lorsqu'un demandeur d'emploi veut se reconvertir",
justifie Sylvie Lievens qui l'a récemment utilisé pour une jeune
serveuse qui voulait devenir' fleuriste. "Nous faisons du cas par
cas, ajoute-t-elle. Nous démarchons une entreprise qui correspond vraiment
aux besoins du demandeur d'emploi et faisons un suivi après l'évaluation
qui peut conduire à des formations complémentaires."
*
ENTRÉE EN APPLICATION DE LA LOI DITE DE 'SÉCURISATION PROFESSIONNELLE'.
Temps partiel.
Heures complémentaires :
Lorsqu'une convention collective ou accord de branche le permet, il est possible
de conclure un avenant à un contrat de travail à temps partiel.
Cet avenant permet d'augmenter les heures de travail de façon temporaire.
Le nombre maximum d'avenant par an est de 8 par salarié.
Ces heures réalisées au-delà du temps partiel ne seront
pas automatiquement majorées. Elles pourront, selon les termes de l'accord,
être du même taux horaire que le taux du temps partiel.
Interruption d'activité :
L'interruption de travail ne peut être supérieure à deux
heures. (L3123-16), sauf convention ou accord collectif. Cet accord collectif
doit déterminer l'amplitude horaire et la répartition des heures
dans la journée.
L'indemnisation forfaitaire du salarié licencié en cas de contentieux
judiciaire.
En cas de contentieux judiciaire portant sur la contestation du licenciement,
les parties peuvent, lors de l'audience devant le Bureau de Conciliation, choisir
de mettre un terme définitif au litige qui les oppose en contrepartie
du versement, par le défendeur au demandeur, d'une indemnité forfaitaire
calculée en fonction de l'ancienneté de ce dernier, et ayant le
caractère social et fiscal de dommages et intérêts.?Cette
indemnité forfaitaire vaut réparation de l'ensemble des préjudices
liés à la rupture du contrat de travail, et son montant est fixé
à :?
- entre 0 et 2 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire
- entre 2 et 8 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire
- entre 8 et 15 ans d'ancienneté : 8 mois de salaire
- entre 15 et 25 ans d'ancienneté : 10 mois de salaire
- au-delà de 25 ans d'ancienneté : 14 mois de salaire
Mais ni l'employeur ni le salarié ne sont obligés d'accepter cette
indemnisation forfaitaire.
Attention : le nombre de mois de salaire d'indemnisation est fixé réglementairement,
et non légalement. Ils pourront donc être amenés à
évoluer, et pas forcément dans le sens des salariés.
La période de mobilité externe volontaire et sécurisée (le droit au retour dans son entreprise d'origine)
Objectif : permettre aux salariés de s'inscrire dans des trajectoires professionnelles continues sans craindre les ruptures inhérentes, aujourd'hui, aux changements d'entreprises.
Qui ?
Tout salarié d'une entreprise d'au moins 300 salariés justifiant
d'une ancienneté minimale de 24 mois consécutifs ou non.
Quoi ?
Il n'existe aujourd'hui aucun cadre juridique qui organise la possibilité
pour un salarié qui le souhaite de travailler dans une autre entreprise
tout en ayant un droit au retour dans son entreprise d'origine. La mobilité
volontaire fournit un cadre sécurisé, aussi bien pour l'entreprise
que pour le salarié. Elle va permettre au salarié, au-delà
de sa formation initiale et de la formation professionnelle continue, de développer
ses compétences par une expérience en situation de travail effectif
dans une autre entreprise au bénéfice de son entreprise d'accueil
comme de son entreprise d'origine. En favorisant la mobilité des salariés,
ce dispositif renforce leur employabilité, leur maintien dans l'emploi
et permet aux entreprises de bénéficier de personnels aux compétences
élargies et donc davantage aptes à répondre à la
variété de leurs besoins.
En outre, le salarié pourra choisir de revenir dans son entreprise d'origine,
comme de rester dans la nouvelle. En cas de retour, il retrouve son emploi antérieur
ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération
au moins équivalentes.
Comment ?
La période de mobilité volontaire sécurisée est
prévue par un avenant au contrat de travail ayant pour effet de le suspendre
durant la période en cause et prévoyant l'objet, la date de prise
d'effet, sa durée. Il prévoit en outre le délai dans lequel
le salarié est tenu d'informer son employeur de son intention de réintégrer
ou non son entreprise, ainsi que les conditions d'un éventuel retour
anticipé.
Si la période de mobilité est concluante et que le salarié
ne souhaite pas revenir dans son entreprise d'origine, la rupture du contrat
de travail constitue une démission.
Au cas où le salarié se verrait opposer par son employeur deux
refus successifs, il aurait droit à un accès privilégié
au congé individuel formation.
Les délais de prescription raccourcis
La loi de sécurisation de l'emploi réduit la durée de deux
délais de prescription, dans des domaines où les actions en justice
sont particulièrement nombreuses puisqu'ils recouvrent la contestation
des licenciements personnels et la réclamation des salaires impayés.
Deux ans pour contester l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail.
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail
se prescrit désormais par deux ans. Le délai de deux ans se décompte,
conformément au droit commun, à partir du jour où la personne
qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits qui
lui permettent d'exercer son droit.
Un délai réduit de 28 ans en l'espace de cinq ans
Avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai laissé au
salarié pour contester le respect de son contrat de travail par l'employeur
ou la régularité de la rupture de celui-ci est passé de
30 ans à cinq ans. Cinq ans après, le délai laissé
pour intenter ces actions est à nouveau réduit de trois ans dans
le cadre d'une disposition nouvelle du Code du travail (C. trav., art. L.1471-1).
Ce nouveau délai de prescription de deux ans trouve à s'appliquer
largement : il concerne toutes les actions intentées dans le cadre de
l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, sans distinction
notamment selon la nature du contrat de travail. Un délai écarté
en cas d'application de délais légaux particuliers. Le délai
de deux ans est expressément écarté par la loi dans le
cadre des actions :
-en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion
de l'exécution du contrat de travail ;
- en paiement ou en répétition du salaire (v. page 3) ;
-en réparation du préjudice causé par une discrimination
;
-en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement
moral;
-en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement
sexuel.
En outre, il ne s'applique qu'à défaut d'un délai spécifique
de prescription plus court et est notamment écarté en cas d'actions
:
- en contestation de la rupture du contrat de travail ou son motif après
une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle
;
- en contestation de la convention d'homologation ou du refus d'homologation
d'une rupture conventionnelle ;
- en contestation de la régularité ou de la validité des
licenciements pour motif économique ;
-en dénonciation de l'inventaire des sommes versées au salarié
inscrit sur le solde de tout compte.
Trois ans pour agir en paiement des salaires
L'article L.3245-1 du Code du travail prévoit désormais un délai
de prescription de trois ans pour agir en paiement ou en répétition
des salaires. Auparavant, cette action se prescrivait par cinq ans, en référence
à la prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions
en paiement. Ce délai devenu "traditionnel" en matière
salariale s'appliquait depuis la loi n°71-586 du 16 juillet 1971.
Conformément au droit commun, le délai de trois ans se décompte
à partir du jour où la personne qui exerce l'action a connu ou
aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
Le texte précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre
des trois dernières années à compter de ce même jour.
De plus, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur
les sommes dues au titre des trois années précédant la
rupture.
À noter
Les condamnations pour rappel de salaire correspondent souvent à des
sommes considérables, notamment quand elles sont prononcées à
l'encontre des employeurs en vue du paiement d'heures supplémentaires
impayées sur cinq ans. La réduction de ce délai "traditionnel"
permet ainsi de réduire considérablement l'importance du risque
judiciaire encouru par l'employeur.
Mon salaire peut-il baisser ?
Les accords de maintien dans l'emploi
Le principe : en contrepartie de l'engagement de ne pas licencier les salariés
concernés, une entreprise peut "ajuster" leur temps de travail
et/ou leurs rémunérations pour une durée de deux ans maximum
"en cas de graves difficultés conjoncturelles". Pour cela,
il lui faut signer avec les syndicats majoritaires, un accord prévoyant
notamment le partage du bénéfice économique permis par
les efforts consentis. Avec ces accords, le salarié sera "contraint
d'accepter une baisse de salaires si une majorité l'impose".
En cas de refus du salarié de se soumettre à l'accord, celui-ci
est licencié pour motif économique.
Le salarié est alors pris dans un étau : soit il accepte de voir
son salaire baisser, soit c'est la porte.
C'est quoi de " graves difficultés conjoncturelles " ?
' Ça, c'est l'employeur qui décide'.car il lui revient seul
d'établir le diagnostic. Il n'existe aucune borne, il n'est même
pas exigé dans la loi que l'entreprise perde de l'argent.
Les syndicats peuvent-ils vérifier le diagnostic ?
Oui, s'ils s'appuient sur l'aide fournie par l'expert-comptable du CE. Encore
faut-il que le CE accepte le principe de se faire aider dans sa mission.
Donc pendant deux ans, mon salaire peut être abaissé ?
Oui. Ou passage à temps partiel. 80%, 60, 50%....
Mais de combien ?
Cela peut aller loin, les limites sont basses : Le salaire horaire ne peut en
tout état de cause être en dessous du SMIC + 20 % (soit 1716,29
' mensuels), ni même en dessous des minimas de branche. Vérifiez
donc bien votre coefficient, et que ce dernier correspond bien à votre
fonction.
Non seulement le salaire baisse (si vous avez un crédit en cours, espérez
que cela ne vous arrive pas), mais aussi le salaire socialisé : cela
influera sur les indemnités journalières de sécurité
sociale, l'indemnité chômage, l'indemnité de licenciement,
calcul de retraite'
Et je ne serais pas licencié ?...
Pas pendant deux ans (maximum) pour motif économique. Mais après,
tout sera permis, et vos droits seront calculés sur le salaire des 12
derniers mois. Et à tout moment, vous pouvez être licencié
pour motif disciplinaire ou non atteinte d'objectif.
Et au bout de deux ans ?
Deux ans, ou un an, ou 6 mois, selon ce que prévoit l'accord, le salaire
ou le temps de travail reviennent comme avant.
Peut-on me muter à l'autre bout de la France même si je n'ai
pas de clause de mobilité ?
Les accords de mobilité
Si un accord d'entreprise est conclu entre l'employeur et les syndicats représentatifs,
alors cet accord primera sur une éventuelle clause de mobilité
insérée dans votre contrat de travail. Si vous n'en aviez pas,
vous pouvez donc vous retrouver avec une. L'employeur pourra vous dire "
bon voyage " quand bon lui semblera. Trêve de soupçons, vous
n'êtes pas enchaîné à votre lieu de travail'
Avec cet accord, le salarié sera "contraint d'accepter la mobilité".
En cas de refus du salarié de se soumettre à l'accord, celui-ci
est licencié pour motif économique.
Le salarié est alors pris dans un étau : soit il accepte de déménager,
soit c'est la porte.
Merci qui ?
On pourra donc m'envoyer à l'autre bout de la France ?
On le peut déjà actuellement, pour un déplacement de courte
durée (la journée ou la semaine). Là, il s'agit directement
du lieu de travail habituel. Cela impliquera donc un déménagement,
changement d'école pour les enfants, etc'
Mais cela peut s'étendre à toute la Franc voire l'Europe pour
certains profils.
Qui paiera le déménagement ?
Le salarié pourra bénéficier de 'mesures d'accompagnement'.
C'est-à-dire ?
Tout dépendra de ce que l'accord contiendra. Si l'accord signé
par les délégués syndicaux majoritaires contient peu, les
mesures d'accompagnement seront maigres. Vous en serez donc pour vos frais.
J'ai des activités extraprofessionnelles qui comptent beaucoup pour moi
/ j'aurais des frais de garde d'enfants / je suis propriétaire / autre
bonne raison selon moi.
Puis-je espérer passer entre les gouttes si j'ai de 'bons' arguments
?
Votre défense se basera sur le droit de chaque salarié à
avoir une vie familiale normale. Au mieux, cela vous apportera une indemnité
après un prud'homme, mais empêcher le licenciement apparait impossible.
Tous ces changements, néfastes pour les salariés, proviennent
de l'entrée en application de la loi dite de " sécurisation
de l'emploi ", issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier
dernier, signé par le patronat (à l'unanimité) et 3 syndicats
non majoritaires au niveau national (CFDT, CFTC, CGC). Appréciez la sécurisation
que vous procurent de tels accords.
Cette loi prévoit ces changements qu'en cas d'accord au niveau de l'entreprise.
Ce sont les délégués syndicaux 'représentatifs'
qui signent (ou pas) les accords d'entreprise.
Ce sont les résultats des élections au comité d'entreprise
qui déterminent la représentativité des syndicats.
Autant dire qu'aux prochaines élections du comité d'entreprise,
vous élirez des gens qui décideront le cas échéant
du maintien de votre salaire, ou votre lieu de travail. Ou pas.
Gardez donc cette fiche. Vous la présenterez aux candidats au prochain
CE : s'engageront-ils à refuser de signer un tel accord ?
Présentation de la loi sur la sécurisation de l'emploi
*
Retour à la Justice gratuite
Christiane Taubira annonce la suppression de la taxe de 35 ' pour saisir
la Justice.
A l'occasion de sa visite au bureau d'aide juridictionnelle de Paris,
la garde des Sceaux a annoncé la suppression de la taxe de 35 '
imposée aux justiciables depuis la loi de finances rectificative de 2011.
Les crédits budgétaires affectés à l'aide juridictionnelle
seront augmentés de 60 millions d'euros pour compenser la disparition
de ce mode de financement.
« En supprimant ce timbre de 35 ', nous supprimons
l'accès payant au juge. » Pour Christiane Taubira, garantir
à tous la possibilité de faire respecter ses droits, quels que
soient ses revenus, son niveau d'instruction ou sa connaissance du système
judiciaire, est un devoir du service public de la justice. C'est aussi
une question de justice sociale.
L'instauration par le précédent gouvernement d'une taxe
de 35 ' exigible pour saisir la justice, a en effet eu pour conséquence
de pénaliser les justiciables les plus vulnérables. « On
a une baisse du recours à la Justice chez ces justiciables, parce que
le timbre de 35 ' fonctionne comme une entrave à l'accès
au juge. Il était temps d'y mettre un terme. »
Le timbre ayant été créé pour participer au financement de l'aide juridictionnelle, plusieurs options ont été envisagées pour compenser sa disparition. Pour que la suppression de la taxe soit effective dès 2014, avec l'accord du Premier ministre, des réformes structurelles et aménagements au sein du budget de la Justice seront effectués cette année pour compenser le manque à gagner de 60 millions d'euros. La garde des Sceaux s'engage à « trouver une solution équitable, qui apporte une réponse pérenne, sans affecter les justiciables à faible revenu. »
*
Traitement du contentieux prud'homal
La Cour de cassation s'est penchée sur le traitement des dossiers prud'homaux :
"Une réflexion approfondie doit être engagée sur le
traitement du contentieux prud'homal, qui donne lieu trop souvent à des
condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 141-1 du code
de l'organisation judiciaire relatif à la réparation des dommages
causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Parmi les sujets qui méritent une attention particulière, on peut
mentionner, à titre d'exemples :
- l'analyse des conditions de réalisation des procédures de conciliation
préalable devant les conseils de prud'hommes, afin d'assurer une meilleure
efficacité ;
- l'éventuelle instauration d'une véritable mise en état
des affaires, avec des pouvoirs de sanction en cas de non-respect des délais
fixés, les réformes de procédure civile issues du décret
n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à
la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale s'avérant
à cet égard insuffisantes puisqu'elles subordonnent les mesures
de contrainte à l'accord des parties ;
- les difficultés liées aux procédures de départage,
trop nombreuses devant certaines juridictions ;
- l'utilité ou l'inutilité du maintien de la procédure
orale devant la cour d'appel en droit du travail, certaines cours d'appel ayant
des délais de fixation des affaires particulièrement longs et
étant malgré tout conduites, les dispositions contraignantes de
la procédure ordinaire n'étant pas applicables, à renvoyer
un certain nombre d'entre elles, en raison de communications tardives que les
textes ne permettent pas toujours de sanctionner efficacement.
Le directeur des affaires civiles et du sceau s'est déclaré favorable
au principe visant à améliorer la phase de conciliation et à
mettre en place une véritable mise en état ainsi qu'une extension
aux conseils des prud'hommes du décret du 1er octobre 2010 précité
même si des concertations interministérielles restent nécessaires".
*
Chômage :
Le Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT, vient d'annoncer,
lors d'un déplacement de terrain en Seine Saint Denis accompagné
de Michel SAPIN, ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social, un accroissement important des moyens de Pôle emploi
: 2 000 agents supplémentaires ' embauchés en CDI '
viendront renforcer l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'emploi
d'ici la rentrée de septembre.
Pôle emploi a commencé à déployer, depuis début
2013, sa « nouvelle offre de service ».
Avec cette nouvelle offre ambitieuse, les priorités fixées à
Pôle emploi sont claires :
- un accompagnement plus personnalisé, autour de trois grandes modalités
de suivi ;
- une action plus proche des territoires, en renforçant la capacité
d'action et de décision des agents de terrain ;
- une simplification et un allègement des taches administratives qui
permettent de redéployer des ressources internes vers le contact direct
avec les chômeurs.
Face à la progression du chômage, pour que cette « nouvelle
offre de service » produise pleinement ses effets qualitatifs d'amélioration
du suivi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, en prenant
en compte la réalité des conditions de travail des agents de Pôle
emploi, le Gouvernement a considéré qu'il était nécessaire
d'accroître les moyens humains de ce grand service public. Michel
SAPIN, à l'instar du Premier Ministre ce matin, tient à souligner
« l'implication exceptionnelle des agents de Pôle emploi dans
ce contexte difficile ». Les décisions d'aujourd'hui
« montrent l'engagement concret du Gouvernement
à leur côté ».
*
parution de : "Salariés, comment déjouer les pièges du licenciement"
Résumé
Le licenciement, ce n'est pas seulement un problème de Droit ! Bien souvent,
par mauvaise foi, franche intention de nuire ou tout simplement ignorance, l'employeur
va "trop loin".
C'est pour vous défendre dans ces cas-là que ce guide a été
écrit. Il ne se limite pas aux seules règles codifiées
masi traite, à partir de cas réels et transpossables, de la pratique
vécue du licenciement.
Conçu par deux spécialistes militants syndicaux (l'un Conseiller
du salarié, l'autre ancien Conseiller Prud'homme) et répondant
aux questions les plus souvent posées, ce guide complet vous apporte
le meilleur éclairage pour :
- analyser correctement chaque contexte de licenciement,
- aborder chaque situation particulière,
- dégager les règles normales qui devraient s'appliquer,
- déjouer les pièges tendus,
- orienter efficacement votre procédure juridique,
- trouver les références légales et la jurisprudence appropriées.
Le lecteur salarié exposé à l'une des situations décrites trouvera dans ce guide les clés pour organiser sa défense. Plus généralement, le salarié attentif et vigilant à tout risque de licenciement aura sous la main un recueil de connaissances l'aidant à anticiper autant que faire se peut.
Auteurs : Didier Schneider - Patrick Le Rolland, 192 pages, 22.50 '
*
La rupture conventionnelle en ligne
www.teleRC.travail.gouv.fr est un nouveau service en ligne qui permet aux employeurs et aux salariés d'effectuer une demande d'homologation de rupture conventionnelle d'un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI).
La rupture conventionnelle est un mode de rupture alternatif à la démission et au licenciement. Elle permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique :
convention signée par les parties au contrat, c'est-à-dire
l'employeur et le salarié
demande d'homologation auprès de l'UT de la DIRECCTE
A compter du 1er février 2013, un nouveau service en ligne TéléRC permet d'effectuer les demandes d'homologation
Sur www.teleRC.travail.gouv.fr, vous disposez :
des informations sur la rupture conventionnelle ;
d'un formulaire de demande d'homologation ;
d'une assistance pas à pas dans la saisie du formulaire ;
d'un outil de simulation pour estimer le minimum légal que l'employeur
doit verser au salarié
des coordonnées de vos interlocuteurs en département.
*
Quand Capital raconte n'importe quoi sur le contentieux prud'homal
Dans le magazine de Capital de décembre 2012, page 104, on peut lire dans un article, nommé " Notre code du travail bride les énergies et les embauches " la phrase suivante, sensée effrayer le bon sens : " les recours aux prud'hommes ont augmenté de 11,5 % depuis 5 ans "
Or une rapide recherche sur le site du ministère de la Justice ne donne que ces chiffres :
2006 : 199795 saisines
2011 : 205296 saisines.
Pour les 5 dernières années disponibles au moment de la rédaction
de cet article, l'augmentation sur les 5 dernières années n'était
que de 2,75 %
(http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/
)
En partant même depuis 2001, la stabilité ne fait que sauter aux yeux :
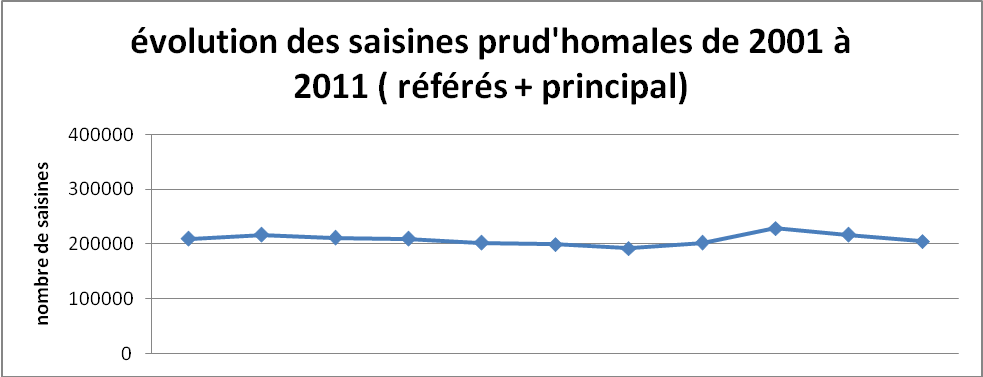
ci dessus : 10 ans de procédures prud'homales
D'ou sortent donc ces 11,5 % avancés par Bruno Declairieux, l'auteur ?
Le même article enchaîne :
" la chambre sociale de la Cour de cassation est débordée
d'affaires ".
C'est méconnaître la réalité de la situation : le
nombre d'affaires de la haute cour est en baisse.
Le rapport annuel de la Cour de cassation en 2011 ne laisse guère de
doute :
" S'agissant de l'activité des chambres civiles, de la chambre sociale
et de la chambre commerciale au cours de l'année qui s'est écoulée,
on retient qu'elle est marquée par une stabilité relative du nombre
de dossiers enregistrés, ainsi que du délai de jugement d'un dossier
(en moyenne 376 jours). "
Une stabilité depuis la baisse enregistrée en 2007 :
" Cette évolution peut s'expliquer par la baisse du contentieux
prud'homal, de 6382 dossiers en 2006, à 5684 dossiers en 2007, soit -
11 % Cette baisse peut s'expliquer notamment par les effets de l'extension,
depuis 2005, de la représentation obligatoire à la matière
prud'homale, qui permet en amont de limiter le nombre de pourvois, grâce
aux conseils donnés aux justiciables par les avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation. " ( rapport 2007 de la cour de cassation.
)

*
Le MEDEF revendique l'immunité judiciaire pour les entreprises !
Communiqué du syndicat des avocats de France.
*
Le Centre d'études de l'Emploi a réalisé conjointement avec la CFDT une étude sur les ruptures conventionnelles, portant sur 100 cas.
221
pages pour mieux comprendre les mécanismes sociologiques de la rupture
conventionnelle.
En voici le résumé :
Rendre possible la mobilité
Les entretiens avaient donc moins vocation à donner l'image la plus représentative
de la réalité qu'à décrire la variété
la plus grande possible de cas afin que le guide d'entretien élaboré
par le comité de pilotage constitué par la DARES soit capable
de prendre en compte l'éventail le plus large de situations.
La CFDT souhaitait, quant à elle, développer des dispositifs permettant
d'opérationnaliser son objectif de " sécurisation des parcours
professionnels ". Derrière ce vocable, figure une double idée
: d'une part, alors qu'une importante partie des mobilités reste subie,
il importe de promouvoir les mobilités " choisies " ; d'autre
part, des dispositifs permettant à des salariés acculés
à la démission de quitter leur emploi en bénéficiant
de l'assurance chômage sont à inventer.
La CFDT s'est notamment appuyée, pendant la négociation sur un
schéma mettant en évidence qu'un très grand nombre de ruptures
de contrat sont des démissions en quelque sorte " contraintes "
: des salariés poussés à bout dans leur travail ou désireux
de quitter celui-ci pour des raisons qui peuvent être variées ne
peuvent pas le quitter parce qu'il n'existe aucun dispositif permettant de sécuriser
le passage d'un emploi à l'autre et notamment de permettre aux salariés
d'accéder à l'assurance chômage. Ce sont ces mobilités
" empêchées " que la CFDT souhaitait rendre possibles.
L'inscription de cette forme de rupture dans le Code du travail soulève
des interrogations qui sont liées à la nature même du contrat
de travail. Dans la mesure où rien ne transparaît, ni de l'initiative
ni des motifs de la rupture, on en est réduit à des conjectures
sur ce qui peut bien conduire un salarié à échanger un
emploi à durée indéterminé contre un statut de chômeur,
au surplus dans un contexte général où les perspectives
de reprise d'activité sont défavorables.
Pour les négociateurs de l'ANI, le salarié est nécessairement
à l'initiative de la rupture, puisque la RC lui permet d'effectuer une
mobilité en toute sécurité. Et son consentement est nécessairement
éclairé puisqu'il est entouré de nombreuses garanties de
procédure.
Pour les critiques du dispositif au contraire, compte tenu du lien de subordination,
le consentement du salarié ne peut jamais être libre, et la RC
profiterait surtout à l'employeur, notamment pour dissimuler des licenciements
pour motif économique.
Il est donc légitime de chercher à identifier ces circonstances
en se plaçant du seul point de vue du salarié, puisque c'est seulement
les motifs de son consentement qui ne vont pas de soi.
Ce n'est pas parce que la RC n'est pas juridiquement imputable à l'une
ou l'autre partie qu'elle ne l'est pas pratiquement. Et ce n'est pas parce que
ses motifs ne sont pas exprimés qu'elle en est dépourvue.
Parce qu'elle ne tranche pas un litige, la convention de rupture ne constitue
pas une transaction, et n'a pas autorité de chose jugée relativement
aux obligations nées du contrat de travail. L'homologation de la convention
n'a pas non plus cet effet, puisqu'elle n'emporte pas vérification des
sommes dues au titre du contrat. Il en résulte que des points litigieux
peuvent subsister entre les parties, qui ne sont pas éteintes par la
convention. Si la convention n'a pas réglé toutes les obligations
nées du contrat (paiement de salaires, heures supplémentaires,
clause de non-concurrence, DIF etc.), des contentieux restent possibles, sans
que la rupture soit remise en question. Les délais de prescription seront
ceux du droit commun (cinq ans), et non la prescription abrégée
de douze mois.
La RC constitue donc une porte de sortie pour une grande part des salariés
(près de la moitié des personnes interrogées) qui étaient
en souffrance, qui s'ennuyaient dans leur travail, qui étaient en désaccord
avec la stratégie de l'entreprise, son mode de gestion ou l'arrivée
d'un nouveau responsable, ou encore qui connaissent des trajectoires fort morcelées
(démissions répétées, congés parentaux, congés
de présence parental auprès d'un enfant malade).
Les plus faibles intègrent le discours de l'employeur
Les plus faibles intègrent le discours de l'employeur sans chercher à
confirmer l'information, auprès de l'inspection du travail par exemple.
La législation en matière de droit du travail est en effet très
opaque pour les non-juristes, mais les salariés ne réagissent
pas tous de la même manière : la majorité des bas salaires
font donc " confiance " à leur employeur et s'en tiennent à
leurs explications. Alors que les cadres vont davantage chercher l'information
par eux mêmes (internet, réseau personnel, inspection du travail,
syndicats) afin de procéder à une véritable " étude
de cas ".
Environ 40% des personnes interviewées met en évidence que la
RC a constitué un moyen pour les employeurs de faire partir des salariés,
alors qu'ils n'auraient pas pu ou voulu les licencier.
L'employeur peut ne pas voir d'inconvénients à une rupture conventionnelle
lorsque le départ du salarié lui permettra de réembaucher
à des conditions moins favorables.
Ce dispositif peut aussi permettre de ne pas réintégrer une salariée
qui était remplacée lors de la prise d'un congé parental
ou de débloquer une situation conflictuelle.
Ce mode de rupture peut également être accordé par un employeur
qui souhaite soutenir un salarié dans son projet de reconversion professionnelle
et par là, procéder à une forme de reconnaissance du travail
effectué durant plusieurs années.
La rupture conventionnelle, connotée moins négativement qu'un
licenciement ou qu'une démission, peut permettre à une entreprise
de se refaire une image positive après de nombreuses démissions
pour causes de conditions de travail difficiles
On retrouve une idée de " patrimonialisation de leur emploi "
(volonté d'une prime de départ après plusieurs années
d'ancienneté).
Un peu moins d'un quart des enquêtés souligne l'absence d'entretien
avant la signature de la rupture conventionnelle ou assimile le face à
face durant lequel le document CERFA est signé à ce dit entretien
officiel. Ces cas recouvrent notamment les annonces " surprises "
de l'employeur, mettant alors le salarié devant le fait accompli, la
phase des pourparlers n'ayant pas lieu.
Le formulaire CERFA est quasiment toujours pré-rempli lors de l'entretien
durant lequel les parties signent la convention, cette manière de procéder
annihile, pour beaucoup, la possibilité de négocier.
" ça pas été simple jusqu'à ce qu'il accepte
et coup de vice au moment de signer les papiers, c'était pas les bons
chiffres. Les chiffres étaient quasiment divisés par deux. Là,
le ton est remonté jusqu'à ce que je menace d'abandonner la rupture
conventionnelle pour l'attaquer et puis finalement il a cédé.
Quand il a vu que je ne me laissais pas faire, il a cédé.
Il m'a mis une pression en me demandant de continuer mon travail jusqu'à
mon dernier jour et je lui ai dit que s'il m'adressait la parole encore une
fois, je revenais avec l'inspection du travail et je que je l'attaquais pour
harcèlement. Après ça a été terminé.
Lettre du salarié de demande officielle de RC. Pour l'employée
commerciale, l'employeur, qui était pourtant à l'origine du départ
et de la RC, exige une lettre officielle. La salariée écrit "
Suite à notre entretien, j'accepte votre demande de RC ".
Ses collègues lui disent que cette formule " ne passera pas "
auprès de la direction, finalement la lettre ne sera pas refaite.
Dans certaines PME ou grandes entreprises, l'employeur demande au salarié
de rédiger une lettre afin de motiver sa demande et ainsi, de pouvoir
en quelque sorte, prouver la liberté du consentement.
Un peu moins d'un quart des interviewés déclare que le formulaire
CERFA a été antidaté.
Une très petite minorité des salariés interrogés
(environ un dixième) s'est faite assister pendant l'entretien.
La présence d'un syndicaliste extérieur à l'entreprise
permet de régler des différents ;
Le ratio de leur indemnité décuplée.
Ces salariés parisiens qui ont fait appel à un avocat ont vu le
ratio de leur indemnité décupler.
Cette intervention juridique semble être un moyen de rééquilibrer
les rapports de force entre les parties. La présence d'un avocat peut
donc permettre au salarié d'être moins isolé et d'être
mieux conseillé. Reste cependant la question du coût financier
de ce soutien'
Seuls les hauts salaires ont (et peuvent avoir) recours à cette aide.
Il est intéressant de constater que l'indemnité n'est pas nécessairement
liée à l'ancienneté puisque certains salariés qui
ont peu d'ancienneté ont négocié des indemnités
importantes. En revanche, le ratio de l'indemnité est bien souvent corrélé
avec la catégorie socioprofessionnelle :
ce sont les cadres qui obtiennent les indemnités les plus élevées.
Ceux qui négocient des indemnités relativement importantes sont
souvent ceux qui connaissent le droit du travail, qui sont protégés
par leur statut de représentant du personnel ou qui sont assistés
par un avocat.
La volonté et le pouvoir de négociation du salarié diffèrent
selon sa PCS puisque nous avons observé que les ouvriers, les employés
et les techniciens subissent globalement davantage les conditions de leur départ,
alors que les cadres les négocient fortement :
Les négociations divergent également selon la position du salarié
au sein de l'entreprise (le fait de détenir de nombreuses informations
sur l'entreprise peut permettre aux salariés d'être en position
de force)
En outre, pour les non cadres, le fait que le document CERFA soit pré-rempli,
dans la très grande majorité des cas, tend à éteindre
la négociation. Le salarié a en effet le sentiment que tout est
déjà joué et que la rupture doit être acceptée
en ces termes ou refusée. Certains regrets a posteriori se sont faits
d'ailleurs jour lors des entretiens effectués.
En effet, dans presque la moitié des situations, le montant de l'indemnité
est découvert le jour de l'entretien, c'est-à-dire pour une majorité,
celui de la signature. Les salariés sont souvent démunis et préparés
(par la direction ou par des conditions de travail difficiles) à signer
à n'importe quel prix.
Il a été observé que dans les situations de conflits et/ou
de suppression de poste ou lorsque le salarié est remplacé rapidement,
ce dernier reçoit parfois une dispense autorisée de travail.
Limiter les contestations.
La rupture conventionnelle a été présentée comme
le moyen de limiter les contestations et d'éviter au maximum les recours
en justice d'une des deux parties grâce à la pacification des ruptures
de contrats de travail. Elle serait ainsi une " forme juridique organisée
de rupture amiable " du contrat de travail et permettrait de " sécuriser
" la rupture de ce dernier en évitant le recours à la justice
et pour restreindre les contentieux. Mais en lieu et place de cette sécurisation
attendue, notre enquête de terrain a plutôt mis au jour, si l'on
suit les salariés, un étouffement, voire un évitement et
en tous cas un non-règlement des conflits.
Les signatures de RC sont dues à :
-des salariés qui refusent tout conflit
-des salariés qui étaient prêts à aller au conflit
mais qui se sont désistés du fait de la proposition patronale
-des salariés qui ont accepté, mais qui quelques mois après,
se mordent les doigts d'avoir accepté.
En majorité, les salariés sont satisfaits d'avoir signé.
Nous nous posions la question de savoir si ce dispositif concourt à pacifier,
dans les faits, les ruptures de contrat de travail. Si pacifier c'est éviter
le recours aux tribaux, alors la réponse est positive. Mais si pacifier
c'est éviter les conflits latents ou ouverts ou ressentir un vécu
positif de la procédure, alors la réponse est négative.
En effet, si la quasi-totalité des interviewés émettent
une opinion très favorable sur le dispositif de rupture conventionnelle
(comme nous le verrons plus loin), la procédure est en revanche, chez
bon nombre de salariés, vécue difficilement, certains ressentent
même de la colère et de l'éc'urement.
Le poste est pourvu pour la moitié de l'échantillon, mais précisons
que dans 10 % des cas il est pourvu en interne et que parfois c'est le poste
du remplaçant qui est supprimé.
Dans près d'un tiers des cas le poste est supprimé et, de façon
plus anecdotique, il est externalisé ou " avalé " par
l'activité de salariés déjà en poste.
Six mois après une rupture conventionnelle, 75 % des salariés
sont au chômage.
Concernant le devenir du salarié après sa RC, les proportions
sont les suivantes, six mois après la signature de la rupture :
Les trois quarts de l'échantillon est toujours inscrit à Pôle
Emploi. Un quart de l'échantillon a obtenu un nouvel emploi salarié
après s'être inscrit à Pôle emploi.
Un tiers de l'échantillon est toujours inscrit au Pôle emploi et
recherche dans le même secteur. Un peu moins de la moitié de l'échantillon
est toujours inscrit au Pôle emploi, mais met en place un projet de création
d'entreprise (souvent en auto-entrepreneur) ou de reconversion professionnelle
(formation).
Des situations plus rares ont également été repérées
: environ 5 % de l'échantillon est en invalidité, arrêt
maladie ou congé parental ; 5 % également en " préretraite
" payée par l'Unedic et prochainement en dispense de recherche d'emploi
; et deux personnes sont à la retraite.
Les personnes qui sont toujours inscrites au Pôle emploi et qui recherchent
dans le même secteur d'activité sont, bien souvent, celles qui
ont subi leur départ.
Ne souhaitant ni quitter leur entreprise ni leur ancien poste et étant
pour beaucoup surprises de l'annonce de la rupture, elles n'envisagent pas de
changements particuliers dans leur trajectoire professionnelle. Ce sont surtout
pour ces salariés que la rupture du contrat et le statut de chômeur
représentent une véritable charge mentale.
Ceux dont la trajectoire professionnelle est la plus stabilisée aujourd'hui
sont donc ceux qui ont élaboré leur projet de reconversion avant
la rupture et qui ont fait des formations en emploi. Il s'agit d'ailleurs de
salariés à l'initiative de leur départ et dans ce cas,
le projet professionnel est construit et longuement mûri.
3 à 4 mois à sortir du chômage.
En moyenne, les salariés qui ont pu retrouver un emploi, ont mis entre
trois et quatre mois à sortir du chômage.
Opinions portées sur la rupture conventionnelle : entre " solution
idéale " et " moins pire " des solutions. Il est frappant
de constater que quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture
(salarié ou employeur), les situations (conflictuelles ou non) et les
modalités (négociations abouties ou non), la quasi-totalité
des enquêtés émet un avis positif sur le dispositif même
lorsque les entretiens révèlent que les salariés regrettent
profondément ce qui est arrivé ou ont eu à souffrir de
la situation ou encore considèrent qu'ils ont été poussés
dehors. Les raisons évoquées sont diverses, mais il ressort que
le dispositif étaient parfaitement adapté à leur situation
(au-delà même de leurs espérances pour certains) et/ou que
les clauses étaient intéressantes. En somme, la rupture conventionnelle
est vue comme la " solution idéale " pour beaucoup ou comme
" la moins pire des solutions " pour les autres. Cette vision positive
peut tout autant porter sur le principe, les droits afférents que sur
les représentations (dispositif moins stigmatisant que les autres modes
de rupture). Il était en cela essentiel de distinguer les vécus
de la procédure, souvent négatifs (comme nous l'avons vu précédemment)
et les opinions, majoritairement positives ou du moins mitigées, comme
nous allons l'appréhender dans cette dernière sous-partie.
Opinions négatives
Des salariés se plaignent de l'absence de motif et souffrent du fait
que leur employeur ne leur ait pas explicité les raisons pour lesquelles
ils devaient quitter l'entreprise. Au-delà de ce manque de transparence,
deux arguments négatifs ont principalement été énoncés
lors des entretiens : l'un ayant trait à la question du consentement
(en cas de départ contraint, on assiste à un vice du consentement
qui ne relève donc pas du commun accord) et l'autre à celui des
conflits (la rupture conventionnelle pouvant être vue comme un mode de
résolution des conflits)
Opinions mitigées
Un certain nombre d'enquêtés indiquent que si le dispositif est
bien pour eux, il n'est pas bien sur le principe. Ce sont ceux qui ne voulaient
pas partir, mais n'ont pas eu le choix ou auxquels on a exercé une forme
de chantage : " si tu ne prends pas la RC c'est le licenciement pour faute
grave " ou dans d'autres cas, le licenciement économique. Un salarié
dont la rupture conventionnelle masque un licenciement économique et
dont les négociations sur le montant de l'indemnité n'ont pas
abouties, émet un sentiment ambivalent à l'égard du dispositif
au sens où il permet une garantie financière (indemnité
légale de rupture et indemnités-chômage), mais rend également
possible le contournement des lois en matière de licenciement économique.
Opinions positives
La plupart des interviewés (84%) porte un jugement positif sur la RC
tel que " pour moi, c'est bien". Ce dispositif leur a permis de quitter
un emploi devenu source de souffrance ou de mener à bien un projet professionnel
(reconversion ou entreprenariat) voulu depuis longtemps ou peu à peu
formulé au cours des moments qui ont amené à la rupture.
Pour les personnes qui voulaient partir, de leur fait ou parce que leur travail
était devenu insupportable, l'indemnisation chômage apparaît
comme un formidable avantage : " c'est tellement avantageux pour le salarié
que ça va disparaître ". Notons toutefois que beaucoup connaissaient
mal le droit du travail et pensent que s'ils étaient licenciés,
ils n'auraient pas accès à l'indemnisation chômage. Le licenciement
apparaît comme un dispositif repoussoir, tant pour les employeurs que
pour les salariés qui considèrent le fait d'avoir été
licencié comme un stigmate. La RC permet alors aux employeurs et aux
salariés d'éviter le mauvais effet réputationnel du licenciement.
Pour beaucoup le dispositif se révèle donc être la "
solution idéale " par rapport au licenciement (qui " salit
" le travail ou la relation à l'employeur) et à la démission
(qui installe le salarié dans une forme de précarité économique
s'il n'a pas retrouvé d'emploi).
La quasi-totalité des salariés à l'initiative de leur rupture
de contrat a précisé qu'ils ne l'auraient pas fait sans ce dispositif,
car ils ne pouvaient pas " se permettre " de démissionner.
La rupture conventionnelle : une issue de secours.
En somme, les opinions portées sur le dispositif de rupture conventionnelle
sont globalement très positives ou plutôt positives. La quasi-totalité
des avis converge vers le sentiment que cette nouvelle forme de rupture "
à l'amiable " est un très bon outil, une bonne solution,
rapide et simple où les deux parties ressortent gagnantes, à condition
cependant qu'elles soient toutes deux d'accord et que la procédure soit
établie dans les règles.
La rupture conventionnelle représente donc une issue de secours que le
salarié, très souvent non conseillé et non représenté,
se hâte d'accepter sans prendre bien souvent le temps (par ignorance ou
par résignation) de négocier son indemnité de départ.
L'objectif de la rupture conventionnelle a t il été atteint
?
Dans certaines entreprises, l'employeur a même demandé au salarié
de rédiger une lettre dans laquelle il reconnaissait être à
l'origine de la demande, sans doute pour éviter des contestations sur
la liberté du consentement. Nous avons retrouvé ce cas de figure
dans près d'un quart de l'échantillon, principalement dans des
grandes entreprises.
La sécurisation est attestée au plan national par le très
faible nombre de litiges.
Si on considère que l'objectif poursuivi par la RC est de faciliter les
seules mobilités choisies on peut donc estimer que le dispositif a atteint
sa cible dans un quart des cas. La RC a ici joué pleinement son rôle,
en répondant aux attentes des salariés. Si l'objectif est également
d'aider les salariés en souffrance et/ou en conflit à quitter
leur emploi, alors le dispositif a atteint ses objectifs dans plus de la moitié
des cas.
*
Rupture conventionnelle
Les indemnités de rupture conventionnelle seront sujettes à cotisations sociales ( 'forfait social' de 20 %) à partir du 1er janvier 2013. Elles sont aujourd'hui exemptées de cotisations sociales lorsqu'elles sont inférieures à 72.700 euros.
*
Christiane Taubira veut supprimer en 2014 la taxe justice de 35 euros
La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a "donné sa parole" vendredi d'abroger en 2014 la taxe de 35 euros instaurée en octobre 2011 pour certains actes de justice, qu'elle a dit n'avoir pas pu supprimer dès 2013 pour des raisons budgétaires.
"Je suis désolée", aucun "dispositif alternatif" de financement n'a été trouvé avant les arbitrages budgétaires pour pouvoir supprimer cette taxe, a déclaré la ministre lors de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les quelque 55.000 avocats français.
Depuis le 1er octobre 2011, les justiciables doivent s'acquitter d'une somme de 35 euros pour engager des actions en justice en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale.
Cette taxe est destinée à financer l'augmentation du montant de l'aide juridictionnelle (aide d'État permettant aux personnes à faibles revenus de bénéficier des services d'un avocat), entraînée depuis avril 2011 par la réforme de la garde à vue, qui prévoit une présence accrue des avocats.
Certaines procédures en sont exonérées, de même que les personnes aux revenus les plus modestes.
Cette taxe, a rappelé Mme Taubira, rapporte 55 millions d'euros destinés à l'aide juridictionnelle.
"Je vous donne ma parole ici, quitte à vendre quelques joyaux de la Chancellerie, qu'en 2014 j'abrogerai cette taxe de 35 euros", a-t-elle affirmé.
*
Démission, départ négocié, licenciement, retraite,
sanction - Employeur et salarié : quels sont vos droits et vos devoirs
?
10e édition
Sortie de la dixième édition de ce classique indispensable aux praticiens : Avocats, syndicalistes, représentants du personnel, magistrats spécialisés en droit social. 466 pages de jurisprudences, de conseils, de lettres type. Cet ouvrage de qualité comporte aussi un chapitre su ra rupture conventionnelle.

*
Rupture conventionnelle : pour quels salariés l'autorisation administrative est-elle requise ?
L'administration vient de préciser le champ d'application de la procédure d'autorisation administrative en cas de rupture conventionnelle (circ. DGT 2012-07 du 30 juillet 2012, Fiche 14). Pour les salariés dits « protégés », la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et non pas à l'homologation du DIRECCTE.
Compte tenu du fait que la recodification du code du travail en 2008 est intervenue
à droit constant, les salariés bénéficiant de la
protection sont les suivants :
- les représentants du personnel titulaires d'un mandat en cours listés
dans le code du travail (c. trav. art. L. 1237-15 renvoyant à L. 2411-1
et L. 2411-2) ;
- les anciens détenteurs de mandats (protection pendant 6 ou 12 mois)
;
- les salariés ayant demandé l'organisation des élections
professionnelles (protection pendant 6 mois) ;
- les candidats à ces élections (protection pendant 6 mois) ;
- les représentants de la section syndicale ;
- les médecins du travail (c. trav. art. L. 1237-15).
La décision de la Cour d'appel de Paris selon laquelle la rupture conventionnelle conclue avec un candidat aux élections professionnelles n'est pas soumise à autorisation administrative (CA Paris 22 février 2012, ch. 6-6, n° 10/04217) doit donc être écartée, sachant que la Cour de cassation pourra être amenée à se prononcer sur la question.
Circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012
*
« Si vous n'acceptez pas la rupture conventionnelle, je vous licencie »
Un conseiller du salarié répond à la chef d'entreprise « harcelée » par ses employés, qui dénonçait les dérives de cette loi sur Rue89.
Chère Madame Victoire,
Je viens de lire votre témoignage de patronne « harcelée » par des salariés vous « demandant de les libérer' contre monnaie sonnante et trébuchante » : vous racontez comment ils viennent vous demander des ruptures conventionnelles pour partir.
Je suis conseiller du salarié de Paris. A ce titre, j'ai personnellement
assisté à environ 400 entretiens préalables à licenciement
et participé à 30 ou 40 ruptures conventionnelles. J'anime
également une permanence juridique au sein de mon organisation syndicale
et je défends des dossiers devant les prud'hommes. C'est pourquoi
je me permets de commenter votre intervention.
Des ruptures pour cesser de souffrir
A chaque fois qu'un salarié vient me consulter pour que je l'aide à négocier une rupture conventionnelle, je lui demande avant toute chose d'où vient sa demande.
Il s'agit très souvent de mettre fin à une souffrance au travail : le salarié ne voit pas d'autre issue qu'une rupture conventionnelle. L'idée lui est la plupart du temps suggérée par l'encadrement et le salarié se résigne à quitter son emploi plus qu'il ne le souhaite.
J'ai par exemple deux dossiers en cours qui ont débuté par ce type de demande et qui relèvent maintenant de la médecine du travail. Dans le premier cas, l'employée a d'abord été mise à l'écart et subi des mesures vexatoires.
Son bureau a été déménagé à côté
des toilettes, ordre a été donné aux autres de ne plus
lui adresser la parole, sa charge de travail a été alourdie, de
nouvelles tâches lui ont été attribuées qu'elle
ne sait pas accomplir (elle n'a pas été formée pour),
etc. Le fond de l'affaire, avons-nous découvert, c'est que
l'employeur a la volonté de remplacer cette salariée, payée
environ 1 500 euros brut, par deux stagiaires à 400 euros chacun.
Chantage et menaces
Dans de très nombreux cas, cette méthode est assortie d'un chantage. L'employeur menace :
« Si vous n'acceptez pas la rupture, je vous licencie pour faute grave, vous irez aux prud'hommes, vous gagnerez, je ferai appel et vous n'aurez votre argent que dans trois ans au mieux. »
J'ai un procès en cours où, imprudemment, l'employeur à tenu ce genre de propos devant un témoin qui a accepté d'en attester. Les faits remontent à un an et le bureau de jugement ne se réunira que dans deux mois.
Pour rappel, le licenciement pour faute grave prive le salarié des indemnités
et du préavis. Alors que la rupture conventionnelle ne peut être
conclue sans indemnité de rupture.
Pour contourner la loi
Dans d'autres cas que j'ai pu accompagner, l'employeur utilise cette nouvelle possibilité pour contourner la loi. Il aurait dû recourir à un licenciement économique ou à un licenciement qui aurait été sans cause réelle et sérieuse, mais il a préféré la rupture conventionnelle.
J'ai vu aussi une entreprise procéder à de nombreuses ruptures alors qu'elle connaissait des difficultés économiques, et aurait dû procéder à la mise en place d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
L'intérêt, pour l'employeur, c'est que les instances
représentatives du personnel et l'administration n'ont aucun
droit de regard.
Difficile de savoir qui décide de la rupture
Globalement, de par mon expérience, je constate que, dans 90 % des cas, la rupture conventionnelle est proposée par l'employeur, souvent de cette manière insidieuse : le salarié est poussé à bout d'abord.
Le Centre d'études pour l'emploi (CEE) a mené une étude auprès de 101 salariés ayant signé une rupture conventionnelle et ses résultats sont plus mitigés que les miens. L'étude montre que près de la moitié des ruptures conventionnelles seulement sont à l'initiative de l'employeur.
Cela appelle deux remarques de ma part :
si dans un peu plus de la moitié des cas, les salariés sont à l'initiative de la rupture, ils le font principalement pour des raisons conflictuelles, précise l'étude. Autrement dit, même dans cette petite moitié de salariés qui aurait formellement demandé une rupture conventionnelle, l'analyse des motivations de la demande démontre qu'elles trouvent leurs origines dans des agissements potentiellement répréhensibles de l'employeur ;
j'ai affaire à un public qui a encore le réflexe de venir nous consulter. Or celui-ci ne représente que 10% des personnes interrogées par le CEE.
Ce dernier chiffre est essentiel à la compréhension du dossier
: la rupture conventionnelle remet bien le salarié en situation individuelle
face à son employeur et fait donc sauter toutes les garanties collectives.
Des volontaires pour le chômage ?
Il faut tout de même se demander pourquoi autant de salariés ' près de 900 000 ' concluent une rupture conventionnelle pour, dans les trois quarts des cas, se retrouver toujours chômeurs six mois après, indemnisés à 57 % de leur salaire.
Selon une étude du service statistique du ministère du Travail, la Dares, entre le 1er semestre 2009 et le 1er semestre 2011, la part des licenciements économiques a chuté de 12% à 6% alors que les ruptures conventionnelles passaient de 7% à 13 % des fins de CDD. Cette tendance s'est encore aggravée en 2012. N'y aurait-il aucun rapport entre ces deux chiffres ?
*

Marre de vous faire avoir ?
Ce guide est bien trop succinct pour répondre à l'ensemble des
questions de consommateurs.
Tout y passe : litige avec la banque, le FAI, les soldes'
Or chaque sujet ne peut être traité en une page et demie. Aucune liste de sites ou d'organismes utiles. Peu de jurisprudences, peu d'articles de codes cités.
On évitera de se faire avoir en achetant cet article.
*
Peut-on être licencié pour observer le ramadan ?
Quatre moniteurs d'une colonie de vacances qui observaient le ramadan ont été
suspendus. Retour en sept questions sur une histoire qui fait couler beaucoup
d'encre.
Pourquoi les animateurs ont-ils été suspendus par la mairie de
Gennevilliers ?
Il y a deux raisons. La première remonte au mois d'août 2009. En
séjour dans la Nièvre, cinq ados accompagnés de leur animatrice
grimpent dans un minibus pour rejoindre le lac des Settons. L'animatrice s'endort
au volant. Le minibus se couche dans un fossé. Les six passagers sont
blessés, l'un d'entre eux grièvement. Aujourd'hui, il en garde
des séquelles, son bras est à moitié paralysé. Les
causes du malaise de l'animatrice ne sont pas connues, et ne le seront jamais.
Toujours en procès avec les familles, la mairie retiendra seulement que
la jeune femme, qui observait le ramadan, était à jeun. Depuis,
tous les contrats des animateurs ont été modifiés. Une
clause nouvelle a fait son apparition, à l'article 6 (lire ci-dessous).
La seconde raison est la sécurité des enfants. La mairie pense
que les jeûneurs ne peuvent pas tenir, en plein été, le
rythme d'une colonie sportive qui propose : surf, skate, randonnées à
vélo' Et ils seraient moins patients et moins pédagogues
pendant le ramadan du fait de la fatigue.
Que stipule la nouvelle clause de l'article 6 du contrat des animateurs ?
"Pour permettre un bon déroulement des journées et des activités,
il [l'animateur, ndlr] veille à ce que lui-même ainsi que les enfants
participant à la vie en centre de vacances se restaurent et s'hydratent
convenablement en particulier durant les repas. La mise en 'uvre d'un centre
de vacances nécessite des équipes éducatives une implication
permanente sur les terrains durant les séjours. Elle implique que chaque
animateur, soit, pour toute la durée du séjour, en pleine possession
de ses moyens physiques, adhère aux valeurs éducatives de la ville
de Gennevilliers, respecte et mette en 'uvre le principe de laïcité."
Les animateurs étaient-ils au courant de cette clause ?
Le contrat a été signé par tous les animateurs, la clause
était visible, même si le mot ramadan n'est pas écrit dans
le contrat et n'a pas été prononcé pendant l'entretien
d'embauche. Du côté de la mairie, on explique la chose de la manière
suivante : "Le mot ramadan ne figure pas dans le contrat mais tout le monde
sait bien qu'il s'agit de cela." Sur cette affaire, la mairie en veut surtout
au directeur de la colonie à Port-d'Albert, dans les Landes (de confession
musulmane mais qui ne fait pas le ramadan). Elle lui reproche de ne pas avoir
été assez ferme avec ses animateurs à ce sujet et de ne
pas avoir bien recruté son équipe. Le directeur, un ami proche
des quatre suspendus, était pourtant au courant que la mairie ne voulait
pas d'animateurs observant le jeûne.
Comment s'est déroulée leur suspension ?
Le directeur des centres de vacances de la ville s'est rendu sur le site par
hasard. Aucun lien avec le début du ramadan. Pour lui, la question ne
se posait pas, affirme-t-il. A son arrivée, il s'est aperçu que
des animateurs ne mangeaient pas de la journée. Ils étaient cinq
en tout et non quatre.
Le directeur du centre de vacances a convoqué les cinq personnes une
par une, le 21 juillet. Il a indiqué aux quatres garçons qu'ils
prendraient le premier train le lendemain pour Paris pour manquement au règlement
et que leur salaire sera versé intégralement. La cinquième
personne, une fille, a décidé d'arrêter son jeûne
pour pouvoir rester jusqu'au terme du séjour le 27 juillet.
Les quatre ont été remplacés et un autre directeur de colonie
est venu de Paris pour aider le premier. Surtout pour expliquer cette décision
aux ados qui n'étaient pas d'accord avec ce choix. Et qui l'ont fait
savoir à la direction.
Cette clause est-elle légale ?
L'avocat pénaliste, Eric Rocheblave, a répondu à cette
question sur France 3 : "Les employeurs ont une obligation de résultat
en matière de sécurité et de santé de leurs salariés.
C'est-à-dire que lorsqu'un employeur confie à un de ses salariés
un travail, ce travail ne doit pas dégrader l'état de santé
de ses salariés. Donc, un salarié qui fait un jeûne pour
des motifs religieux ou même qui respecte un régime peut-il exercer
toute sorte d'activités professionnelles ? Je ne le pense pas, et les
juges ne le pensent pas non plus. Dès lors que l'employeur fait la
démonstration que les tâches qu'il confie à ses salariés
ne sont pas compatibles avec son état de santé, il peut éventuellement
mettre des clauses dans le contrat de travail."
"C'est le cas notamment des personnes qui travaillent en hauteur, qui font
des randonnées sous le soleil, en altitude : dans ce cas, il faut nécessairement
s'alimenter et s'hydrater. Un employeur peut donc encadrer ce type d'activités,
en dehors de toute considération religieuse. Dans le cas de Gennevilliers,
la décision de l'employeur n'est pas choquante, la colère des
salariés ne me choque pas non plus. Ce n'est évident ni dans un
sens, ni dans l'autre. Il faudra que les juges arbitrent. Il n'y a pas eu de
décision de justice concernant la compatibilité d'une activité
professionnelle avec un jeûne religieux."
Source
*
La face cachée des ruptures conventionnelles
Dans une étude, le Centre d'études de l'emploi (CEE) décortique
une centaine de ruptures conventionnelles afin d'isoler les grandes pratiques
des entreprises et connaître le point de vue des salariés.
La CFDT a demandé au Centre d'études pour l'emploi (CEE) de réaliser
une étude sur la rupture conventionnelle telle que vécue par les
salariés (*). Une centaine d'entretiens en face à face ont été
réalisés auprès de salariés tirés dans un
échantillon au hasard parmi les ruptures conventionnelles enregistrées
en novembre 2010. L'objectif de l'étude est de mieux comprendre les circonstances
qui entourent la conclusion d'une rupture conventionnelle.
61% des ruptures conventionnelles à l'initiative de l'employeur
Comme le soulignent à juste titre les auteurs de l'étude, "même
si la rupture conventionnelle est censée résulter d'un commun
accord, le souhait de rupture émane de l'une des deux parties".
Dans 61% des cas, l'initiative en revient à l'employeur. Mais il faut
toutefois distinguer le souhait de rompre le contrat de travail et l'initiative
de la rupture conventionnelle. Parfois le salarié préfèrerait
passer par la voie du licenciement mais l'employeur lui propose une rupture
conventionnelle.
Parmi les ruptures conventionnelles, près de 40% seraient liées
à un motif économique. "Les salariés parlent d'ailleurs
clairement de licenciement caché ou déguisé", rapportent
les auteurs de l'étude. Un sixième des ruptures conventionnelle
se rapproche davantage d'un licenciement pour motif personnel.
Rompre à l'amiable pour des raisons professionnelles ou personnelles
Lorsque c'est le salarié qui est à l'initiative de la rupture
conventionnelle, plusieurs raisons sont à l'origine d'une telle demande.
Certaines tiennent directement à l'emploi. Ainsi plus d'un quart des
salariés interrogés a déclaré vouloir quitter son
emploi parce qu'il n'offrait pas ou plus d'évolutions de carrière.
Il peut aussi s'agir d'un désintérêt pour son activité
ou d'une reconversion professionnelle. Dans un peu moins de la moitié
des cas, ce sont les conditions de réalisation du travail qui sont en
cause: problèmes relationnels, mise au placard, dégradation des
conditions de travail... D'ailleurs lorsque le conflit est trop important, les
deux parties tombent d'accord pour se séparer par cette voie.
Enfin, des raisons extraprofessionnelles amènent dans un quart des cas
le salarié à solliciter une rupture conventionnelle : déménagement,
contexte familial... Bien évidemment, c'est parfois la conjonction de
plusieurs de ces facteurs qui motive le salarié.
Pourquoi l'employeur accepte la rupture conventionnelle
Du côté de l'employeur, l'étude s'est interrogée
sur les raisons qui motivent l'employeur à accéder à la
demande du salarié plutôt que d'attendre que ce dernier démissionne.
Là encore, les justifications sont multiples : débloquer une situation
conflictuelle ou soutenir un salarié dans son projet de reconversion
professionnelle par exemple. Sans compter que la rupture conventionnelle, pour
l'image de marque de l'employeur, a une connotation plus positive que le licenciement
ou la démission.
Se prémunir contre les vices de consentement
Qui dit rupture conventionnelle, dit accord éclairé des deux
parties. Dès lors que le salarié peut prouver que son consentement
a été vicié, la validité de la rupture conventionnelle
est sur la sellette. "Dans un certain nombre de cas nous avons observé
un vice de consentement au sens ou la contrainte et la pression de l'employeur
étaient si fortes qu'il ne s'agit pas d'un réel consentement mais
d'une résignation", notent les auteurs de l'étude. Dans d'autres
cas, l'employeur se prémunit contre tout contentieux ultérieur
sur ce terrain en demandant au salarié "de rédiger une lettre
afin de motiver sa demande et ainsi de pouvoir en quelque sorte prouver la liberté
du consentement".
Seul un quart des salariés ont bénéficié de plusieurs
entretiens
L'étude s'est ensuite penchée sur la procédure elle-même.
Dans un cas sur deux, un seul entretien a eu lieu. 25% des salariés ont
en revanche pu bénéficier de deux, voire de trois entretiens.
Les pratiques varient fortement selon la taille de l'entreprise. Les grandes
entreprises ont plutôt tendance à organiser plusieurs entretiens
tandis que les petites se contentent souvent de discussions informelles. Il
faut tout de même souligner que dans moins d'un quart des cas, il n'y
a pas eu d'entretien du tout.
Lorsque l'employeur organise plusieurs entrevues, le scenario est souvent identique.
Le premier entretien vise à se mettre d'accord sur la rupture conventionnelle,
le deuxième à négocier les modalités de rupture,
notamment le montant de l'indemnité. Au cours du dernier, les parties
signent la convention Cerfa.
Il est intéressant de noter que dans une part non négligeable
des cas, les entretiens indiqués dans le document Cerfa sont reconstruit
a posteriori.
Le document Cerfa est souvent pré-rempli lors de l'entretien, ce qui "annihile pour beaucoup la possibilité de négocier", constatent les auteurs de l'étude Un peu moins d'un quart des salariés interrogés déclarent que le formulaire Cerfa a été antidaté a posteriori.
L'assistance, une pratique peu répandue
Rien n'empêche le salarié de se faire assister lors de l'entretien.
La pratique reste pourtant rare. Seul un dixième y a eu recours. A cela
plusieurs raisons : le souhait de gérer seul son départ ou la
crainte d'installer un climat de défiance voire de conflit par exemple.
Cela n'empêche toutefois pas certains de demander conseil à des
syndicats.
Le montant de l'indemnité dépend du rapport de force
Le montant de l'indemnité fait souvent l'objet de négociations.
Mais tous les salariés ne sont pas logés à la même
enseigne, observe l'étude. Ce sont sans surprise les cadres qui obtiennent
les indemnités les plus élevées. Mais d'autres facteurs
placent les salariés en position de force : détenir un mandat,
bien connaître le droit du travail ou bien encore recourir à un
avocat, ce qui permet de décupler le ratio de l'indemnité. L'étude
note à ce propos que seuls les salariés de la région parisienne
ont eu recours aux services d'un avocat.
L'indemnité est aussi souvent plus élevée lorsque le climat
est conflictuel. Il s'agit alors en quelque sorte d'une indemnité d'apaisement.
Ou bien encore lorsque c'est l'employeur qui souhaite se séparer du salarié
ou qu'au contraire il veut récompenser une bonne collaboration.
S'agissant de la réalisation d'un éventuel préavis, l'étude ne fournit pas d'informations détaillées. Elle constate que si, en principe, le salarié doit travailler jusqu'à l'homologation ou la date de fin de contrat , dans les situations conflictuelles, il est souvent dispensé d'aller jusqu'à ce terme.
Au final, la rupture conventionnelle a plutôt bonne presse auprès des salariés. "La quasi-totalité des enquêtés émet un avis positif sur le dispositif". La rupture conventionnelle est vue comme "la solution idéale" pour beaucoup, ou comme "la moins pire" pour les autres. (*)
"Des ruptures conventionnelles vues par les salariés. Analyse d'un échantillon de 101 ruptures conventionnelles signées fin 2010". Une étude réalisée par Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel, Dominique Méda, Evelyne Serverin et Laétitia Sibaud
Source
24 juillet 2012
*
Le Monde a publié la liste de tous les licenciements qui se préaparent en France, soit 56 751 postes qui disparaissent.
Source
9 juillet 2012
*
Les conseillers du salarié seront moins nombreux
Dans les grandes entreprises, face à une menace de licenciement,
le réflexe semble simple : faire appel à un délégué
syndical. Mais vers qui se tourner lorsqu'on travaille dans une petite
société dépourvue de représentants du personnel?
Peu de gens le savent, mais ils peuvent faire appel aux conseillers du salarié.
Ces bénévoles, souvent délégués syndicaux
dans leur propre entreprise, sont désignés par le préfet
pour trois ans. Ils sont autorisés à accompagner tout employé
du département qui en fait la demande lors d'un entretien préalable
à un licenciement, ou une rupture conventionnelle du contrat de travail*.
Le sort de ces conseillers inquiète le camp syndical alors que leur liste doit être remise à jour par les services de l'État. Sept syndicats (CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC, Unsa et Solidaires) vont manifester le 12 juin devant les bureaux départementaux de la Dirrecte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à Bobigny, pour dénoncer une « décision brutale et unilatérale ». La Dirrecte envisage en effet de réduire considérablement le nombre de conseillers du salarié. Ils sont aujourd'hui 346 dans ce département où 27% des entreprises comptent moins de 10 salariés et n'ont donc pas de représentants du personnel.
Dans un communiqué commun, les syndicats « rejettent » cette décision et soulignent l'utilité des conseillers « dans un contexte de crise économique aiguë qui provoque une hausse très importante ['] des conflits du travail ». Mais la Dirrecte rappelle que, « lors du dernier renouvellement, en 2009, le nombre de conseillers avait connu un accroissement important, de + 62% avec plus de 350 inscrits à la suite de la demande des syndicats ». « Il s'est avéré que l'activité constatée des conseillers ne justifiait pas cet accroissement », poursuit-elle, estimant que chaque conseiller avait eu en moyenne à intervenir une fois seulement par an. Un bilan qui fait sursauter Pierre Scafogliero, secrétaire départemental de la CFDT : « Soixante-dix conseillers du salarié sont membres de la CFDT. Sur l'année 2011, ils ont à eux seuls participé à près de 700 entretiens! » Comment expliquer un tel écart? « Il y a peut-être un problème de gestion des dossiers, avance le syndicaliste. Les conseillers peuvent être indemnisés pour leurs frais de transport. Or, certains n'ont rien perçu depuis 2008. »
Combien va-t-il rester de conseillers dans le 93? La Dirrecte évoque une diminution de 35%, mais Christian Plazas, de la CGT 93, craint le pire : « Le directeur départemental de l'emploi nous a annoncé le maintien de 151 noms, on supprime donc plus de la moitié de la liste. En période de congés d'été, propice aux licenciements, les salariés ne trouveront aucun conseiller pour les défendre. »
* A condition que son entreprise soit dépourvue de comité d'entreprise,
de délégués du personnel et de délégués
syndicaux.
*
Viré de la Une en 2009 suite à un mail anti-Hadopi, cet employé a défié la chaîne en justice. Jusqu'à la faire condamner, vendredi, pour licenciement abusif.
Il y a des semaines comme ça, où Nonce Paolini ferait
mieux de rester couché. Mardi, le PDG de TF1 était condamné
en justice à verser 80 000 euros à Google que la chaîne
poursuivait pour contrefaçon. Mercredi, la crise à l'info de la
Une éclatait au grand jour avec le départ de Laurence Ferrari.
Et vendredi, Paolini a essuyé un nouveau revers venu cette fois du tribunal
des prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Oui, Jérôme Bourreau-Guggenheim,
viré de TF1 en 2009 pour avoir critiqué Hadopi, a bel et bien
été licencié "sans cause réelle ni sérieuse".
Montant du chèque à signer par Nonce Paolini : 27 000 euros, soit
six mois de salaire (celui du viré, pas celui du patron de la Une).
"Nonce Paolini n'y pense certainement pas tous les soirs en se couchant,
mais moi si." Un têtu, ce Jérôme Bourreau-Guggenheim.
Ex-"responsable du pôle innovation web" de TF1, il lui aurait
été facile de retrouver un boulot aussi sec, d'oublier son licenciement,
de ne pas s'attaquer à l'ogre et son armée d'avocats. Question
de principe. A son tableau de chasse, qui compte déjà le scalp
d'un directeur de cabinet adjoint et au moins la moitié de celui de Christine
Albanel, Bourreau-Guggenheim peut désormais épingler un chèque.
Mais il ne devrait pas s'en tenir là. Il faut dire que son affaire a
jeté un jour extrêmement cru sur les relations entre le gouvernement
UMP d'alors et TF1, détenue par Martin Bouygues, l'ami de Nicolas Sarkozy
: il a suffi d'un mail envoyé du ministère de la Culture à
une huile de la Une pour que Bourreau-Guggenheim soit mis à la porte.
"Hadopi : nous avons besoin de votre aide." Tel est l'intitulé
du mail que, le 19 février 2009, Jérôme Bourreau-Guggenheim
envoie depuis son adresse personnelle chez Gmail via son tout aussi personnel
iPhone à Françoise de Panafieu, députée (UMP) de
son arrondissement. Dans sa famille, on écrit aux élus pour faire
part de son avis de citoyen, c'est une tradition. Là, il plaide contre
le projet de loi Hadopi qui va être examiné à l'Assemblée
nationale. Il peste, en termes très mesurés, contre les sanctions
envisagées et la délégation à des sociétés
privées de la traque aux internautes. Bon gars, il écrit même
du piratage qu'"il faut lutter contre, bien évidemment". Poli,
il déroule son "expertise" d'Internet, son CV, son poste d'alors
à TF1, et appuie sur le bouton "Envoyer". Trois heures plus
tard, son mail est à TF1, sur le bureau de son chef Arnaud Bosom, le
président d'e-TF1. Joie de la collusion, bonheur de la complicité'
Par RAPHAËL GARRIGOS, ISABELLE ROBERTS, LIBERATION.
*
Rupture conventionnelle : de records en records !
316 757 ruptures ont été traitées par l'administration pour 2011, et 287338 ruptures ont été validées. Pour rappel : 2008 : 31671, 2009 : 192125, 2010 : 253654.
*
TF1 condamnée pour avoir viré un salarié anti-Hadopi
Nous venons de l'apprendre du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt : TF1 a finalement été condamné à 27 000 euros pour " licenciement sans cause réelle et sérieuse " de Jérôme Bourreau-Guggenheim. Un jugement en demi-teinte : JBG réclamait aussi la réparation pour l'atteinte à ses libertés fondamentales, en vain : les parties ont été déboutées pour le surplus de leur demande. TF1 devra verser en outre 1200 euros au titre de l'article 700 et enfin assumer les autres frais. Retour sur cette affaire symptomatique qui a marqué la bataille Hadopi, en attendant la publication intégrale du jugement.
En 2009, Jérôme Bourreau-Guggenheim (JBG) est responsable du pôle innovation web de TF1. Lors de la fièvre des débats Hadopi, il écrit à la députée UMP de sa circonscription, Françoise de Panafieu pour dénoncer les points noirs, les bugs et autres absurdités du texte. Ingénieur de formation, il anticipe sans trop de mal le bourbier qui s'annonce. Un texte aux antipodes des nécessités du moment (l'innovation, la confiance dans l'économie numérique) au socle bien fragile (l'adresse IP), fusillé par de nombreuses autorités (la CNIL, l'ARCEP, le Contrôleur Européen à la Protection des Données (CEPD), le Parlement Européen, etc.). Il demandait à la députée de " porter [sa] voix et celle de milliers de citoyens " pour stopper l'usine à gaz en gestation.
Porter sa voix ? Chiche ! Le cabinet de De Panafieu le prend au mot et transfère le courrier au ministère de la Culture pour réclamer un" argumentaire bien 'béton' pour commencer dès maintenant à répondre aux très nombreux mails que nous allons sûrement recevoir ". Le courrier arrive sur le bureau de plusieurs responsables du cabinet Albanel, dont Olivier Henrard et Christophe Tardieu.
Pour calmer l'incendie, TF1 publie un communiqué sur son blog : "
le Groupe TF1 a toujours manifesté une position de soutien au projet
de loi " Création et Internet " HADOPI pour mettre en place
un système de réponse graduée contre le piratage (')
les prises de position particulièrement radicales exprimées publiquement
à plusieurs reprises, en cette qualité, par le Responsable du
Pôle Innovation Web de TF1, ont conduit l'entreprise à se séparer
de ce responsable pour deux raisons : elles sont contraires aux déclarations
officielles du groupe TF1, notoirement en faveur de cette loi, elles sont incompatibles
avec ses responsabilités au sein d'e-TF1, filiale du groupe en charge,
également, de la lutte contre le piratage sur internet. L'entreprise
déplore d'avoir été contrainte de mettre sur la place publique
une décision qui concerne l'un de ses collaborateurs dans une affaire
strictement interne. "
Jérôme Bourreau-Guggenheim n'abandonne pas la lutte. Il porte plainte au pénal pour " discrimination en raison des opinions politiques. " Mais le 6 mai 2010, le procureur de Nanterre, un certain Philippe Courroye, classe sans suite, invitant JBG à se diriger vers le Conseil de Prud'hommes.
Qu'à cela ne tienne ! Derrière son litige contre TF1, c'est la liberté d'expression et d'opinion du salarié qui est menacée. Un salarié peut-il s'exprimer dans une correspondance privé sans l'autorisation de son employeur ?
La bataille prend un tournant cocasse : TF1 estime qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'opinion politique faute d'engagement militant ou partisan de son ex-salarié. De plus, Hadopi dépasse la guerre gauche/droite, le sujet est donc inapte à devenir l'objet d'engagement entre militants ou partisans. Il y a des idées, des opinions, des analyses, mais elles ne sont pas " politiques ". De plus, au regard de ses responsabilités, JBG ne pouvait ignorer que TF1 se soit engagé dans la lutte contre le piratage, cheval de bataille de la Hadopi. Enfin, il n'y a pas de correspondance privée puisque JBG avait demandé à sa députée de " porter [sa] voix et celle de milliers de citoyens ", et donc dire publiquement ce qui lui écrivait personnellement.
JBG réclame 52.800 euros pour nullité de licenciement, 13 200 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 100.000 euros pour violation de ses libertés fondamentales, dont la liberté d'expression et celle du droit à la vie privée, 5000 euros pour préjudice moral, 5000 euros pour la couverture des frais de justice et le remboursement de 6 mois d'allocations d'assurance chômage. Soit 176 000 euros. Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt lui a accordé finalement 27 000 euros en condamnant TF1 pour le seul chef de " licenciement sans cause réelle et sérieuse ".
Dans l'histoire, on se souviendra que Christophe Tardieu écopera d'un
mois de suspension. Dans la douceur de l'été, il sera ensuite
nommé président du Conseil d'Administration du Centre national
de la danse, sur décret de Nicolas Sarkozy.
Source
*
Livre : La juridiction sociale et le travail de Lucien LIENHARD
Lucien LIENHARD a été conseiller prud'hommes au
Conseil de prud'hommes de Strasbourg, de 1983 à 2008, collège
employeur.
Ce livre n'est pas un guide mais une présentation exhaustive du fonctionnement
d'un conseil de prud'hommes. Sa rédaction semble avoir commencé
avant la renumérotation du code du travail : les articles du code de
1973 sont systématiquement transcrits dans l'article du nouveau code.
Enfin, pas toujours. Or ce livre a été publié au troisième
trimestre 2011, donc trois ans après la recodification. On y parle encore
de la DDTEFP, pourtant remplacée par la DIRECCTE depuis février
2010. Et le NCPC a été remplacé par le CPC en 2007.
395 pages, et presque une erreur par page.
Il est bourré de fautes d'orthographe, possède des phrases peu
compréhensibles et une mise en pages sans titres, ni hiérarchie
des paragraphes. Il y a des erreurs de droit, ce qui pour un juge expérimenté
et jugeant bon de publier est impardonnable. Et les tableaux tapés à
la machine font plus pitié qu'autre chose.
La couverture en elle-même est une énigme. La juridiction sociale
évoque le droit social, qui est composé du droit du travail et
du droit de la Sécurité Sociale. Or ce livre ne parle pas du TASS
(tribunal des affaires de la Sécurité Sociale). Ce devrait être
" la juridiction prud'homale et le travail ". On s'étonnera
devant la peinture sans indication de l'auteur et sans aucun rapport avec le
thème. On sourira de la citation, tellement vague qu'elle en est hors-sujet.
Et l'on rira de la précision à indiquer la date de naissance et
de mort de l'auteur de la citation.
Ce magnifique ouvrage est édité aux éditions
BENEVENT,
c'est-à-dire de l'édition à compte d'auteur. On se dépêchera
de s'en procurer un exemplaire avant qu'il ne soit épuisé.
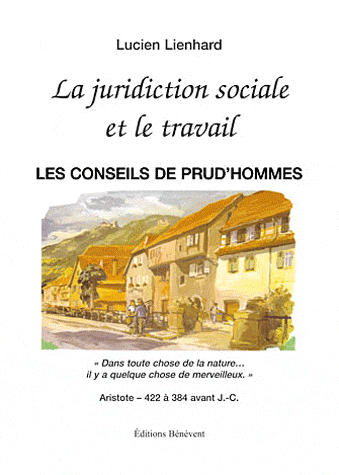
*
À partir du 1er juillet 2012, les entreprises et les salariés devront prendre en compte plusieurs changements concernant la surveillance médicale des salariés :
Visite médicale d'embauche:
Elle a désormais comme objectif supplémentaire d'informer
le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et de
le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Il n'y aura pas nécessité d'un nouvel examen médical d'embauche
si aucune inaptitude n'a été reconnue lors d'un examen antérieur,
s'il a eu lieu dans les 24 mois précédents (au lieu de 12 précédemment).
Cette disposition vaut en cas de réembauche dans la même entreprise.
S'il s'agit d'une entreprise différente, cette période est ramenée
à 12 mois (au lieu de 6 précédemment).
Visite médicale périodique:
Elle est maintenue à 24 mois mais pourra être allongée si le salarié a bénéficié d'un entretien infirmier et d'actions pluridisciplinaires prenant en compte des recommandations " de bonnes pratiques existantes ". Tout salarié pourra bénéficier, comme auparavant, d'un examen médical à sa demande ou à la demande de l'employeur.
Arrêt de travail:
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail inférieur à 30 jours alors que, jusqu'à présent, il ne l'était que pour ceux de moins de 8 jours.
La visite de pré-reprise:
Auparavant elle était facultative. Aujourd'hui: Une visite de pré-reprise est instituée pour les salariés dont l'arrêt de travail est supérieur à trois mois. Elle est organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin-conseil. Cette visite de reprise reste obligatoire après un congé maternité ou une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit leur durée.
Les visites de reprise:
Dans le cas d'un accident de travail, la visite de reprise ne devient plus obligatoire qu'à partir de 30 jours d'absence au lieu des 8 jours actuels. Ce délai remplace également les 21 jours qui étaient en vigueur pour les absences de maladie ou d'accident non professionnel. Il n'y a plus de visite de reprise obligatoire pour cause d'absences répétées.
Les déclarations d'inaptitude:
Le principe de deux visites espacées de 15 jours est maintenu. Néanmoins, en cas de péril imminent pour la santé ou la sécurité du salarié ou de tiers, le médecin peut prononcer l'inaptitude en une seule visite. A cela s'ajoute une nouvelle règle : l'inaptitude pourra désormais être constatée à l'issue d'une seule et unique visite de reprise lorsqu'un examen de pré-reprise aura eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.
Contestation de l'avis du médecin du travail :
désormais, le recours du salarié ou de l'employeur devra être
adressé à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise
dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec avis de
réception. La demande devra énoncer les motifs de la contestation
(R4624-35 nouveau). L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionnera
les délais et voie de recours (R4624-34 nouveau). L'avis de l'inspecteur
du travail peut être contesté dans un délai de deux mois
devant le ministre chargé du travail (R4624-36 nouveau).
*
Inaptitude sans AT/MP : le préavis disparait.
Jusqu'à présent, lorsqu'un salarié a été
déclaré inapte par le médecin du travail, en dehors d'une
maladie professionnelle (MP) ou d'un accident du travail (AT), le préavis
n'était ni effectué ni payé. Le salarié ne pouvait
toucher une allocation par POLE EMPLOI, car cet organisme ne prend en charge
qu'après la fin du contrat. Dans le meilleur des cas, le salarié
tombait 'opportunément' malade, pendant la durée du préavis.
La loi du 29 février 2012 met fin à cette situation : le salarié
n'a plus de préavis et peut s'inscrire immédiatement à
POLE EMPLOI.
*
Prud'hommes, le grand sinistre.
Chargés de trancher les litiges du travail, les prud'hommes,
composés non pas de juges professionnels mais de conseillers élus
par les salariés et les employeurs, sont considérés par
beaucoup comme sinistrés. Aux délais insupportables (deux ans
pour une première décision) ou aux audiences mal dirigées,
se greffent un autre grief : " l'illisibilité " de nombreux
jugements, les strictes règles de droit étant trop souvent négligées.
Un constat fait côté employeurs comme employés.
Monique Bertin, d'Annecy-le-Vieux (74), relève de la première
catégorie. Présidente du conseil syndical de sa copropriété
elle a eu a gérer le licenciement, en 2007, de la femme engagée
pour entretenir la résidence. " elle ne faisait pas ses heures et
pour cause : elle travaillait sur le même créneau horaire chez
un autre employeur, assure Monique Bertin. Nous avions toutes les preuves.
Elle a mis près de deux ans à saisir les prud'hommes. De renvois
en renvois, le jugement a été rendu en septembre dernier. Très
peu motivé, il nous condamne à lui verser 5 000 ' de dommages
intérêts plus 700 'de frais de justice On nous a fait comprendre
que nous avions obtenu l'essentiel (Se débarrasser de l'employée)
et que cela valait bien que nous, la "riche copropriété',
nous l'indemnisions. C'est cela appliquer le droit et être juste? "
Jugements biaisés
Côté employés, les critiques sont encore plus fortes et
plus nombreuses avec, comme fil conducteur, une procédure trop déséquilibrée.
Ancien conseiller (salarié) prud'homal de Liboume (33), Roger Billard,
leur donne implicitement raison. " Aux prud'hommes plus qu'allers, c'est
au demandeur d'apporter la preuve, explique-t-il. Or, pour un salarié'
qui réclame le paiement d'heures supplémentaires ou d'arriérés
de salaires, c'est très difficile. Afin de rétablir l'équilibre,
la loi prévoit de désigner un conseiller rapporteur qui a la possibilité
de se rendre chez l'employeur pour y recueillir des témoignages. En réalité,
ça n'arrive que rarement. Résultat, le jugement rendu est biaisé.
" Si la quantité des décisions contestées devant les
cours d'appel est un indice de qualité du travail fourni, alors les prud'hommes
font figure de cancres. En 2008, le taux d'appel frôlait 61 % contre seulement
13 % pour les tribunaux de grande instance (affaires civiles).
Et, dans le lot, de nombreux jugements sont infirmés par les cours d'appel
qui sont, elles, composées de magistrats de métier.
Source : "QUE CHOISIR sur les Prud'hommes dans le cadre d'une enquête
sur la justice auprès des lecteurs (n° 501 - mars 2012)".
Et quiconque saisira les prud'hommes sera bien inspiré de lire 'gagner aux prud'hommes' de Patrick Le Rolland, éditions Maxima, qu'il se défende seul ou aidé d'un syndicat ou d'un avocat.
*
Rupture conventionnelle : Les nouveaux formulaires sont arrivés !
Depuis le 20 février 2012, les nouveaux formulaires CERFA sont disponibles ICI, vous pouvez jeter les anciens.
*
Prud'hommes : l'État condamné pour des délais excessifs
Est-il normal que de plus en plus d'affaires voient leurs termes repoussés
parfois de plusieurs années ? Non, estiment salariés et syndicats,
qui accusent une nouvelle fois l'État de déni de droit dans trente
affaires portées devant la justice.
"J'ai traité la semaine dernière en bureau de conciliation
des dossiers remontant à quatre ou cinq mois et j'ai fixé des
dates de bureau de jugement à mars' 2014 !" Danielle Darras,
conseillère prud'homale Solidaires à l'encadrement de Nanterre
(92), décrit l'engorgement de son conseil comme "un déni
de droit" préjudiciable aux salariés, demandeurs dans la
quasi-totalité des dossiers. "Déni de droit", c'est
ce que vont plaider, mercredi 15 février devant le Tribunal de grande
instance de Paris, les membres du SAF (Syndicat des avocats de France). Près
de trente affaires mettant en cause l'État pour les délais excessifs
de la procédure prud'homale sont audiencées. SAF, CGT, CFDT, CFE-CGC,
Solidaires, UNSA, Syndicat de la magistrature et les ordres des barreaux de
Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Paris seront parties intervenantes aux
côtés de salariés demandeurs. Il s'agit d'une seconde salve.
Lors de la première, en novembre 2011, seize dossiers ont été
plaidés. Et l'État a été condamné à
verser aux victimes des indemnisations variant de 1.500 à 8.500 ',
plus 2.000 ' au titre des frais de justice pour un montant global supérieur
à 100.000 '. "Ces jugements reconnaissent l'existence de dysfonctionnements
graves des conseils de prud'hommes liés au manque de moyens", se
réjouit maître Aline Chanu du SAF.
Des délais à rallonge
De dix à douze mois entre la date de conciliation et l'audience de jugement
à Nanterre et même jusqu'à trois ans à Bobigny (93)
! Et délais en cas de départage, c'est-à-dire en cas de
recours à un magistrat professionnel. Des mois donc avant la notification
du jugement. Et encore deux ans d'attente si l'affaire va en appel. Les syndicats
impliqués notent que les délais excessifs de procédure
"se muent bien souvent en longues années d'attente" et constatent
qu'un salarié en CDD demandant la requalification en CDI n'a pratiquement
aucune chance d'obtenir une décision avant la fin de son contrat.
Des salariés lésés. "Alors que le Code du travail
prévoit que dans ce genre d'affaires le juge statue en urgence dans le
délai d'un mois", soulignent-ils. Idem pour les contestations de
licenciements économiques, à traiter en théorie dans les
sept mois. "Cette lenteur extrême des procès a un effet pervers
évident sur les perspectives de négociation", déplorent
les syndicalistes. Des salariés transigent avec des montants inférieurs
à leurs droits. Exemple, ce salarié qui a ainsi accepté
une indemnité égale à trois mois de salaire, alors que
son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrait droit
à six mois de salaire ; ou cette autre, qui a renoncé à
poursuivre son employeur malgré le motif discriminatoire de la rupture.
Manque de moyens humains
"Nous voulons plus de moyens en personnel au greffe et en magistrats départiteurs",
réclame maître Maude Beckers au nom du SAF. À la demande
de ce syndicat, Claude Bartolone, député socialiste, avait interrogé
le ministre de la Justice sur les mesures qu'il entendait prendre "pour
que le droit républicain d'obtenir une décision de justice dans
un délai raisonnable soit effectivement garanti". Dans sa réponse,
en décembre 2011, le ministre avait reconnu des durées moyennes
de 11,1 mois au niveau national, de 21,4 mois à Nanterre et 22,9 mois
à Bobigny. Il avait mis en cause un recours élevé au départage
et "la pratique des renvois successifs".
Faire durer. Mais l'initiative des renvois n'émane pas des salariés,
généralement pressés de récupérer leur dû.
Les parties adverses, elles, en usent et abusent' "Dans l'attente,
l'employeur n'est pas condamné", résume Danielle Darras.
Exemple : Thierry, l'un des plaignants, attend encore un jugement de première
instance pour un dossier déposé' en mai 2010. Premier report
à la demande de son avocate qui avait reçu les conclusions adverses
la veille de l'audience. Puis deux encore à la demande de l'employeur,
l'un pour indisponibilité, l'autre pour une prétendue erreur de
section ! "C'est abusif, le report ne devrait être accepté
qu'une fois", tempête-t-il.
L'État condamné
Ces délais contreviennent à la Convention européenne des
sauvegardes des droits de l'homme, laquelle précise que "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial".
Ce texte a servi de fondement aux poursuites contre l'État. Dans l'un
des dossiers plaidés en novembre, on apprend qu'un ingénieur d'études
- encore présent dans l'entreprise - a patienté neuf mois pour
la conciliation, puis seize mois pour l'audience de jugement en vue de la résolution
judiciaire de son contrat pour discrimination liée à son mandat
de représentant du personnel. Le TGI a retenu un préjudice moral
et a alloué au demandeur 5.000 ' d'indemnités. Des condamnations
similaires sont attendues le 15 février. Me Maude Beckers plaidera le
15 février le dossier d'une victime de harcèlement moral ayant
attendu longuement, sans parvenir à tourner la page, la condamnation
de l'employeur en première instance puis en appel. "Cette nouvelle
action en justice constitue une épreuve pour elle' Elle ne sera
pas présente à l'audience", confie l'avocate.
Une demande de débat public. Une mobilisation est prévue devant
le TGI juste avant l'audience à l'appel des syndicats et barreaux. Dans
un communiqué, ces organisations réclament un débat public
sur les délais excessifs, "conséquences du manque de moyens
matériels et humains de la justice prud'homale". Au ministère
de la Justice, on se refuse à commenter l'action et les condamnations.
On renvoie vers la réponse du ministre à l'Assemblée nationale.
Celle-ci évoque des "groupes de travail", mais aucune création
de postes. "Nous allons demander un rendez-vous à la Chancellerie",
s'impatiente Me Maude Beckers.
Martine Rossard
Source
Départage prud'homal : du nouveau
Le code du travail est modifié par la nouvelle loi n°2011-1862 du
13 décembre 2011, en son article 5. L'application de cette loi aura lieu
le premier janvier 2013, dans un peu plus d'un an.
Le juge départiteur, qui était auparavant issu du Tribunal d'instance
ou siège le Conseil de prud'hommes, viendra désormais d'un tribunal
de grande instance, dont le ressort est géographiquement plus étendu.
Et ce sera le même pour plusieurs Conseils de prud'hommes le cas échéant.
Il sera donc spécialisé dans le droit du travail.
Le nouvel article du code du travail est désormais rédigé
comme suit :
" Article L1454-2
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau
de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation
de référé, présidé par un juge du tribunal
d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil
de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président
en application du dernier alinéa. L'affaire est reprise dans le délai
d'un mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année
les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne
un ou plusieurs tribunaux d'instance.
En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal
de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si
l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance
dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande
instance. "
Rappel : le juge départiteur'
A la différence des conseillers prud'hommes qui sont des magistrats élus
issus de la société civile, le juge départiteur est un
professionnel.
Il intervient dans le procès prud'homal lorsque les conseillers prud'hommes n'ont pas pu prendre une décision (unanimement en référé ou conciliation puisqu'ils ne sont que deux, à la majorité de trois sur quatre minimum en bureau de jugement). (Présentation issu de 'gagner aux prud'hommes' de Patrick Le Rolland, éditions Maxima).
Assurance perte d'emploi : danger en cas de rupture conventionnelle !
Certaines sociétés d'assurance refusent de faire jouer la garantie perte d'emploi en cas de rupture conventionnelle du fait du caractère amiable de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel de Nîmes vient de donner raison à l'une d'entre elles.
Les salariés qui concluent une rupture conventionnelle prennent un risque
lorsqu'ils ont contracté un prêt immobilier. En effet, certaines
sociétés d'assurance estiment que leurs contrats ne couvrent pas
le cas de la rupture conventionnelle. Les avis divergent sur la question. La
cour d'appel de Nîmes vient de se prononcer.
Assurance perte d'emploi
Un salarié signe une rupture conventionnelle et se voit refuser par la
société d'assurance avec laquelle il a souscrit un contrat d'assurance
dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier la prise en charge de ses
mensualités au titre de la garantie de perte d'emploi. La société
d'assurance estime que la rupture conventionnelle n'est pas un cas couvert par
le contrat. Les juges vont lui donner raison.
La rupture conventionnelle est-elle couverte ?
La notice d'information du contrat d'assurance souscrit par le salarié
prévoit que la garantie perte d'emploi est due à trois conditions
:
- que le salarié soit en CDI ;
- qu'il soit licencié ;
- et qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement (Pôle emploi).
Outre la rédaction du contrat d'assurance, les juges rappellent que
"tout contrat d'assurance a pour objet de garantir un risque susceptible
de survenir, indépendant de la volonté des parties". Or en
l'espèce l'aléa n'existe pas, estiment les juges puisque "la
rupture conventionnelle ne résulte pas de la seule décision de
l'employeur comme c'est le cas dans le licenciement, mais suppose un accord
de l'employeur et du salarié".
La cour d'appel rejette ainsi l'un des arguments du salarié selon lequel
la rupture de son contrat résulte non pas d'un accord négocié
mais d'un acte unilatéral de l'administration : l'homologation de la
rupture conventionnelle.
Une rupture négociée qui exclut l'aléa
Quant à la question de savoir si la lecture du contrat ne doit pas être
revue à l'aune des nouvelles dispositions du code du travail sur la rupture
conventionnelle qui n'existait pas au moment de la conclusion du contrat d'assurance,
là encore les juges opposent une fin de non-recevoir. Car même
si la rupture conventionnelle n'existait pas, reconnaissent les juges, et ne
peut donc avoir été prévue par le contrat d'assurance,
elle entre bien dans les ruptures négociées du contrat de travail
qui sont exclues du contrat d'assurance. La perte d'emploi n'est pas subie par
le salarié.
Lisez bien votre contrat d'assurance
Les salariés qui envisagent une rupture conventionnelle doivent donc
être extrêmement attentifs à la rédaction de leur
contrat d'assurance et s'assurer qu'il couvre bien ce mode de rupture du contrat
de travail.
Source
*
Procédure prud'homale, mode d'emploi
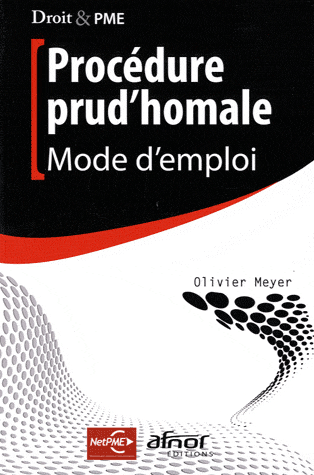
Un mode d'emploi destiné aux employeurs, principalement aux Petites et Moyennes Entreprises, avec le parti-pris que celles-ci sont assez ignorantes du B.A.-BA en matière prud'homale.
Même si notre propos sur ce site est davantage de guider les salariés que les employeurs, savoir ce qui pouvait être conseillé par cet auteur et cet éditeur aux dites P.M.E. ne pouvait qu'éveiller notre intérêt. Un salarié bien informé en vaut deux et il aurait suffi de retourner ces bons conseils.
Mais las ! En 88 pages, cet ouvrage ne dit pas grand-chose sur la procédure prud'homale. Il risque même de ne pas être très utile au public des employeurs de PME qu'il vise. Sinon les convaincre que parce qu'ils n'y connaissent rien et qu'il y a partout des chausse-trappes, mieux vaut prendre les conseils' d'un bon avocat. De l'autopromotion en quelque sorte.
Ce n'est qu'une courte présentation synthétique de la procédure
prud'homale, sans valeur ajoutée. Contenu insuffisant pour servir de
véritable mode d'emploi comme pourtant promis. Bon pour réviser
et aider à mémoriser un savoir de base acquis par ailleurs.
Auteur : Olivier Meyer
Date de parution : Juin 2011
Nombre de pages : 88 p.
ISBN : 978-2-12-465312-6
*
Le droit du travail pour tous

On ne peut condenser le droit du travail en 200 pages.
Ce livre conviendra aux salariés pour avoir une réponse rapide,
mais pas aux praticiens : il ne va pas suffisamment en profondeur et en détail
pour mériter l'appellation de 'précis'. Le chapitre 'heures supplémentaires',
par exemple, mériterait plus d'une simple page.
Il ne recèle pas d'erreurs flagrantes mais juste quelques imperfections
ne remettant pas en cause la qualité générale du livre.
Les arrêts de la cour de cassation ne sont pas cités par leur numéro
mais juste par une date, ce qui est insuffisant.
Par Jean MANIERE
Paru le : 19 août 2010
Editeur : AFNOR
ISBN: 978-2-12-465261-7
Nb. de pages: 212 pages
30 euros.
*
INSTAURATION D'UNE TAXE DE 35 EUROS POUR TOUTE PROCEDURE PRUD'HOMALE
Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, les attaques contre
la Justice en générale et celle du travail (Prud'hommes, TASS
et TCI) en particulier se multiplient.
Pour ne citer que des prud'hommes rappelons entre autre :
o la suppression de 61 Conseils de Prud'hommes (incluse dans la carte judiciaire
avec la suppression des Tribunaux : commerce, instance et grande instance),
o la limitation des temps d'activités juridictionnelles des conseillers
prud'hommes,
o la volonté d'introduire la médiation (en opposition à
la conciliation) dans les rouages de la procédure prud'homale,
o les attaques contre l'oralité de la procédure,
o la remise en cause de l'élection des conseillers prud'hommes salariés
au suffrage universel.
L'absence de moyens en personnel et en budget touche l'ensemble de la Justice,
le besoin en personnel qui se chiffre à 200 postes supplémentaires
pour les greffes des conseils de prud'hommes, afin que les salariés soient
rétablis dans leurs droits dans des délais raisonnables.
Comme si cela ne suffisait pas, le Gouvernement poursuit sa politique visant
à ce que le recours au juge soit semé d'embûches procédurales
et financières. Ce fut notamment le cas avec l'assistance obligatoire
par un avocat (entre 3000 et 5000 ') lors de pourvoi en Cour de Cassation
ce qui a eu pour effet d'abaisser de 30% le nombre de recours.
Aujourd'hui, un nouveau pas est franchi avec l'instauration du paiement d'un
timbre fiscal de 35 ' pour toutes instances introduites devant les juridictions
civiles, sociales, et prud'homales.
Ce dispositif remet en cause la gratuité de la procédure juridique
et de fait, l'accès au juge pour des milliers de salariés.
La volonté du gouvernement de réduire le contentieux prud'homal
par tous moyens, et ainsi priver les salariés de la possibilité
de faire valoir leurs droits, rejoint la volonté patronale de tout faire
pour éviter d'être condamné, alors que les licenciements,
les non paiements de salaires, et autres délinquances patronales continuent
de frapper des milliers de salariés.
La remise en cause de la gratuité de la procédure en matière
de justice du travail revient pour celles et ceux, qui dans une large majorité
sont privés de leurs emplois et d'un revenu décent, à s'acquitter
d'une taxe, d'un impôt pour obtenir réparation d'un préjudice
que leur a fait subir leur employeur !
Pire cette taxe s'appliquera aussi en matière de référé.
Ainsi, le salarié qui n'a pas reçu de salaire devra payer 35 'uros
pour que son employeur soit condamner à lui verser, mais aussi celui
qui demandera la délivrance de l'attestation pôle emploi indispensable,
pour percevoir ses indemnités de chômage, et l'on pourrait ainsi
multiplier les exemples ....
D'autant plus que l'on sait très bien qu'aujourd'hui la taxe est fixée
à 35 'uros, mais qu'elle n'aura vocations qu'à augmenter.
*
Chômage : l'attestation sera envoyée par l'employeur directement à Pôle Emploi.
A partir du premier janvier 2012, les employeurs
de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle
emploi par voie électronique,
sauf impossibilité.
Les nouveaux textes : ICI
et LA.
*
Gérer la rupture conventionnelle et la démission
Gérer la rupture conventionnelle et la démission
est un guide rédigé par l'équipe rédactionnelle
de RF social.
C'est ce que l'on appelle un précis, c'est-à-dire une monographie
dédiée à un sujet donné (ici, deux). Il est issu
de la collection 'les essentiels RF'. Et c'est un quasi sans faute que ce guide
destiné en priorité aux praticiens : services RH des entreprises,
avocats, syndicalistes. Le salarié moyen n'en aura que faire.
Les auteurs maitrisent leur sujet, et citent abondamment leurs sources : articles,
circulaires ministérielle, arrêts de cassation numérotés.
Son prix de 31 euros parait un peu élevé, mais les 146 pages sont
bien présentées, avec des couleurs, des gras, des encadrés,
des sommaires de chapitres.
Un détail : la brochure est de qualité médiocre, les pages
tentant de se détacher de la couverture.
Auteur : Revue fiduciaire , coordination K. Aflalo, équipe
rédactionnelle de RF Social
Éditeur : Groupe Revue fiduciaire, Paris; Collection : Les essentiels
RF
Description : 149 pages; (23 x 15 cm), ISBN13 : 9782757901847; STYLE : GUIDE ; 31 euros
*
Prud'hommes, un film de Stéphane Goël.
Rares sont les documentaires sur le quotidien des Conseils de Prud'hommes. Il
y avait bien eu pour France 2 en 1999, " Le travail dans la balance "
(de Virginie Linhart et Eric Moutet), toujours disponible aujourd'hui en DVD
chez l'Harmattan.
Cette fois c'est à un film reportage destiné aux salles que Stéphane
Goël invite tous ceux qui s'intéressent au sujet : salariés
en procédure devant les prud'hommes ou susceptibles de l'être un
jour (200 000 par an !), militants syndicaux et représentants du personnel,
professions judiciaires, acteurs et cadres des ressources humaines' Le
public est somme toute vaste même si ce genre de production est en général
voué à une diffusion quelque peu confidentielle (à l'affiche
de 6 salles en tout pour tout actuellement en France).
Certes, ce film ne témoigne pas des prud'hommes français mais
de ceux du canton de Vaud en Suisse. Ce type de tribunal spécialisé
dans les conflits du travail existant également chez nos voisins suisses
dans les cantons du Jura, de Genève.
Sur le fond, si ce n'est des règles différentes de procédure,
de fonctionnement et de limite de compétence sur le montant du litige,
les tranches de vie au travail qui défilent devant la caméra pourraient
sans doute avoir été tournées n'importe où à
moins que le " paradis socialiste " n'existe quelque part ?
Mais point de manichéisme excessif dans l''il du réalisateur.
A quelques exceptions près pour quand même souligner le propos
du faible contre le puissant, dans ce qu'on nous montre, tout n'est pas systématiquement
ni tout blanc, ni tout noir d'un côté ou de l'autre. Un peu comme
dans les divorces lorsque la rupture est consommée et que le point de
non retour est dépassé. On ne sait plus toujours dire qui est
le premier qui a fauté ou trahi la confiance ou lequel n'a éventuellement
eu de cesse que d'en rajouter. Chacun se fera donc son opinion. Le tribunal
de prud'hommes suisse lui-même n'en a pas forcément une bien tranchée,
tant il cherche à concilier presque vaille que vaille ou même à
tout prix. Grande différence avec les prud'hommes hexagonaux qui finalement
jugent quant à eux plus qu'ils ne concilient (moins de 10 % des affaires
seulement).
Concilier n'est peut-être d'ailleurs pas le mot qui convient le mieux
même si c'est celui que retient le vocabulaire de la procédure
suisse. Sans doute faudrait-il davantage parler de médiation avec un
renvoi presque dos à dos de chaque protagoniste : chacun ses torts, chacun
ses droits ou ses raisons, pas de gagnant, pas de perdant et accepter pour l'un
et l'autre de passer le plus vite possible à autre chose' Le c'ur
du litige étant quant à lui enfoui, étouffé sous
une indemnité négociée. Il n'est pas certain que du côté
du plus faible, même payé en monnaie sonnante et trébuchante,
il n'en reste pas un sentiment de frustration.
Sentiment qui pourra également mettre mal à l'aise le spectateur
français peut-être plus empreint d'un fond de lutte de classes
que ses homologues suisses.
Patrick Le Rolland, ancien conseiller prud'hommes,
auteur de 'Gagner aux prud'hommes' aux éditions Maxima.
*
LA PRUD'HOMIE EN DANGER
Il y a quelques mois, à Londres, étaient
réunis des praticiens du droit du travail, notamment juges des prud'hommes.
Ils voulaient comparer les systèmes de conciliation, de médiation
et d'arbitrage dans cinq pays au sein de l'Union.
Nos amis italiens avaient alors attiré notre attention sur les dangers
de leur système qui rend la justice du travail moins accessible. Aujourd'hui,
ces dangers se concrétisent pour nous aussi avec la publication de la
loi n° 183 du 4 novembre 2010. Ce texte est conforme aux préconisations
de certains rapports publiés en France. Leurs auteurs recommandent de
faire appel à des institutions privées, d'arbitrage ou de médiation,
pour se substituer aux dysfonctions alléguées de nos conseils
de prud'hommes.
Nous sommes en droit désormais de nous interroger sur la volonté
gouvernementale. La chancellerie et le ministère du Travail veulent-ils
pérenniser la juridiction prud'homale ou l'étouffer ? Elle est
délaissée en moyens budgétaires de modernisation et en
investissements en personnel de greffe.
Les alertes que nous avons signalées dans le passé ne semblent
pas émouvoir ceux qui sont responsables de cet état de fait. Cela
ne les prive pas, pour autant, de dénonciations quant aux délais
déraisonnables entre l'enrôlement des dossiers et les dates de
jugement.
Les règles bureaucratiques de contrôle des dépenses générées
par l'avance aux entreprises des salaires maintenus des juges prud'hommes salariés
aggravent le sentiment d'injustice des conseillers consciencieux.
La chancellerie ne peut ignorer qu'elle paralyse ainsi la gestion des flux de
dossiers qu'elle prétend vouloir réguler. Qui s'étonnerait
alors des projets visant au contournement du juge judiciaire au profit de systèmes
" à l'italienne " ?
La conciliation ne jouerait plus le rôle d'audience initiale avec mise
en état et éventuelle condamnation provisionnelle. En décourageant
le justiciable par des délais qu'occasionne cette gestion de la pénurie,
on applique cette vieille méthode qui veut que pour noyer son chien on
dise qu'il a la rage.
Il suffit de prendre connaissance des délais scandaleux qui sont en cours
dans certaines juridictions, comme le conseil des prud'hommes de Nanterre, pour
s'interroger sur les véritables intentions du pouvoir. Dès lors,
la mobilisation qui a accompagné la réunion du conseil supérieur
de la prud'homie qui s'est tenue le jeudi 25 mai à Paris ne doit être
qu'une étape du rassemblement de tous ceux qui sont attachés à
la défense de l'institution prud'homale.
Par Bernard Augier, représentant de la CGT au Conseil supérieur
de la prud'homie, et Tiennot Grumbach, avocat.
source
*
CDD et INAPTITUDE
Entrée en vigueur d'une loi sur les conséquences
d'une déclaration d'inaptitude sur un salarié en CDD.
Jusqu'à présent, le contrat ne pouvait être rompu :
- l'employeur ne pouvait licencier, sauf à risquer de se faire condamner
pour licenciement abusif,
- le salarié ne pouvait démissionner car il ne pouvait toucher les allocation chômage.
Et donc le salarié ne touchait ni salaire ni indemnité.
Cette loi permet donc de mettre fin à une situation ubuesque. Mais ce changement positif n'a pu avoir lieu qu'à la multiplication des cas d'inaptitude pendant un CDD, elle même due à la multiplication des CDD, donc de la précarité.
17 avril 2011
*
Connaitre vos droits

Le titre est trompeur.
Si en effet l'information est présente, souvent brute et tirée
du code du travail, avec quelques erreurs, cet ouvrage dit le droit mais n'indique
pas comment les faire valoir. Envoyer le lecteur à la rencontre d'un
avocat ou des délégués du personnel (en oubliant au passage
les membres du CE et les syndicats) en cas de problème est un peu léger.
Aucun courrier type, aucune aide utile tirée de l'expérience, ce qui est normal pour une jeune auteur qui vient juste de terminer ses études.
L'auteur excelle visiblement dans un domaine de prédilection
: les congés payés. Les explications sont alors détaillées
de manière précise. Pas moins de 8 chapitres sur 40. Ce qui laisse
peu de place pour le reste, déséquilibrant le livre :
Rien sur les clauses du contrat de travail, la modification du contrat, les
procédures de redressement et liquidation, sur la durée du travail,
le temps partiel, et superficiel sur beaucoup de sujets.
Le praticien se désolera de n'y trouver la moindre jurisprudence et aucune bibliographie.
À quand le tome deux : maintenant que je connais mes droits, je les fais valoir.
Connaître vos droits pour les faire valoir de Claire Dieterling
*
Le livre du mois
Vous travaillez dans une entreprise ou une association ? Il n'y a pas de représentants
du personnel ?
Alors ce guide répondra à la plupart de vos questions, et se distingue par son ton résolument engagé aux côtés des salariés, ce qui n'exclut pas la grande rigueur de son contenu.
Un paragraphe de questions/réponses, souvent issues du vécu, succède à chaque chapitre.
Vous trouverez dans ce guide : les bonnes choses à faire et à savoir, le droit du travail, des liens, des infos utiles'
Cela dit, même des délégués du personnel ou des syndicats seraient inspirés de l'avoir sous le coude !
Auteur : Didier SCHNEIDER.
Après "100 licenciements", surnommé "le livre noir du licenciement", il termine de rédiger la dixième édition de " Démission, départ négocié, licenciement, retraite, sanctions" aux éditions Maxima.
*
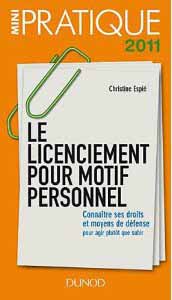
Le licenciement pour motif personnel Connaître ses droits et moyens
de défense pour agir plutôt que subir de Christine Espiè
Ce guide pratique de 64 pages s'adresse aux salariés au moment du licenciement.
S'il est à jour question lois, la quantité d'informations
disponibles ne suffira pas à répondre en intégralité
à toutes les questions que se posera le salarié.
Outre les manques, l'ouvrage contient quelques erreurs vénielles. Il
ne sera donc utile qu'aux étudiants souhaitant acquérir une initiation
superficielle.
*
Ruptures conventionnelles
Dans le cadre d'une convention d'objectifs
2010 avec l'IRES, la CFDT a demandé au Centre d'études
de l'emploi de faire une enquête qualitative sur les ruptures
conventionnelles visant à savoir comment les salariés ont vécu
la rupture conventionnelle. Cette enquête est en cours auprès d'une
trentaine d'adhérents
ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle.
La DARES, à la demande de la CFDT, a accepté de donner une autre
dimension à cette étude qui consistera à interroger 8 à
10 000 salariés qui bénéficieront d'une
rupture conventionnelle homologuée (vraisemblablement en mai et juin
2011 si le calendrier est respecté). Premiers résultats attendus
pour janvier 2012.
Dans le cadre de la Commission Nationale de la Négociation Collective
et de l'agenda social qui prévoit de faire un bilan des mesures
prises par l'accord
« modernisation du marché du travail » du 11 janvier 2008,
la CFDT portera son analyse sur la rupture conventionnelle comme sur toutes
les autres mesures.
*
Le travail dans la balance

Les éditions L'HARMATTAN
éditent un DVD d'un reportage écrit par Virginie LINHART et Eric
MOUTET.
Aux prud'hommes, pas de classe dominante, ni de classe dominée. Logique
de salarié et logique d'employeur coexistent sur un pied d'égalité
mathématique : comme 2 et 2 font 4, juges, employés et patrons
ordinaires arbitrent paritairement les conflits du travail. Ces meilleurs "ennemis"
du monde s'échappent quelques jours par mois de leur entreprise pour
juger les relations conflictuelles de leurs semblables. Cristallisant les tensions
d'un monde de l'entreprise toujours en mouvement, ces tribunaux spécifiques
sont un baromètre social parfaitement révélateur.
Il est toujours d'actualité même s'il a été tourné en 1998. On remarque d'ailleurs qu'il a été tourné sur pellicule car l'image tremble au début, ce qui surprend un peu.
Objectif, concret, il offre une bonne illustration de ce que sont les prud'hommes.
*
Statistiques du conseil de prud'hommes de Paris pour 2010
*
LIVRE
Salariés, défendez vos droits de Lionel Belème, éditions MAXIMA.
Cet ouvrage est un véritable tissu d'erreurs et devrait être retiré de la vente !
N'existe-t-il pas de comité de lecture aux éditions
MAXIMA ?
La seule chose qui sauve ce guide est son lexique fourni. Mais on trouve la même chose sur nombre de sites internet...
20 janvier 2011
*
Gagner aux prud'hommes
Sortie de l'édition 2011 du guide écrit par Patrick Le Rolland. Remis au goût du jour et de la nouvelle numérotation du code du travail d'avril 2008, c'est actuellement le meilleur livre sur le sujet.
Bien présenté, compréhensible, sans erreur, il se révèle indispensable à tout salarié désirant comprendre le mécanisme prud'homal, qu'il se défende lui même ou assisté d'un avocat ou d'un syndicat.
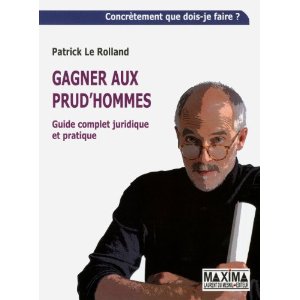
*
Portraits de Marcs....
Mobilité forcée, gel des salaires,
dates de congés imposées, déremboursement des frais de
mission, formations bouche-trous, licenciements abusifs, traitement humiliant
des ingénieurs en intercontrat' Dans un document
en téléchargement libre, la Fédération des sociétés
d'études CGT pointe du doigt les conditions de travail en sociétés
de services.
« Issu d'un travail quotidien de délégués syndicaux
dans une SSII », l'ouvrage part d'expériences réelles
pour les restituer sous forme de fictions. On suit, dans un style alerte non
dénué d'humour, les mésaventures de Marc, ou plutôt
de tous les Marc en SSII qui pourraient « d'une manière ou
d'une autre s'y retrouver ». L'idée de cette présentation
originale serait venue après avoir reçu « une publication
d'entreprise intitulée Portrait de marque, en décalage complet
avec le vécu sur le terrain ».
Dans la lignée du Livre noir du consulting
Groupe Open semble être la SSII inspiratrice du livre. Portrait de marque
décline, en effet, le concept utilisé par cette société
de services pour tisser du lien « entre l'entreprise, ses clients
et ses collaborateurs ». Le chapitre 17 est plus explicite encore, puisqu'il
évoque le nouveau président du Syntec, « également
coprésident de notre groupe ».
Ces Portraits de Marc édités par la Fédération des
sociétés d'études CGT s'inscrivent dans la lignée
du Livre noir du consulting, également en ligne, et de Derrière
l'écran de la révolution sociale, un récent essai
sur le travail en SSII écrit par un journaliste spécialisé
dans les questions sociales.
*
le point de vue de mandataires judiciaires sur la procédure de licenciement :
Le représentant des salariés est il utile ?
Oui estime maitre Mauras, mandataire judiciaire à Nantes : pour les procédures
de sauvegarde et de redressement. Moins, voire parfois néfaste lors d'une
liquidation : quand elle n'est pas considérée comme une corvée,
la fonction de représentant des salariés peut être l'occasion
pour un salarié de régler des comptes personnels avec l'employeur,
ou pour celui-ci de pouvoir placer un proche de confiance à ce poste
stratégique.
Comment être efficace quand on n'a pas été formé
à cette épreuve ? Peut-on s'appuyer sur le mandataire ?
Bien que cela ne soit pas son rôle premier, maitre Mauras peut être
amené à conseiller le représentant des salariés,
surtout lorsque le dialogue entre employés et employeur semble rompu.
Lors d'une liquidation, le représentant des salariés sera le dernier
à être licencié. Une des causes de ce report est l'attente
de l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail. Alourdissement
inutile de la procédure confirmé par maitre Ouizille, mandataire
à Nanterre, au préjudice du salarié en question.
2 janvier 2011
Des questions sur le licenciement ? posez votre question sur le FORUM !
*